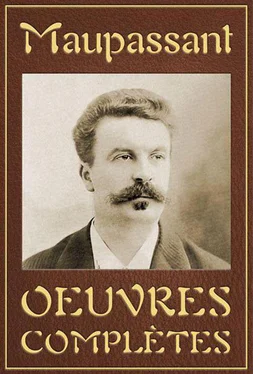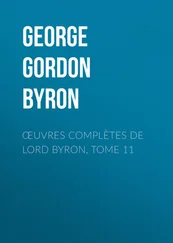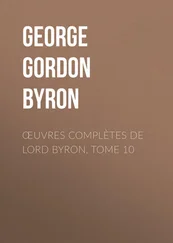Ce qu’il y a de bizarre et de curieux, en effet, dans son cas, c’est qu’il ne connaît rien lui-même au bibelot. A force d’en voir il finit par discerner à peu près le prix courant des objets assez connus ; mais il hésite devant les pièces rarissimes, incapable de reconnaître leur provenance et de contrôler leur authenticité. Il n’est, au fond, qu’un avare amassant non de l’or, mais des poteries, des toiles, des meubles, des bijoux, en procédant toujours par comparaison et jamais par intuition. Quand il hésite, il a recours à l’expert, ce qui prouve bien qu’il n’aime pas l’objet, que la beauté et la grâce de la chose ne le préoccupent nullement, et qu’il tient à la seule estimation — bien établie.
Et c’est grâce à lui, pour lui, que s’est développée, comme le chien d’arrêt pour le chasseur, la race anxieuse des experts. Quelques-uns exercent cette profession officielle à la façon des notaires et des avoués, mais les plus sûrs sont des amateurs bien doués, vraiment nés pour le bibelot, ceux-là, et qui, sans fortune, utilisent leurs facultés naturelles, leur flair, leur sens du beau, du rare, du curieux, du gracieux, de l’introuvable, et cherchent, dénichent, reconnaissent, apprécient, jugent, estiment, classent, d’un œil sûr, infaillible, l’objet qu’on leur montre ou qu’ils découvrent.
Il est en France plus de cent collections ayant coûté plus d’argent qu’il n’en faudrait pour bâtir la féerique abbaye du Mont-Saint-Michel.
Où sont-elles, ces collections ? Elles sont rangées dans des vitrines, enfermées dans des armoires, classées comme des herbiers ou des médailles. Servent-elles à la décoration de quelque hôtel original et princier ? Non. L’hôtel, au contraire, semble construit uniquement pour les contenir comme une boutique est faite pour enfermer des marchandises. Ce sont, en effet, des marchands qui ont acheté ces choses, avec la peur incessante d’être trompés, d’être volés, puis ils les ont mises en ordre, ravis de savoir au juste ce qu’elles valent, ils les ont alignées, époussetées, numérotées et cataloguées avec un soin minutieux et puéril de gens très ordonnés et très riches.
Un d’eux disait un jour à l’ami qui visitait son hôtel : « Voyez donc ma salle de bains, elle est, je crois, le dernier mot du confortable. »
L’ami regarda et admira cette salle fort jolie en effet, avec vitraux et vieilles faïences italiennes couvrant les murs du haut en bas, puis il répondit : « C’est très bien, mais vieux jeu. Vous en êtes encore à la baignoire. »
— A la baignoire. Mais oui ! Par quoi voulez-vous donc la remplacer ?
— Oh ! Moi, si je possédais votre fortune colossale, j’aurais une piscine en marbre rouge où coulerait jour et nuit de l’eau tiède comme coule une rivière dans un pré. On y pourrait nager à vingt personnes. Sur le bord de ce bassin, des statues, l’une assise les pieds dans l’eau, une autre debout, tordant ses cheveux, une autre à genoux, se mirant, une autre lisant, une autre chantant, créées par les premiers sculpteurs de mon époque, alterneraient avec de fines colonnes portant la voûte de marbre blanc. Et dans les fonds de la vaste galerie, des vitraux superbes, de la verdure et des fleurs.
« Et mes amis viendraient nager chez moi au lieu d’aller piquer des têtes dans les bains à fond de bois ou dans la piscine Rochechouart.
« Et cette jolie fantaisie ne coûterait pas un demi-million. » L’homme riche écoutait, stupéfait, puis, après un long silence : « Oh ça, c’est de la folie ! » dit-il.
Aux bains de mer
( Gil Blas , 6 septembre 1887)
Autrefois, on allait à la mer pour prendre des bains et nager. Aujourd’hui, on vient sur les plages pour se livrer à un exercice d’une nature toute différente et qui ne demande pas le voisinage de l’eau. Du matin jusqu’au soir, on rencontre dans les rues du village marin et sur les routes avoisinantes, dans les prés, par les champs, au bord des bois, partout, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des vierges et des mères de famille déformées par cinq ou six accidents de reproduction ; les hommes vêtus de complets en flanelle blanche, les femmes d’un petit uniforme à jupe courte en flanelle noire et tous portant à la main une raquette.
Cette raquette, l’odieuse raquette, cauchemar affreux, on ne peut faire un pas dehors sans la voir. Tous l’ont su bout du bras du matin jusqu’au soir, ne la quittent pas, la manient comme un joujou, la font sauter en l’air, la brandissent, s’assoient dessus, vous regardent à travers comme derrière la grille d’une prison, ou la raclent comme une guitare. Vous la retrouvez dans les maisons, dans toutes les maisons, sur les tables, sur les chaises, derrière les portes, sur les lits, partout, partout.
Après l’avoir vue tout le jour on en rêve toute la nuit, et à travers des songes tumultueux on aperçoit toujours la main, rien qu’une main, immense et folle, agitant, dans le firmament vide, une raquette démesurée.
Ces gens, ces pauvres gens, qui portent ce signe particulier de leur folie comme autrefois les bouffons déments agitaient un hochet à grelots, sont atteints d’un mal d’origine anglaise qu’on appelle le lawn-tennis.
Ils ont leurs crises en des prairies, car un grand espace est nécessaire à leurs convulsions.
On les voit, par troupes, s’agiter éperdument, courir, sauter, bondir en avant, en arrière, avec des cris, des contorsions, des grimaces affreuses, des gestes désordonnés, pendant plusieurs heures de suite, maintenus par un filet qui arrête leurs emportements.
On pourrait croire, en les regardant de loin, de très loin, que ce sont des enfants qui s’amusent à quelque jeu violent et naïf. Mais, dès qu’on approche, le doute disparaît ; on comprend la nature de leur mal, car des hommes mûrs, des hommes vieux, des femmes à cheveux gris, des obèses, des étiques, des chauves, des bossus, tous ceux qu’on croirait ailleurs être des sages et des raisonnables se démènent et se désarticulent avec plus de folie encore que les jeunes.
Et leurs bonds, leurs gestes, leurs élans révèlent aussitôt au passant effaré l’expression bestiale cachée en tout visage humain qui ressemble toujours à un type d’animal et fait apparaître étrangement tous les tics secrets du corps.
Et les yeux se troublant, l’esprit s’affolant à les voir, c’est alors une danse macabre de chiens, de boucs, de veaux, de chèvres, de cochons, d’ânes à figures d’hommes, enculottés et enjuponnés, qui s’agitent avec des secousses grotesques du ventre, de la poitrine ou des reins, des coups de jambe et des coups de tête, une mimique violente et ridicule.
C’est ainsi qu’on s’amuse et c’est pour se livrer à ces crises quotidiennes et convulsives qu’on vient aux bains de mer en l’an 1887.
Les baigneurs d’Étretat ont pu jouir dernièrement d’une distraction d’autre nature qui a causé dans la petite ville une émotion profonde.
Un remarquable magnétiseur qui est aussi un fort adroit prestidigitateur, M. Pickmann, a affolé et terrifié ses spectateurs par des expériences d’hypnotisme.
L’hypnotisme, qui est en train de devenir une religion qui a ses miracles, ses apôtres, ses fanatiques et ses incrédules, diffère des religions ordinaires en ceci que presque tous ses prêtres sont docteurs en médecine et non plus en théologie. Jusqu’ici le principal résultat obtenu par les pratiques hypnotiques est une hausse sensible du prix des épingles, la principale épreuve consistant à en cacher partout, dans les rideaux, sur les fauteuils, sur les robes, sous les tables, afin que le voyant les retrouve. En admettant une perte de 50 %, la consommation normale des épingles a donc subi une notable augmentation, et les maisons des croyants sont devenues inquiétantes, les sièges pleins de ces épingles non découvertes présentant de sérieux dangers.
Читать дальше