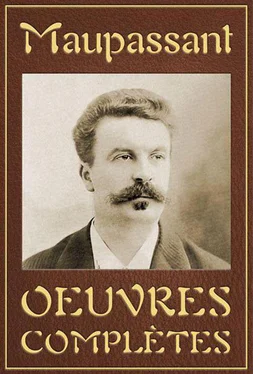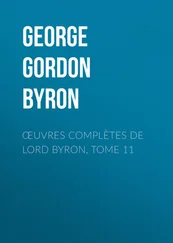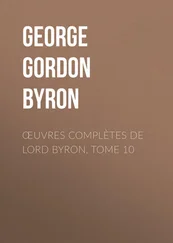Les peintres sont un peu moins prisés, bien que fort recherchés encore. Ils ont en eux moins de divin et plus de bohème. Leurs allures n’ont pas assez de moelleux et surtout pas assez de sublime. Ils remplacent souvent l’inspiration par la gaudriole et par le coq-à-l’âne. Ils sentent un peu trop l’atelier, enfin, et ceux qui, à force de soins, ont perdu cette odeur-là, se mettent à sentir la pose. Et puis ils sont changeants, volages, blagueurs. On n’est jamais sûr de les garder, tandis que le musicien fait un nid dans la famille.
Depuis quelques années on recherche assez l’homme de lettres. Il a d’ailleurs de grands avantages ; il parle, il parle longtemps, il parle beaucoup, il parle pour tout le monde : et comme il fait profession d’intelligence, on peut l’écouter et l’admirer avec confiance.
Les femmes l’ont en grande faveur, en public et dans l’intimité. Il se divise en plusieurs classes.
L’écrivain sérieux, moraliste et philosophe est cantonné dans un certain nombre de salons dont il ne sort guère. Ces salons eux-mêmes sont de trois natures bien accentuées. Ils ont le ton Père de l’Église, le ton physiologie anglo-française, ou le ton voltairien modernisé. Dans ce monde-là on pontifie. Pour plus amples renseignements, s’adresser à M. Pailleron, bureau de la Comédie-Française.
Il est aussi dans Paris toute une série de femmes un peu arriérées qui s’attardent aux académiciens. L’académicien triompha sur tous ses rivaux voici quelques années. Aujourd’hui, on le trouve vieilli. Il passe de mode. Ses mots sont usés, sa verve sent l’Institut ; il a des plaisanteries de professeur en classe et des grâces pleines de latin. Puis, il ne procède pas à la manière moderne ; il se prodigue, ce qui est une faute capitale. Il est de vingt maisons, de vingt groupes, de vingt femmes ; il va de l’une à l’autre, voulant être aimable avec toutes, de sorte qu’aucune ne l’adopte ; et il est indispensable d’être adopté dans l’état actuel de la société parisienne.
On pourrait citer cependant trois ou quatre académiciens qui ne passent pas, qui ne passeront jamais, qui ne blanchissent pas en vieillissant, qui plaisent toujours comme ils plaisent et comme ils ont plu, grâce à de grandes qualités d’esprit, de gracieuseté, de courtoisie, de galanterie et de gaieté vraie.
Mais ils se prodiguent, c’est un danger. N’oublions jamais ce proverbe : « Qui trop embrasse, mal étreint. »
Ils se réunissent surtout chez de vieilles dames qui ont de la littérature comme on a des bonnets de douairière. En ces demeures à dissertations on traite toutes les questions imaginables avec une gravité qui donne à chaque discours l’allure d’une réception académique. On y livre autour de la table ou du guéridon de grands combats d’éloquence sur des sujets connus, éternellement les mêmes ; et les mêmes effets portent toujours.
Mais c’est là la vieille école. La jeune est plus astucieuse.
Toute femme connue, aujourd’hui, s’efforce d’avoir un écrivain, comme on avait jadis son singe.
Elle a le choix, d’abord, entre les poètes et les romanciers. Les poètes ont plus d’idéal, et les romanciers plus d’imprévu. Les poètes sont plus sentimentaux, les romanciers plus positifs. Affaire de goût et de tempérament. Le poète a plus de charme intime, le romancier plus d’esprit souvent. Mais le romancier présente des dangers qu’on ne rencontre pas chez le poète, il ronge, pille et exploite tout ce qu’il a sous les yeux. Avec lui on ne peut jamais être tranquille, jamais sûre qu’il ne vous couchera point, un jour, toute nue, entre les pages d’un livre. Son œil est comme une pompe qui absorbe tout, comme la main d’un voleur toujours en travail. Rien ne lui échappe ; il cueille et ramasse sans cesse ; il cueille les mouvements, les gestes, les intentions, tout ce qui passe et se passe devant lui ; il ramasse les moindres paroles, les moindres actes, les moindres choses. Il emmagasine du matin au soir des observations de toute nature dont il fait des histoires à vendre, des histoires qui courent au bout du monde, qui seront lues, discutées, commentées par des milliers et des milliers de personnes. Et ce qu’il y a de terrible, c’est qu’il fera ressemblant, le gredin, malgré lui, inconsciemment, parce qu’il voit juste et raconte ce qu’il a w. Malgré ses efforts et ses ruses pour déguiser les personnages on dira : « Avez-vous reconnu M. X… et Mme Y… ? Ils sont frappants. »
Certes il est aussi dangereux pour les gens du monde de choyer et d’attirer les romanciers, qu’il le serait pour un marchand de farine d’élever des rats dans son magasin.
Et pourtant ils sont en faveur.
Donc, quand une femme a jeté son dévolu sur l’écrivain qu’elle veut adopter, elle en fait le siège au moyen de compliments, d’attentions et de gâteries. Comme l’eau qui, goutte à goutte, perce le plus dur rocher, la louange tombe, à chaque mot, sur le cœur sensible de l’homme de lettres. Alors, dès qu’elle le voit attendri, ému, gagné par cette constante flatterie, elle l’isole, elle coupe, peu à peu les attaches qu’il pouvait avoir ailleurs, et l’habitue insensiblement à venir sans cesse chez elle, à s’y plaire, à y installer sa pensée. Pour le bien acclimater dans la maison, elle lui ménage et lui prépare des succès, le met en lumière, en vedette, lui témoigne devant tous les anciens habitués du lieu une considération marquée, une admiration sans égale.
Alors, se sentant idole, il reste dans ce temple. Il y trouve d’ailleurs tout avantage, car les autres femmes essayent sur lui leurs plus délicates faveurs pour l’arracher à celle qui l’a conquis. Mais s’il est habile, il ne cédera point aux sollicitations et aux coquetteries dont on l’accable. Et plus il se montrera fidèle, plus il sera poursuivi, prié, aimé. Oh ! Qu’il prenne garde de se laisser entraîner par toutes ces sirènes de salon ; il perdrait aussitôt les trois quarts de sa valeur s’il tombait dans la circulation.
Il forme bientôt un centre littéraire, une église dont il est le Dieu, le seul Dieu ; car les véritables religions n’ont jamais plusieurs divinités. On ira dans la maison pour le voir, l’entendre, l’admirer, comme on vient de très loin, en certains sanctuaires. On l’enviera, lui, et on l’enviera, elle ! Ils parleront des lettres comme les prêtres parlent des dogmes, avec science et gravité ; on les écoutera l’un et l’autre, et on aura, en sortant de ce salon lettré, la sensation de sortir d’une cathédrale !
Ite, missa est.
Que de choses encore on verrait en regardant de tout près ces amateurs d’artistes dont parle Daniel Darc. Mais puisque j’ai nommé ce charmant écrivain, je veux dire deux mots d’une question littéraire soulevée à son sujet.
Il publia, voilà cinq ans à présent, un remarquable roman, étude profonde et subtile de femme, histoire poignante d’une de ces redoutables créatures pour qui l’homme n’est qu’un être à exploiter et à vaincre. Le livre eut un grand succès.
Or, M. Adolphe Belot, ignorant l’existence de cette œuvre, vient de mettre en vente un roman sous le même titre : La Couleuvre . Il est certain qu’on ne pouvait exiger que M. Belot connût l’ouvrage de son confrère, mais on peut du moins s’étonner que l’éditeur n’ait point signalé à l’auteur cette regrettable coïncidence. Une de ces couleuvres assurément doit disparaître, car elles s’entredévoreraient. Mais laquelle doit rentrer dans la nuit ; la dernière venue sans aucun doute, la première ayant pour elle les droits inviolables du premier occupant en librairie. Le fait s’est d’ailleurs déjà produit et a toujours amené le même résultat : le changement de nom du dernier venu. En tout cas, cela est fort désagréable pour M. Daniel Darc, d’abord, et pour M. Belot ensuite. Un simple coup d’œil sur la liste des titres mis en vente depuis dix ans pourrait éviter tous ces ennuis, et toutes les contestations qui en résultent.
Читать дальше