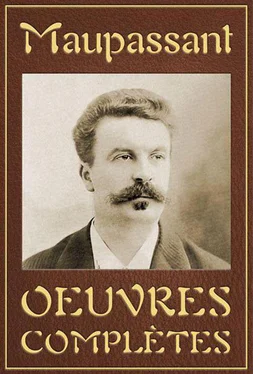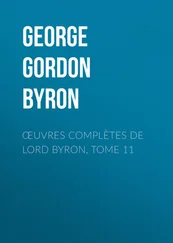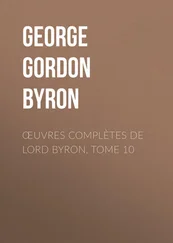[…] Et dans ma tombe impérissable
Je sens venir avec effroi
Les siècles lourds comme du sable
Qui s’amoncelle autour de moi.
Ah ! sois maudite, race impie,
Qui de l’être arrêtant l’essor
Garde ta laideur assoupie
Dans la vanité de la mort. »
Elle serait curieuse souvent à dire, l’histoire des corps des grands hommes. Et quelle ballade ferait un poète, un poète comme Victor Hugo, ou plutôt un conteur comme Edgar Poe, avec l’étrange aventure du cadavre de Paganini.
Quiconque a parcouru les côtes de la Méditerranée connaît ces deux îles charmantes qui séparent le golfe de Cannes du golfe Juan, et qu’on nomme les îles de Lérins.
Elles sont petites, basses, couvertes de pins et de fourrés. La première, Sainte-Marguerite, porte à son extrémité, vers la terre, la lourde forteresse où furent enfermés le Masque de Fer et Bazaine ; la seconde, Saint-Honorat, dresse dans les flots, à son extrémité, vers la pleine mer, un antique et superbe château crénelé, un vrai château de conte poétique, bâti dans la vague même, et où les moines autrefois se défendirent contre les Sarrasins, car Saint-Honorat appartint toujours à des moines, sauf pendant la Révolution ; elle fut achetée alors par une actrice des Français.
A quelques centaines de mètres au sud-est de l’île on aperçoit un îlot tout nu, presque à fleur d’eau, Saint-Ferréol. Ce récif est singulier, hérissé comme une bête furieuse, si couvert de pointes de roc, de dents et de griffes de pierre qu’on peut à peine marcher dessus : il faut poser le pied dans les creux, entre ces défenses, et aller avec précaution.
Un peu de terre venue on ne sait d’où s’est accumulée dans les trous et les fissures de la roche ; et là-dedans ont poussé des sortes de lis et de charmants iris bleus dont la graine semble tombée du ciel.
C’est sur cet écueil bizarre, en pleine mer, que fut enseveli et caché pendant cinq ans le corps de Paganini.
L’aventure est digne de la vie de cet artiste génial et macabre, qu’on disait possédé du diable, si étrange d’allures, de corps, de visage, dont le talent surhumain et la maigreur prodigieuse firent un être de légende, une espèce de personnage d’Hoffmann.
Comme il retournait à Gênes, sa patrie, accompagné de son fils, qui, seul maintenant, pouvait l’entendre tant sa voix était devenue faible, il mourut à Nice, du choléra, le 27 mai 1840.
Donc, son fils embarqua sur un navire le cadavre de son père et se dirigea vers l’Italie. Mais le clergé génois refusa de donner la sépulture à ce démoniaque. La cour de Rome, consultée, n’osa point accorder son autorisation. On allait cependant débarquer le corps lorsque la municipalité s’y opposa sous prétexte que l’artiste était mort du choléra. Gênes était alors ravagée par une épidémie de ce mal, mais on argua que la présence de ce nouveau cadavre pouvait aggraver le fléau.
Le fils de Paganini revint alors à Marseille, où l’entrée du port lui fut interdite pour les mêmes raisons. Puis, il se dirigea vers Cannes où il ne put pénétrer non plus.
Il restait donc en mer, berçant sur la vague le cadavre du grand artiste bizarre que les hommes repoussaient de partout. Il ne savait plus que faire, où aller, où porter ce mort sacré pour lui, quand il vit cette roche nue de Saint-Ferréol au milieu des flots. Il y fit débarquer le cercueil qui fut enfoui au milieu de l’îlot.
C’est seulement en 1845 qu’il revint avec deux amis chercher les restes de son père pour les transporter à Gênes, dans la villa Gajona.
N’aimerait-on pas mieux que l’extraordinaire violoniste fût demeuré sur l’écueil perdu, sur l’écueil hérissé où chante la vague dans les étranges découpures du roc ?
Les enfants
( Gil Blas , 23 juin 1885)
J’ai signalé dans une récente chronique les dangers de l’odieux système d’éducation suivi en France dans tous les établissements où l’on enferme la jeunesse.
J’ai reçu depuis ce jour tant de lettres sur ce sujet, que je m’y vois forcé d’y revenir. J’en ai reçu de médecins, d’hommes politiques, de mères, et enfin d’hommes connus et riches qui demandent si on ne pourrait former une sorte d’association, une ligue, et même une société pour fonder en France un établissement d’instruction où l’on s’occuperait au moins autant du corps que de l’esprit.
Un médecin m’écrit : « Il est incroyable, en effet, qu’on s’efforce, par tous les moyens les plus antinaturels, d’arrêter la croissance physique de l’homme. C’est ainsi qu’on arrive promptement à l’étiolement complet d’une race. La vie de l’enfant, depuis le jour où on l’emprisonne dans ces établissements malsains jusqu’au jour où il en sort, est une vraie torture pour lui. Voilà ce qu’il faudrait montrer à tout le monde, faire comprendre à toutes les familles. »
Et mon correspondant suit heure par heure, mois par mois, année par année l’existence de l’être, du petit être faible, au commencement de sa croissance, au moment où tout son corps subit le travail mystérieux du développement, où le sang a besoin de tous les éléments fortifiants qui donneront à la chair, aux muscles et aux organes la vigueur et la santé. Il le montre mal nourri, mal soigné, à peine lavé, presque jamais baigné, enfermé jour et nuit, étiolé par une besogne inutile que son esprit n’est pas encore apte à accomplir. Cet enfant a deux heures de liberté par jour, de liberté captive dans une cour entourée de murs, au milieu d’une ville, alors qu’il devrait jouer à son gré, à son aise, suivant le désir de la nature qui a mis en lui le besoin impérieux du jeu. Il devrait courir dans les bois, nager dans les fleuves, grimper des côtes, faire des armes, monter à cheval. Car tous les mouvements, tous les exercices sont nécessaires pour la formation complète de tous les membres, pour la solidification de tous les os, et aussi pour la fortification du courage viril.
Le lycée, le collège, la pension, tels que nous les comprenons, constituent le plus grand mal, la plus grande cause d’affaiblissement, de décadence de notre société moderne. Ils ne sont en réalité que des établissements publiant l’étiolement, où on courbature l’âme trop jeune en surmenant ses organes en formation, où on comprime la sève humaine en violentant la nature, en imposant à l’être qui grandit un esclavage stérile et épuisant, en arrêtant, pendant les seules années qui lui sont nécessaires, l’épanouissement de la force animale.
Un autre correspondant m’engage à regarder passer les gens dans la rue. « Sont-ce là des hommes, dit-il, tels qu’ils devraient être, de grands hommes, de beaux hommes aux bras forts, à la taille haute, à la poitrine large dont la vigueur apparaît à chaque mouvement ? Non. Ce sont des chétifs, des petits, des affaiblis, des tortus, des crochus, des ventrus, des bossus, des étiques. On n’en voit pas un sur dix qui ait la stature ou l’allure normales. Voyez-les marcher. Ils ont les jambes trop minces, ou le torse trop long, ou les bras démesurés, ou le cou de travers. Prenez-en vingt, mettez-les en face de vous, côte à côte, alignés et vous aurez une collection de caricatures à faire pleurer de rire car l’homme d’aujourd’hui n’est plus en réalité que la caricature de l’humanité. »
Il y a beaucoup de vrai là-dedans. La race est certainement faible et malade. Certes les gens qu’on rencontre dans les rues ne font pas songer aux hercules. On sent, à leur démarche, à la gaucherie visible de leurs mouvements, que ces bonshommes-là n’ont pas été développés, entraînés, fortifiés, exercés à toutes les besognes corporelles. D’où vient cela ? Du collège, de la pension, de l’enfance affaiblie dans les classes, entre les grands murs tristes de la cour, de l’immobilité de l’étude qui a fait dévier le cou, le dos, qui a remonté l’épaule droite, qui a fait s’allonger les bras au détriment des jambes, et qui a détruit lentement l’équilibre naturel toutes les parties du corps en croissance.
Читать дальше