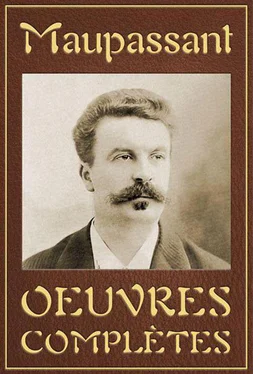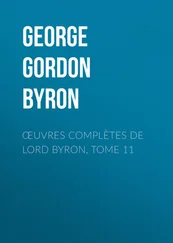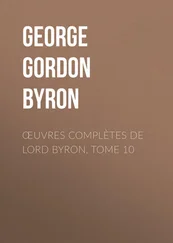« Elle venait, avec un lis dans chaque main,
La pente d’un rayon lui servant de chemin. »
Si, marchant le soir, par la campagne, nous entendons tout à coup quelque chien de ferme pousser vers l’astre placide sa plainte longue et sinistre, ne sommes-nous pas frappés brusquement par le souvenir de l’admirable pièce de Leconte de Lisle, Les Hurleurs ?
Puis aussitôt nous nous mettons à murmurer d’autres vers de l’impeccable et superbe poète, ceux lus dernièrement dans ses Poèmes tragiques :
« Par la chaîne d’or des étoiles vives
La lampe du ciel pend du sombre azur
Sur l’immense mer, les monts et les rives. »
Ou bien, un lamentable paysage surgit devant nous, avec un vieux loup blanchâtre levant vers la lune sa tête pointue :
« Les lourds rameaux neigeux du mélèze et de l’aune.
Un grand silence. Un ciel étincelant d’hiver.
Le roi du Harz, assis sur ses jarrets de fer,
Regarde resplendir la lune large et jaune.
Les gorges, les vallons, les forêts et les rocs
Dorment inertement sous leur blême suaire,
Et la face terrestre est comme un ossuaire
Immense, cave ou plane, ou bossué par blocs.
Tandis qu’éblouissant les horizons funèbres
La lune, œil d’or glacé, luit dans le morne azur,
L’angoisse du vieux loup étreint son cœur obscur,
Un âpre frisson court le long de ses vertèbres. »
C’est par un soir de rendez-vous. On va tout doucement dans le chemin, serrant la taille de la bien-aimée, lui prenant la main et lui baisant la tempe. Elle est un peu lasse, un peu émue et marche d’un pas fatigué.
Un banc apparaît, sous les feuilles que mouille comme une onde calme la douce lumière.
Est-ce qu’ils n’éclatent pas dans notre esprit, dans notre cœur, ainsi qu’une chanson d’amour exquise, les deux vers charmants :
« Et réveiller, pour s’asseoir à sa place,
Le clair de lune endormi sur le banc ! »
Peut-on voir le croissant dessiner, dans un grand ciel ensemencé d’astres, son fin profil, sans songer à la fin de ce chef-d’œuvre de Victor Hugo qui s’appelle Booz endormi :
« … Et Ruth se demandait,
Immobile, ouvrant l’œil à demi sous ses voiles,
Quel Dieu, quel moissonneur de l’éternel été,
Avait en s’en allant, négligemment jeté
Cette faucille d’or dans le champ des étoiles ! »
Et, puisque nous parlons de Victor Hugo, qui donc n’a jamais mieux chanté la belle nuit galante et divine :
« La nuit vint, tout se tut ; les flambeaux s’éteignirent ;
Dans les bois assombris, les sources se plaignirent,
Le rossignol, caché dans son nid ténébreux,
Chanta comme un poète et comme un amoureux.
Chacun se dispersa sous les profonds feuillages.
Les folles en riant entraînèrent les sages ;
L’amante s’en alla dans l’ombre avec l’amant ;
Et troublés comme on l’est en songe, vaguement,
Ils sentaient par degrés se mêler à leur âme,
A leurs discours secrets, à leurs regards de flamme,
A leurs cœurs, à leurs sens, à leur molle raison,
Le clair de lune bleu qui baignait l’horizon. »
Mais nous oublions les anciens poètes, et cette si admirable invocation de l’Ane, dans Apulée , qui termine le livre des Métamorphoses .
Et vraiment, si la terre, si les hommes doivent de la reconnaissance à notre douce voisine la Lune, elle n’a pas à se plaindre de la place que nos poètes lui ont faite dans nos cœurs.
Petits voyages
( Gil Blas , 26 août 1884)
Ceux qui aiment la terre, de cet amour profond, tendre et sensuel qu’on a pour les êtres, s’en vont parfois, seuls, pendant un mois ou deux, en quelque pays bien inconnu, bien sauvage, bien neuf, et ils le parcourent à pied, savourant heure par heure quelque chose de semblable au bonheur qu’on doit éprouver en possédant une vierge.
Elles sont rares aujourd’hui, les contrées inexplorées et désertes, surtout quand on ne veut point sortir de France. La Normandie est traversée par autant de promeneurs que le boulevard des Italiens. La vieille Bretagne cache un touriste, un odieux touriste, derrière chaque menhir. L’Auvergne abreuve à ses sources guérissantes des légions de malades qui rapportent des ballots de photographies prises sur les dômes, les pics et les plombs.
Où aller ? Il est pourtant en France tout un petit pays, bien solitaire et bien beau, qu’on nomme les montagnes des Maures. Un chemin de fer le traversera demain. Passons avant lui dans ces vallons ignores, incultes, inhabités, où s’élèveront sans doute bientôt autant de villas que sur les rivages de Cannes et de Menton.
Où sont-elles, ces montagnes ? Dans la contrée la plus connue et la plus parcourue de France : entre Hyères et Saint-Raphaël. Les géographes nous apprennent qu’elles possèdent à elles seules un système géologique complet. Elles ont toutes les divisions, toutes les parties, tous les organes de leurs grandes sueurs les Alpes et les Pyrénées.
Leur flore est des plus riches de France. Au midi, la Méditerranée baigne leurs côtes où se suivent d’admirables plages. Au nord, un beau fleuve, l’Argens, les sépare du reste du monde.
Il y a six mois, quand les baigneurs de Saint-Raphaël se promenaient sur la longue dune qui contourne le golfe de Fréjus, ils arrivaient, au bout d’une heure de marche, au bord d’un large cours d’eau dont l’embouchure ensablée permettait parfois de passer à pied sec.
Quand on suivait ce fleuve en remontant vers sa source, on s’avançait au milieu d’une sorte d’immense marécage boisé et cultivé par places. On allait à travers des bouquets d’arbres, à travers des taillis épais d’où s’envolaient à tout instant des canards sauvages, des bécassines, des buses aux larges ailes et des nuées de pigeons ramiers.
Puis, après avoir reconnu qu’il était impossible de traverser ce large cours d’eau dont les berges disparaissent sous des bois de roseaux, on revenait par le même chemin en se demandant quel pays inconnu s’étendait derrière. Et on regardait dans la brume rose du couchant la grande ligne des montagnes bleuâtres couvertes de sapins, déroulant à perte de vue leurs cimes pointues et bosselées vers l’ouest.
Aujourd’hui, un pont de bois traverse l’Argens. Voici l’histoire de ce pont.
Sous l’Empire, une route fut commencée, qui devait relier Saint-Tropez, situé à l’extrémité de la presqu’île des Maures, à Saint-Raphaël.
On fit cette route jusqu’à l’Argens. L’Empire tomba, la République fut proclamée, et les travaux furent arrêtés. Il ne restait plus qu’à jeter un pont sur le fleuve. On ne le construisit pas.
On avait donc un beau ruban de chemin de trente-cinq à quarante kilomètres absolument inutile et parfaitement entretenu. Aucune voiture ne passait sur cette route sans issue ; mais les cantonniers l’empierraient, la nivelaient et la nettoyaient pour employer les fonds destinés à l’entretien d’une voie existante.
Cela dura douze ans. Puis, comme cet état de choses menaçait de continuer jusqu’à une restauration impériale, une quinzaine de propriétaires du golfe de Grimaud se réunirent, donnèrent mille francs chacun et firent un pont de bois à l’américaine.
Читать дальше