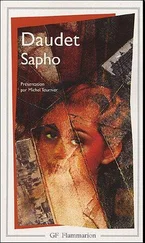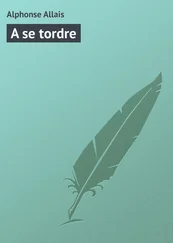Le docteur était là, très occupé à faire une caisse de livres.
– Ah! te voilà! dit-il à l’enfant, j’étais bien sûr que tu ne partirais pas sans me dire adieu. Ils ne voulaient pas te laisser venir, hein? C’est un peu ma faute aussi. J’ai été trop vif. Ma femme m’a joliment grondé… À propos, tu sais qu’elle est partie hier avec la petite. Je les ai envoyées dans les Pyrénées passer un mois chez ma sœur. Elle était un peu malade, la petite. J’ai eu la bêtise de lui apprendre ton départ tout à coup, sans ménagement… Ah! les enfants!… On croit qu’ils ne sentent pas les choses; et ça vous a des chagrins autrement violents que les nôtres.
Il parlait à Jack comme à un homme. Tout le monde lui parlait comme à un homme, à présent; et pourtant, à l’idée que sa petite amie avait été malade à cause de lui et qu’il s’en irait sans la voir, le vieux Jack se sentait envie de pleurer comme un enfant.
Il regardait les livres répandus, la grande pièce toute triste, mal éclairée d’une bougie posée sur un coin de table à côté du grog et de la bouteille d’eau-de-vie; car M. Rivals profitait de l’absence de sa femme pour revenir à ses habitudes de bord. Aussi avait-il l’œil brillant, le bonhomme, et une singulière animation à fouiller dans tous ses livres, soufflant la poussière sur les vieilles tranches rouges, et vidant tout un coin de sa bibliothèque dans la caisse ouverte à ses pieds.
– Sais-tu ce que je fais là, petit?
– Non, monsieur Rivals.
– Je choisis des livres pour toi, de bons vieux bouquins que tu emporteras, que tu liras, tu m’entends! que tu liras dès que tu auras une minute. Rappelle-toi bien ceci, mon enfant: les livres sont les vrais amis. On peut s’adresser à eux dans les grands chagrins de la vie, on est toujours sûr de les trouver. Moi d’abord, sans mes bouquins, avec le malheur que j’ai eu, il y a beau temps que je ne serais plus là. Regarde-moi cette caisse, petit. Il y en a une vraie tapée, hein?… Je ne te réponds pas que tu les comprendras tous maintenant. Mais ça ne fait rien, il faut les lire. Même ceux que tu ne comprendras pas te laisseront de la lumière dans l’esprit. Promets-moi que tu les liras.
– Je vous le promets, monsieur Rivals.
– Là… maintenant la caisse est finie. Peux-tu l’emporter? Non, c’est trop lourd. Je t’enverrai cela demain. Allons! viens que je te dise adieu.
Et le brave homme, lui prenant la tête dans ses larges mains, l’embrassa deux ou trois fois bien fort.
– Il y en a pour moi et pour Cécile là-dedans, ajouta-t-il avec un bon sourire, et tandis qu’il refermait sa porte, Jack l’entendit qui murmurait: «Pauvre enfant!… pauvre enfant!…»
C’était comme à Vaugirard, chez les Pères. Seulement, aujourd’hui, il savait pourquoi on le plaignait.
Le lendemain, le départ avait mis les Aulnettes en grande agitation.
On chargeait les bagages sur la charrette arrêtée à la porte. Labassindre, dans une tenue extraordinaire, comme s’il partait pour une expédition à travers les pampas, hautes guêtres montantes, veste de velours vert, sombrero, sacoche de cuir en sautoir, allait, venait, en donnant sa note. Le poète était à la fois grave et rayonnant, grave parce qu’il se sentait dans l’accomplissement d’une fonction humanitaire, sociale; rayonnant, parce que ce départ le comblait de joie. Charlotte embrassait Jack, l’embrassait encore, voyait si rien ne lui manquait.
Non, rien ne lui manquait. Il était même trop bien mis pour un ouvrier, étriqué dans son costume du pain bénit, avec cette fatalité des êtres qui grandissent vite, condamnés pendant leur adolescence à la gêne des vêtements trop courts.
– Vous en aurez bien soin, monsieur Labassindre!
– Comme de ma note, madame.
– Jack!
– Maman!
Il y eut une dernière étreinte. Charlotte sanglotait. L’enfant, lui, ne laissait pas voir son émotion. La pensée qu’il allait travailler pour sa mère le rendait fort, ce vieux Jack. Au bas du chemin, il se retourna pour voir encore une fois et emporter au fond de son regard le bois, la maison, l’enclos, ce visage de femme qui lui souriait parmi ses pleurs.
– Écris-nous souvent, mon Jack! cria la mère.
Et le poète avec solennité:
– Jack, souviens-toi: la vie n’est pas un roman.
La vie n’est pas un roman; mais elle en était bien un pour lui, le misérable!
Il n’y avait qu’à le voir au seuil de sa petite maison à devise, appuyé sur sa Charlotte, au milieu des rosiers de la façade, dans une pose prétentieuse comme une lithographie de romance, et tellement épanoui d’égoïsme satisfait qu’il en oubliait sa haine et envoyait de la main un adieu paternel et bénisseur à l’enfant qu’il venait de chasser.
FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.
Le chanteur se leva tout debout dans la barque où l’enfant et lui passaient la Loire un peu au-dessus de Paimbœuf, et embrassant le fleuve d’un geste emphatique:
– Regarde-moi ça, mon vieux Jack, si c’est beau!
Malgré ce qu’il y avait de grotesque et de convenu dans cette admiration de cabotin, elle se trouvait justifiée par le paysage admirable qui se développait sous ses yeux.
Il était environ quatre heures du soir. Un soleil de juillet, un soleil d’argent en fusion, étalait sur les vagues la longue traîne lumineuse de son rayonnement. Cela faisait dans l’air une réverbération palpitante, comme une brume de lumière où la vie du fleuve, active, silencieuse, apparaissait avec des rapidités de mirage. De hautes voiles entrevues, qui semblaient blondes dans cette heure éblouissante, passaient au loin comme envolées. C’étaient de grandes barques venant de Noirmoutiers, chargées jusqu’au bord d’un sel blanc étincelant de mille paillettes, et montées par de pittoresques équipages: des hommes avec le grand tricorne des saulniers bretons, des femmes dont les coiffes étoffées, papillonnantes, avaient la blancheur et le scintillement du sel. Puis, des caboteurs, pareils à des haquets flottants, leur pont tout encombré de sacs de blé, de futailles; des remorqueurs, traînant d’interminables files de barques, ou bien quelque trois-mâts nantais arrivant du bout du monde, rentrant au pays après deux ans d’absence et remontant le fleuve d’un mouvement lent, presque solennel, comme s’il portait avec lui le recueillement silencieux de la patrie retrouvée et la poésie mystérieuse des choses venues de loin. Malgré la chaleur de juillet, un grand souffle courait dans tout ce beau décor, car le vent arrivait de la mer avec la fraîcheur et la gaieté du large, et faisait deviner un peu plus loin, au delà de ces flots serrés que le calme, la tranquillité des eaux douces abandonnait déjà, le vert de l’Océan sans limites, et des vagues, des embruns, des tempêtes.
– Et Indret? où est-ce?… demanda Jack.
– Là. Cette île en face de nous.
Dans le brouillard d’argent qui enveloppait l’île, Jack voyait confusément de grands peupliers en files et de longues cheminées d’où montait une épaisse fumée noire, étalée, répandue, qui salissait le ciel au-dessus d’elle. En même temps, il entendait un vacarme retentissant, des coups de marteaux sur du fer, sur de la tôle, des bruits sourds, d’autres plus clairs, diversement répercutés par la sonorité de l’eau, et surtout un ronflement continu, perpétuel, comme si l’île eût été un immense steamer arrêté et grondant, activant ses roues à l’ancre et son mouvement dans l’immobilité.
À mesure que la barque approchait, lentement, très lentement, parce que le fleuve était gros et dur à passer, l’enfant distinguait de longs bâtiments aux toitures basses, aux murailles noircies, s’étendant de tous les côtés avec une platitude uniforme, puis, sur les bords du fleuve, à perte de vue, d’énormes chaudières alignées, peintes au minium, et dont le rouge éclatant faisait un effet fantastique. Des transports de l’État, des chaloupes à vapeur, rangés au quai, attendaient qu’on chargeât ces chaudières à l’aide d’une énorme grue placée près de là et qui de loin ressemblait à un gibet gigantesque.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу