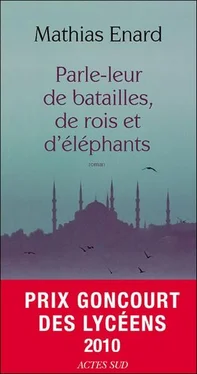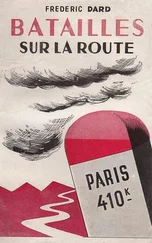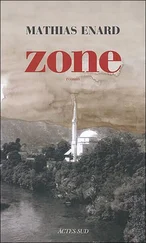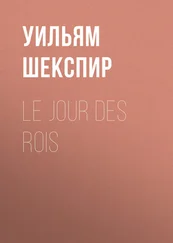Je n'ai pas d'amertume. Un pâle soleil d'hiver éclaire aujourd'hui l'Andalousie. Les choses passent.
On parle de Nouveau Monde ; on raconte qu'au-delà des mers se trouvent des pays infiniment riches que les Francs conquièrent. Les astres se détournent de nous ; ils nous plongent dans la pénombre. La lumière s'en va de l'autre côté de la terre, qui sait quand elle reviendra. Je ne te connais pas, étranger. Tu ne sais rien de moi, nous n'avons que la nuit en commun. Nous partageons ce moment, malgré nous. Malgré les coups que nous nous sommes portés, les choses détruites, je suis contre toi dans le noir. Je ne vais pas t'entretenir avec mes contes jusqu'à l'aurore. Je ne te parlerai ni de bons génies, ni de goules terrifiantes, ni de voyages dans des îles dangereuses. Laisse-toi faire. Oublie ta peur, profite de ce que je suis, comme toi, un morceau de chair qui n'appartient à personne sinon à Dieu. Prends un peu de ma beauté, du parfum de ma peau. On te l'offre. Ce ne sera ni une trahison, ni un serment ; ni une défaite, ni une victoire.
Juste deux mains s'emprisonnant, comme des lèvres se pressent sans s'unir jamais.
Manuel le traducteur rend chaque matin visite Michel-Ange pour lui demander s'il n'a besoin de rien, s'il peut l'accompagner quelque part ; le plu souvent il trouve le sculpteur occupé à dessiner, ou bien à dresser une de ses innombrables listes dan son carnet. Parfois, il a la chance de pouvoir observer le Florentin alors qu'il trace, à l'encre ou au plomb une étude d'anatomie, le détail d'un ornement d'architecture.
Manuel est fasciné.
Amusé par son intérêt, Michel-Ange crâne. Il lu demande de poser la main sur la table et, en deux minutes, il esquisse le poignet, toute la complexité des doigts recourbés et la pulpe des phalanges.
— C'est un miracle, maître, souffle Manuel. Michelangelo part d'un grand éclat de rire.
— Un miracle ? Non mon ami. C'est pur génie je n'ai pas besoin de Dieu pour cela.
Manuel reste interloqué.
— Je me moque de toi, Manuel. C'est du travail avant tout. Le talent n'est rien sans travail. Essaie si tu veux.
Manuel secoue la tête, paniqué.
— Mais je ne sais pas, maestro, j'ignore tout du dessin.
— Je vais te dire comment apprendre. Il n'y a pas d'autre façon. Appuie ton bras gauche sur la table devant toi, la main à demi ouverte, le pouce détendu, et avec la droite dessine ce que tu vois, une fois, deux fois, trois fois, mille fois. Tu n'as pas besoin de modèle ni de maître. Il y a tout dans une main. Des os, des mouvements, des matières, des proportions et même des drapés. Fais confiance à ton œil. Recommence jusqu'à ce que tu saches. Puis tu feras la même chose avec ton pied, en le posant sur un tabouret ; puis avec ton visage, grâce à un miroir. Ensuite seulement tu pourras passer à un modèle, pour les postures.
— Vous croyez qu'il est possible d'y arriver, maestro ? Ici personne ne dessine comme ça. Les icônes…
Michel-Ange l'interrompt durement.
— Les icônes sont des images d'enfants, Manuel. Peintes par des enfants pour des enfants. Je t'assure, suis mes conseils et tu verras que tu dessineras. Après tu pourras t'amuser à copier des icônes autant que tu voudras.
— Je vais essayer, maestro. Souhaitez-vous que nous allions nous promener ou visiter un monument ?
— Non Manuel, pas pour le moment. Je suis bien ici, la lumière est parfaite, il n'y a pas d'ombres sur ma page, je travaille, je n'ai besoin de rien d'autre, je te remercie.
— Bien. Demain nous irons voir votre atelier. A bientôt donc.
Et le drogman grec se retire, en se demandant s'il va oser poser la main sur la table et se mettre à dessiner lui aussi.
L'atelier se trouve dans les dépendances de l'ancien palais des sultans, à deux pas d'une mosquée grandiose dont le chantier vient d'être achevé. Le secrétaire poète Mesihi, le page Falachi et Manuel ont accompagné Michel-Ange prendre possession des lieux, un peu inquiets des réactions de l'artiste.
Une salle haute, voûtée, meublée d'une foule de dessinateurs et d'ingénieurs, en rangs devant de grandes tables encombrées de dessins et de plans.
Des maquettes sur des présentoirs, plusieurs maquettes différentes d'un ouvrage étrange, un pont singulier, deux paraboles qui fabriquent un tablier à leur asymptote, soutenues par une arche unique, un peu comme un chat qui ferait le dos rond.
Voici votre royaume et vos sujets, maestro, dit Falachi. Mesihi ajoute une formule de bienvenue que Michel-Ange n'entend pas. Son regard est fixé sur les maquettes.
— Il s'agit de modèles réalisés à partir du dessin proposé par Léonard de Vinci, maestro. Les ingénieurs l'ont jugé inventif, mais impossible à construire et, comment dire, le sultan l'a trouvé plutôt… plutôt laid, malgré sa légèreté.
Si le grand Vinci n'a rien compris à la sculpture, eh bien il ne comprend rien non plus à l'architecture.
Michel-Ange le génie s'approche du projet de son si célèbre aîné ; il l'observe une minute, puis, d'une gigantesque gifle, le précipite à bas du socle ; l'édifice de bois collé retombe sur ses quatre pattes sans se briser.
Le sculpteur pose alors sa galoche droite sur le modèle réduit, et l'écrase rageusement.
Le pont sur la Corne d'Or doit unir deux forteresses, c'est un pont royal, un pont qui, de deux rives que tout oppose, fabriquera une ville immense. Le dessin de Léonard de Vinci est ingénieux. Le dessin de Léonard de Vinci est si novateur qu'il effraie. Le dessin de Léonard de Vinci n'a aucun intérêt car il ne pense ni au sultan, ni à la ville, ni à la forteresse. D'instinct, Michel-Ange sait qu'il ira bien plus loin, qu'il réussira, parce qu'il a vu Constantinople, parce qu'il a compris que l'ouvrage qu'on lui demande n'est pas une passerelle vertigineuse, mais le ciment d'une cité, de la cité des empereurs et des sultans. Un pont militaire, un pont commercial, un pont religieux.
Un pont politique.
Un morceau d'urbanité.
Les ingénieurs, les maquettistes, Mesihi, Falachi et Manuel ont les yeux rivés sur Michel-Ange, comme on regarde une bombarde la mèche allumée. Ils attendent que l'artiste se calme.
Ce qu'il fait. Son regard pétille, il sourit, on dirait qu'il vient de sortir d'un songe trop agité.
Il écarte du pied les débris de la maquette, puis dit calmement :
— Cet atelier est magnifique. Au travail. Manuel, emmène-moi voir la basilique Sainte-Sophie, s'il te plaît.
Le 18 mai 1506 Michelangelo Buonarroti, debout sur la brève esplanade, observe l'église qui, cinquante ans plus tôt, était encore le centre de la chrétienté. Il pense à Constantin, à Justinien, à la pourpre des empereurs et aux croisés plus ou moins barbares qui y entrèrent à cheval pour en ressortir chargés de reliques ; il repensera, vingt ans plus tard, au moment de dessiner un dôme pour la basilique Saint-Pierre de Rome, à la coupole de cette Sainte-Sophie dont il aperçoit le profil depuis la place où les Stambouliotes se pressent pour la prière de l'après-midi, guidés par l'horloge humaine du muezzin.
A ses côtés, Mesihi, l'enfant de Pristina, se rappelle peut-être lui aussi son émotion en arrivant pour la première fois à Constantinople, à Istanbul, depuis peu résidence du sultan et capitale de l'Empire ; toujours est-il qu'il prend le sculpteur par le bras et lui dit, en désignant les fidèles qui passent dans l'immense narthex du bâtiment :
— Suivons-les, maestro.
Et Michel-Ange, aidé par la main du poète et la fascination qu'exerce sur lui le sublime édifice, surmonte sa peur et son dégoût des choses musulmanes pour y pénétrer.
Читать дальше