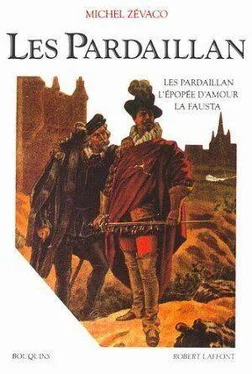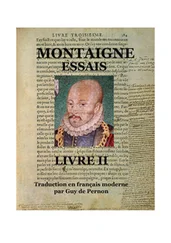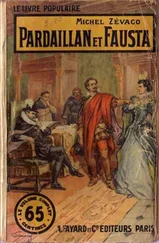Il se mit à rire. Il était radieux que les choses s’arrangeassent ainsi.
– À propos, fit-il, où demeure madame votre tante?
– Rue de la Hache, répondit-elle sans hésitation.
– Près de l’hôtel de la reine? s’écria-t-il en tressaillant.
– C’est cela même. Non loin de la tour du nouvel hôtel. Vous verrez, presque au coin de la rue de la Hache et de la rue Traversine, une petite maison en retrait, avec une porte peinte en vert. C’est là…
– Si près du Louvre! si près de la reine! murmura sourdement le comte… Mais de quoi vais-je m’inquiéter là?…
Et l’aubergiste étant apparu, il s’occupa de faire servir un déjeuner sommaire à la jeune fille. Ils se mirent à table. Elle mangea de bon appétit. Ce fut une heure charmante.
Enfin, Déodat monta à cheval et prit Alice en croupe, comme cela se pratiquait couramment. La jeune fille était habituée à la manœuvre. Le comte put prendre un trot assez rapide et, vers huit heures du matin, il entra dans Paris.
Bientôt il atteignit la rue de la Hache et déposa sa compagne devant la maison signalée. Elle s’élevait en effet à quelques pas de la colonne dorique que Catherine de Médicis avait fait élever pour Ruggieri.
Quelques têtes curieuses apparurent aux environs; le jeune homme salua gravement Alice de Lux, en même temps que, des yeux, il lui envoyait un au revoir passionné.
Puis il s’éloigna sans plus se retourner.
Alice l’accompagna du regard jusqu’à ce qu’il eût tourné au coin.
Alors elle poussa un profond soupir; toute la force d’âme qui l’avait soutenue jusque-là tomba d’un coup.
Défaillante, elle heurta le marteau de la porte verte et murmura:
– Adieu, peut-être à jamais, rêve d’amour, rêve de pureté, rêve de bonheur…
La porte s’ouvrit. La jeune fille traversa une sorte de jardinet profond de sept à huit pas, et pénétra dans la maison qui se composait d’un rez-de-chaussée et d’un étage. Un mur assez élevé, dans lequel s’ouvrait la porte verte, séparait le jardin de la rue de la Hache – ruelle plutôt, voie étroite, paisible, tourmentée pendant trois ans par les bruits des maçons qui avaient travaillé à l’hôtel de la Reine, mais retombée maintenant à la paix et au silence, au point que le passage d’un cavalier y faisait sensation, comme nous venons de le voir.
Si la rue, en raison de ce silence, en raison de l’ombre que projetait la grande bâtisse de la reine Catherine, paraissait assez mystérieuse, la maison l’était davantage encore.
Personne n’y entrait jamais.
Une femme d’une cinquantaine d’années l’habitait seule.
On n’eût su dire si cette femme était là à titre de servante, de gouvernante ou de propriétaire.
Elle était connue dans le quartier sous le nom de dame Laura. Elle était toujours proprement vêtue, et même avec une certaine recherche. Elle causait peu. Quand elle sortait, elle se glissait silencieusement le long des murs, et ses sorties avaient toujours lieu de grand matin ou bien au crépuscule.
On en avait un peu peur, bien qu’elle parût bonne personne, et que, le dimanche, elle assistât très régulièrement à la messe et aux offices.
Enfin, c’était un de ces êtres bizarres dont on parle beaucoup dans un quartier, justement parce qu’il n’y a rien à en dire. Quand à son nom à désinence italienne, il ne pouvait être un sujet de défiance, la reine Catherine étant elle-même florentine.
Laura, en voyant entrer Alice, n’eut pas un geste de surprise. Il y avait pourtant près de dix mois que la jeune fille n’était venue dans la maison. Peut-être s’attendait-elle à ce retour.
– Vous voilà, Alice! dit-elle sans émotion.
– Brisée, meurtrie, ma bonne Laura, fatiguée, d’âme et de corps, écœurée de mon infamie, dégoûtée de vivre…
– Allons, allons! Vous voilà partie encore… Vous êtes toujours la même… exaltée, vous effarant d’un rien.
– Prépare-moi un peu de cet élixir dont tu me donnais autrefois.
– Oui. Et ne mangeriez-vous pas?
– Je n’ai pas faim.
– Mauvais signe chez une femme comme vous, fit la vieille en versant dans un gobelet d’argent quelques gouttes d’une bouteille qu’elle tira d’une armoire.
Alice absorba d’un trait la boisson qui venait de lui être préparée. Elle parut en éprouver aussitôt une sorte de bien-être, et ses lèvres pâlies reprirent leurs couleurs.
Elle se déshabilla et passa un vêtement d’intérieur, en laine blanche, serré à la taille par une cordelière de soie.
Alors, elle examina toutes choses autour d’elle, comme si elle eût pris plaisir à refaire connaissance avec cet intérieur.
Ses yeux, tout à coup, tombèrent sur un portrait.
Elle tressaillit et le contempla longuement.
Laura la regardait et suivait chacun de ses mouvements avec un intérêt marqué. Il était évident qu’elle était plus qu’une servante. Peut-être y avait-il entre ces deux femmes quelque mystérieux lien, car Alice paraissait n’avoir rien de caché pour la vieille.
Au bout de quelques minutes de cette contemplation, Alice montra le portrait à Laura.
– Il faut enlever cette toile, dit-elle.
– Pour la mettre dans votre chambre à coucher? fit la vieille avec un sourire qui eût pu paraître cynique.
– Pour la détruire! fit Alice en rougissant. Détruis-la tout de suite, devant moi…
– Pauvre maréchal! grommela Laura qui, montant sur une chaise, décrocha le tableau.
Bientôt elle eut décloué la toile; et elle la déchira en morceaux qu’elle jeta dans le feu.
Alice avait assisté sans dire un mot à cette exécution qu’elle venait d’ordonner.
Alors elle se laissa tomber dans un grand fauteuil et tendit ses mains à la flamme, comme s’il eût fait grand froid.
– Laura, dit-elle avec une sorte d’embarras, il viendra ici, vendredi soir, un jeune homme…
La vieille qui, un sourire étrange au coin des lèvres, regardait se consumer les derniers fragments du portrait, ramena son regard sur la jeune fille. Et cette fois, dans ses yeux, elle s’efforçait de mettre une expression de pitié.
– Pourquoi me regardes-tu ainsi? fit Alice. Tu me plains, n’est-ce pas? Eh bien, oui, je suis à plaindre en effet… Mais écoute-moi bien… ce jeune homme viendra tous les lundis et tous les vendredis…
– Comme l’autre! dit Laura en attisant le feu.
– Oui! comme l’autre… puisque les lundis et les vendredis sont les seuls jours où je suis libre… Tu comprends ce que j’attends de toi, n’est-ce pas, ma bonne Laura?
– Je comprends très bien, Alice. Je redeviens votre parente… votre vieille cousine?
– Non, j’ai dit que tu es ma tante.
– Bien. Je monte en grade. Votre nouvel amoureux doit être plus important que ce pauvre maréchal de Damville.
– Tais-toi, Laura! fit sourdement Alice. Henri de Montmorency n’était que mon amant.
– Et celui-ci?
– Celui-ci… je l’aime!…
– Et l’autre! non le maréchal… mais le premier, ne l’aimiez-vous pas aussi?
Alice pâlit.
– Le marquis de Pani-Garola! murmura-t-elle.
– Eh oui, ce digne marquis! À propos, savez-vous ce qu’il devient?
– Comment le saurais-je?
– Il est entré en religion.
Alice jeta un léger cri.
– Cela vous étonne, n’est-ce pas? Cela est pourtant! Ce diable à quatre, ce pourfendeur, ce spadassin, ce héros de toutes les orgies, eh bien, c’est maintenant un digne carme… Moine à vingt-quatre ans! qui eût dit cela du brillant marquis!… Hier, il a prêché contre les huguenots.
– Moine! Le marquis de Pani-Garola! murmura Alice.
Читать дальше