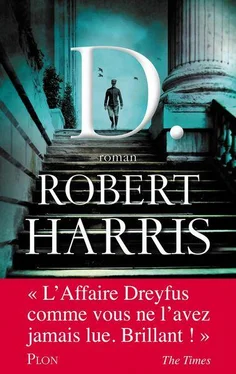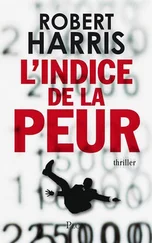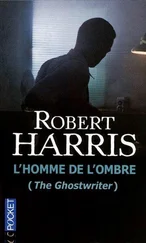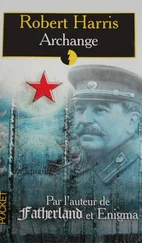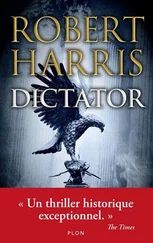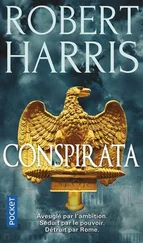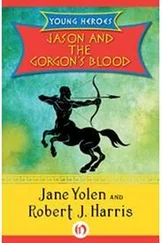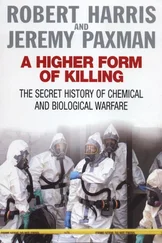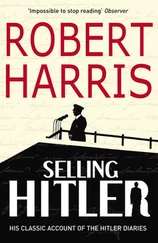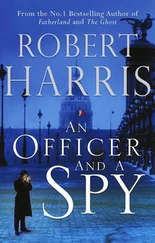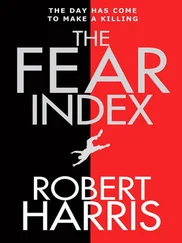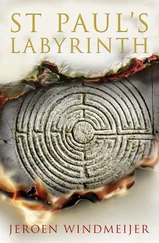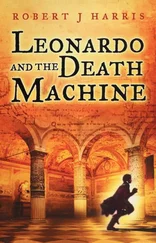— Est-il encore à Paris ?
— Mon cher commandant, comment voulez-vous que je le sache ?
— Je ne comprends pas bien, dis-je. Pourquoi Dreyfus aurait-il avoué sa culpabilité à un complet étranger, à un tel moment, sans qu’il n’ait plus rien à y gagner, alors qu’il nie tout depuis trois mois ?
— Je ne peux rien pour vous, assure le colonel, qui jette par-dessus son épaule un regard en direction de son déjeuner.
— Et s’il venait de confesser son crime au capitaine Lebrun-Renault, pourquoi n’a-t-il cessé ensuite de proclamer son innocence devant des milliers de personnes hostiles ?
Le colonel carre les épaules.
— Seriez-vous en train de traiter l’un de mes officiers de menteur ?
— Merci, mon colonel, dis-je en rangeant mon calepin.
De retour au ministère, je me rends directement au cabinet de Gonse. Il travaille sur une pile de dossiers. Il hisse ses bottes sur sa table et s’incline dans son fauteuil pour écouter mon rapport.
— Alors, vous ne pensez pas qu’il y ait de quoi poursuivre ?
— Non, en effet. Pas maintenant que j’ai eu connaissance des détails. Il est vraisemblable que cet imbécile de capitaine de la garde a dû mal comprendre. Ou alors, il a raconté des fables pour faire l’important auprès de ses collègues. Évidemment, ajouté-je, c’est en supposant que Dreyfus n’était pas un agent double envoyé espionner les Allemands.
Gonse s’esclaffe et allume une nouvelle cigarette.
— Si ça pouvait être vrai !
— Que voulez-vous que je fasse, mon général ?
— Je ne vois pas grand-chose que vous puissiez faire.
— Bien sûr, il y aurait bien une façon d’obtenir une réponse définitive, avancé-je après une hésitation.
— Et ce serait ?
— Nous pourrions interroger Dreyfus.
Gonse secoue la tête.
— C’est absolument exclu. Il n’est plus possible de communiquer avec lui. En outre, il sera bientôt envoyé hors de Paris.
Il soulève ses pieds de la table et les repose par terre. Puis il tire la pile de dossiers à lui. La cendre de sa cigarette tombe sur le devant de sa tunique.
— Laissez-moi agir. J’irai expliquer la chose au chef d’état-major et au ministre, assure-t-il en ouvrant un dossier qu’il fait mine d’examiner. Merci, commandant Picquart. Vous pouvez disposer, ajoute-t-il sans lever les yeux.
Ce soir-là, je me rends en civil à Versailles afin de voir ma mère. Le train plein de courants d’air bringuebale à travers des banlieues parisiennes étrangement façonnées par la neige et les becs de gaz. Le trajet me prend près d’une heure ; j’ai la voiture pour moi. J’essaie de lire un roman, L’Adolescent , de Dostoïevski, mais dès que l’on franchit des dispositifs d’aiguillage, les lumières s’éteignent et je perds ma ligne. Dans la lueur bleue de l’éclairage d’urgence, je regarde dehors et m’imagine Dreyfus dans sa cellule de la Santé. Les condamnés sont transportés par chemin de fer, dans des wagons à bestiaux reconvertis. Je présume qu’on va l’envoyer dans l’ouest, dans un port de l’Atlantique pour y attendre sa déportation. Avec cette météo, le voyage sera un enfer. Je ferme les yeux et tente de m’assoupir.
Ma mère dispose d’un petit appartement dans une rue moderne, non loin de la gare de Versailles. Elle a soixante-dix-sept ans et vit seule, veuve depuis près de trente ans. Nous nous relayons, ma sœur et moi, pour aller la voir. Anna est plus âgée que moi et a des enfants, ce qui n’est pas mon cas : mon tour tombe toujours le samedi soir, seul moment où je suis sûr de pouvoir quitter le ministère.
Il fait nuit depuis longtemps lorsque j’arrive enfin ; la température doit avoisiner les moins dix. Ma mère crie derrière sa porte verrouillée :
— Qui est là ?
— C’est Georges, maman.
— Qui ça ?
— Georges, maman, votre fils.
Il me faut une minute pour la convaincre de me laisser entrer. Parfois, elle me prend pour mon frère aîné, Paul, qui est mort depuis cinq ans ; d’autres fois — et, curieusement, cela est pire — elle me prend pour mon père, qui est mort alors que j’avais onze ans. (Une autre sœur est morte avant ma naissance, un frère aussi n’a vécu que onze jours ; il y a une chose qu’il faut reconnaître à la sénilité : depuis qu’elle a perdu l’esprit, ma mère ne manque pas de compagnie.)
Le pain et le lait sont des blocs de glace ; les canalisations sont complètement gelées. Je passe la première demi-heure à allumer les cheminées pour essayer de réchauffer l’appartement, et la seconde couché par terre à réparer une fuite. Nous mangeons un bœuf bourguignon, que la domestique qui vient une fois par jour a acheté chez le traiteur du coin. Maman se remet ; elle semble même se rappeler qui je suis. Je lui raconte ce que je fais, mais ne lui parle ni de Dreyfus ni de la dégradation : elle aurait trop de mal à comprendre de quoi il s’agit. Plus tard, nous nous installons au piano, qui occupe la majeure partie de son salon minuscule, et jouons en duo le Rondo de Chopin. Son jeu est impeccable ; la partie musicale de son cerveau demeure intacte ; ce sera la dernière faculté à l’abandonner. Une fois qu’elle est partie se coucher, je m’attarde sur le tabouret et contemple les photographies posées sur le piano. Les portraits de famille solennels à Strasbourg, le jardin du château de Geudertheim, une miniature de ma mère lorsqu’elle était élève au conservatoire, un pique-nique dans les bois de Neudorf — autant de vestiges d’un monde disparu, l’Atlantide que nous avons perdue à la guerre.
J’avais seize ans quand les Allemands bombardèrent Strasbourg, me donnant ainsi le privilège d’assister personnellement à un événement que l’on présente à l’École supérieure de guerre comme « la première utilisation à grande échelle de l’artillerie lourde moderne dans le but précis de réduire une population civile ». J’assistai à l’incendie du musée des Beaux-Arts et de la bibliothèque municipale, vis tout le voisinage se faire pulvériser, m’agenouillai auprès d’amis agonisants, aidai à dégager des gens que je ne connaissais pas des décombres. Au bout de neuf semaines, les troupes se rendirent. On nous donna le choix entre rester sur place et devenir allemands ou renoncer à tout et nous exiler en France. Nous arrivâmes à Paris sans ressources et débarrassés de toute illusion quant à la sécurité que pouvait apporter un mode de vie civilisé.
Avant l’humiliation de 1870, j’aurais pu devenir professeur de musique ou chirurgien ; après, toute autre carrière que l’armée eût paru frivole. Le ministère de la Guerre finança mes études ; l’armée devint mon père, et aucun fils ne déploya plus d’efforts pour plaire à un père exigeant. Je compensais ma nature rêveuse et portée sur les arts par une discipline de fer. Je sortis cinquième sur trois cent quatre de l’école militaire de Saint-Cyr. Je parle allemand, italien, anglais et espagnol. J’ai combattu dans les Aurès, en Algérie, et remporté la médaille coloniale, puis sur le fleuve Rouge, au Tonkin, où je reçus l’étoile des braves, la croix et la médaille du Tonkin. Je suis chevalier de la Légion d’honneur. Et aujourd’hui, après vingt-quatre ans passés sous l’uniforme, j’ai été distingué à la fois par le ministre de la Guerre et par son chef d’état-major. Couché dans la chambre d’amis de ma mère, à Versailles, alors que le 5 janvier 1895 devient le 6, la voix qui résonne dans ma tête n’est pas celle d’Alfred Dreyfus proclamant son innocence, mais celle d’Auguste Mercier me laissant espérer une promotion : J’ai été impressionné pas le discernement dont vous avez fait preuve… Cela ne sera pas oublié…
Читать дальше