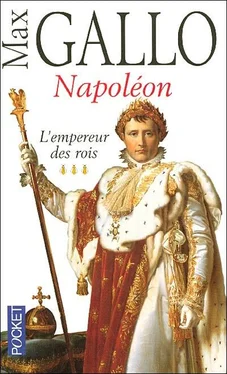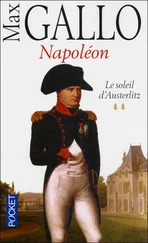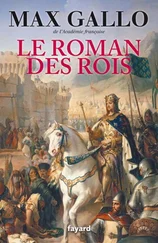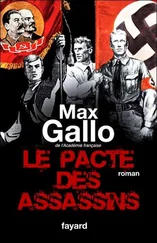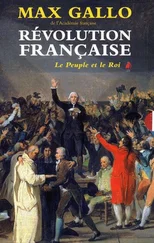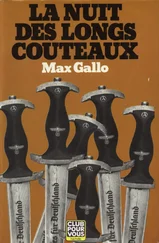Il regarde les troupes russes qui se sont amassées sur cette rive du fleuve, puis il tourne la tête vers la ligne des soldats de la Grande Armée qui bordent la rive gauche. Ils lancent leur cri de « Vive l'Empereur ! » si fort, ils hurlent si gaiement, que les mots se chevauchent et qu'on ne les distingue plus. Les voix ne forment qu'une seule et même explosion, aiguë, qui roule entre les rives, joyeuse et légère, irrésistible.
Il se sent allègre. Il regarde derrière lui. Pour cette rencontre, il a choisi cinq officiers qui l'accompagneront sur le radeau : les maréchaux Murat, Berthier, Bessières, Duroc, et le grand écuyer Caulaincourt. Mais il veut être seul en face du tsar, cet héritier d'un empire plusieurs fois séculaire qui enjambe l'Europe pour toucher à l'Orient et à l'Asie. Lui qui a construit le sien de ses propres mains, lui le fondateur, qui n'a pour égal que les conquérants antiques qui sont à l'origine d'une dynastie et ont rassemblé des peuples, lui, face à un Romanov !
C'est la rencontre de deux aigles, celle des Romanov et la mienne, arborée sur le Niémen, après dix ans de victoires .
Jamais il ne s'est senti aussi léger, aussi joyeux, aussi puissant. Il répond aux vivats en soulevant son chapeau, et les cris redoublent. Cet enthousiasme des soldats, il est aussi en lui.
Quand le prince Lobanov lui a rapporté les propos d'Alexandre I er, il a eu le sentiment d'avoir atteint son but. Qui pourrait désormais menacer dangereusement l'édifice qu'il avait construit ?
Ce Romanov qui accueillait sur ses terres les émigrés français, et parmi eux Louis, frère de Louis XVI, qui se prétendait dix-huitième du nom, cet empereur par héritage parlait à l'Empereur Napoléon. Il lui faisait transmettre l'analyse suivante : « L'union entre la France et la Russie a été constamment l'objet de mes désirs et je porte la conviction qu'elle seule peut assurer le bonheur et la tranquillité du globe. Un système entièrement nouveau doit remplacer celui qui a existé jusqu'ici et je me flatte que nous nous entendions facilement avec l'Empereur Napoléon pourvu que nous traitions sans intermédiaire. Une paix durable peut être conclue entre nous en peu de jours... »
Napoléon s'arrête, marche vers la grande barque qui doit le conduire au radeau.
La brise se lève. Elle pousse dans le ciel bleu des rides blanches comme une gaze qui voile l'éclat du soleil et l'adoucit. Sur le radeau, les tentures sont légèrement soulevées, telles des voiles qui gonflent.
Jamais il n'oubliera cet instant. Jamais les hommes n'oublieront la rencontre des deux empereurs, celui venu d'hier et celui du siècle d'aujourd'hui, lui, Napoléon I er, Empereur des Français, qui a dû traverser tant de fleuves avec ses armées pour parvenir jusqu'ici.
Il a un sentiment, jamais éprouvé, même au moment du sacre, de plénitude.
Ce ciel, ce fleuve Niémen, ce radeau, ces armées qui se font face, cet empereur qui sur la rive droite se prépare à embarquer pour le rejoindre, tout cela, c'est sa cathédrale, son œuvre. Le fruit de trente-huit années de vie.
Il se sent fier, heureux de son destin.
Il saute dans la grande barque, suivi par les maréchaux et le grand écuyer, et il se tient à la proue. Les rameurs, vêtus de blouses blanches, plongent leurs avirons dans les eaux du Niémen.
Il arrive le premier sur le radeau et il s'avance seul, d'un pas rapide, pour accueillir le tsar dont la barque approche.
Napoléon tend la main et, dans un coup d'œil, évalue cet homme qui a douze ans de moins que lui, qui est responsable de l'assassinat de son père, Paul I er.
Alexandre grand, son teint rose. Les cheveux châtains, poudrés, dépassent en longs favoris d'un grand chapeau à plumes blanches et noires. Il porte l'uniforme vert à parements rouges de ce régiment Préobrajenski, qui est une sorte de garde impériale. Sur son épaule droite brillent des aiguillettes d'or. Il a l'épée au côté et des bottes courtes qui tranchent sur ses culottes blanches. Le cordon bleu pâle de l'ordre de Saint-André lui barre la poitrine.
Je porte le cordon rouge de ma Légion d'honneur .
Ce tsar a le regard clair, un visage poupin, avenant.
Napoléon l'embrasse. Ils se dirigent côte à côte vers la grande tente.
- Je hais les Anglais autant que vous les haïssez, commence Alexandre.
Sa voix est mélodieuse, son français parfait.
- Je serai votre second dans tout ce que vous entreprendrez contre eux, poursuit-il au moment où ils sont sur le seuil de la tente.
Napoléon soulève le voile.
- En ce cas, tout peut s'arranger, dit-il, et la paix est faite.
Napoléon parle. Il est emporté par une agréable griserie. Jamais son esprit n'a été aussi vif. Il veut convaincre, séduire, entraîner cet empereur dont il est l'aîné, dont il a battu les troupes, qu'il ne veut pas humilier pourtant mais au contraire rallier afin de bâtir avec lui cette Europe à deux faces.
Celle du tsar jusqu'à la Vistule, et la mienne depuis ce fleuve jusqu'à l'ouest .
Il n'y a pas d'autre choix, d'ailleurs. La Prusse ?
Il dit à Alexandre :
- C'est un vilain roi, une vilaine nation, une puissance qui a trompé tout le monde et qui ne mérite pas d'exister. Tout ce qu'elle garde, elle vous le doit.
L'Autriche ? Napoléon ne veut pas l'évoquer, mais il a lu, au moment où il quittait sa résidence de Tilsit pour se diriger vers le Niémen afin d'y rencontrer Alexandre, les dépêches d'Andréossy. L'ambassadeur de France à Vienne rapporte comment les Autrichiens ont espéré la défaite de la Grande Armée, comment ils se sont préparés à intervenir pour l'achever si elle avait été battue, comment la victoire de Friedland a désespéré la cour de Vienne.
Reste la Turquie, mais une révolution de palais vient d'y renverser le sultan Selim III, l'allié de Napoléon.
Napoléon murmure à Alexandre :
- C'est un décret de la providence qui me dit que l'Empire turc ne peut plus exister !
Partageons-nous ses dépouilles .
Il évoque l'Orient, observe Alexandre.
Cet homme paraît sincère. Il est jeune encore. Je le domine. Je veux son alliance mais je ne lui céderai jamais « Constantinople, qui est l'Empire du monde » .
Le temps a passé, plus d'une heure trente. Ils conviennent de se rencontrer demain, vendredi 26 juin, sur le radeau.
Le roi Frédéric-Guillaume de Prusse devrait être présent, dit Alexandre.
Napoléon a un mouvement d'humeur.
- J'ai souvent couché à deux, jamais à trois, dit-il.
Puis il se reprend, offre pour les entretiens suivants que les rencontres aient lieu à Tilsit, ville dont il cédera la moitié aux Russes afin qu'Alexandre puisse y résider.
- Nous parlerons, dit-il.
Puis il ajoute :
- Je serai votre secrétaire et vous serez le mien.
Napoléon prend le bras d'Alexandre et se dirige vers son canot.
Des deux rives montent les vivats des soldats qui regardent la scène.
Cette nuit-là, Napoléon, qui dort dans la grande maison qu'il occupe à Tilsit, a un sommeil entrecoupé de longs moments de veille.
Les feux des soldats de la Garde éclairent la pièce. Il entend une chanson qui, au loin, monte dans la nuit.
L'air est celui d'un refrain qu'entonnent souvent les grenadiers en marchant. La voix, d'abord seule, est rejointe par d'autres, joyeuses, qui reprennent en chœur :
Sur un radeau
J'ai vu deux maîtres de la terre
J'ai vu le plus noble tableau
J'ai vu la paix, j'ai vu la guerre
Et le sort de l'Europe entière
Sur un radeau...
Le sommeil se dissipe. Pourquoi s'ensevelir dans l'oubli et le silence qu'il procure alors que les journées qu'il vit sont les plus pleines de sa vie ?
Читать дальше