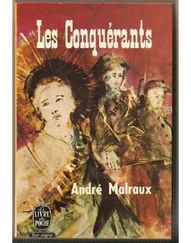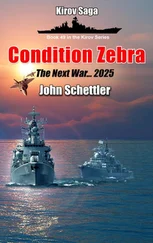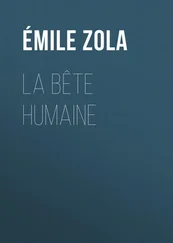- Non, dit-il, retournant à la détresse. Il ne l'avait pas quittée. Il s'aperçut qu'il n'avait pas cru May.
- Tant pis... répondit-elle seulement.
Elle le regarda partir dans la pièce voisine, hésitant. À quoi pensait-il ? Tant que Kyo était là, toute pensée lui était due. Cette mort attendait d'elle quelque chose, une réponse qu'elle ignorait mais qui n'en existait pas moins. Ô chance abjecte des autres, avec leurs prières, leurs fleurs funèbres ! Une réponse au delà de l'angoisse qui arrachait à ses mains les caresses maternelles qu'aucun enfant n'avait reçu d'elle, de l'épouvantable appel qui fait parler aux morts par les formes les plus tendres de la vie. Cette bouche qui lui avait dit hier : « J'ai cru que tu étais morte », ne parlerait plus jamais ; ce n'était pas avec ce qui restait ici de vie dérisoire, un corps, c'était avec la mort même qu'il fallait entrer en communion. Elle restait là, immobile, arrachant de ses souvenirs tant d'agonies contemplées avec résignation, toute tendue de passivité dans le vain accueil qu'elle offrait sauvagement au néant.
Gisors s'était allongé de nouveau sur le divan. « Et, plus tard, je devrai me réveiller... » Combien de temps chaque matin lui apporterait-il de nouveau cette mort ? La pipe était là : la paix. Avancer la main, préparer la boulette : après un quart d'heure, penser à la mort même avec une indulgence sans limites, comme à quelque paralytique qui lui eût voulu du mal : elle cesserait de pouvoir l'atteindre ; elle perdrait toute prise et glisserait doucement dans la sérénité universelle. La libération était là, tout près. Nulle aide ne peut être donnée aux morts. Pourquoi souffrir davantage ? La douleur est-elle une offrande à l'amour, ou à la peur ?.. Il n'osait toujours pas toucher le plateau, et l'angoisse lui serrait la gorge en même temps que le désir et les sanglots refoulés : Au hasard, il saisit la première brochure venue (il ne touchait jamais aux livres de Kyo, mais il savait qu'il ne la lirait pas). C'était un numéro de la Politique de Pékin tombé là lorsqu'on avait apporté le corps et où se trouvait le discours pour lequel Gisors avait été chassé de l'Université. En marge, de l'écriture de Kyo : « Ce discours est le discours de mon père. » Jamais il ne lui avait dit même qu'il l'approuvât. Gisors referma la brochure avec douceur et regarda son espoir mort.
Il ouvrit la porte, lança l'opium dans la nuit et revint s'asseoir, épaules basses, attendant l'aube, attendant que se réduisît au silence, à force de s'user dans son dialogue avec elle-même, sa douleur... Malgré la souffrance qui entr'ouvrait sa bouche, qui changeait en visage ahuri son masque grave, il ne perdait pas tout contrôle. Cette nuit, sa vie allait changer : la force de la pensée n'est pas grande contre la métamorphose à quoi la mort peut contraindre un homme. Il était désormais rejeté à lui-même. Le monde n'avait plus de sens, n'existait plus : l'immobilité sans retour, là, à côté de ce corps qui l'avait relié à l'univers, était comme un suicide de Dieu. Il n'avait attendu de Kyo ni réussite, ni même bonheur ; mais que le monde fût sans Kyo... « Je suis rejeté hors du temps » ; l'enfant était la soumission au temps, à la coulée des choses ; sans doute, au plus profond, Gisors était-il espoir comme il était angoisse, espoir de rien, attente, et fallait-il que son amour fût écrasé pour qu'il découvrît cela. Et pourtant ! tout ce qui le détruisait trouvait en lui un accueil avide : « Il y a quelque chose de beau à être mort », pensa-t-il. Il sentait trembler en lui la souffrance fondamentale, non celle qui vient des êtres ou des choses mais celle qui sourd de l'homme même et à quoi s'efforce de nous arracher la vie ; il pouvait lui échapper, mais seulement en cessant de penser à elle ; et il y plongeait de plus en plus, comme si cette contemplation épouvantée eût été la seule voix que pût entendre la mort, comme si cette souffrance d'être homme dont il s'imprégnait jusqu'au fond du cœur eût été la seule oraison que pût entendre le corps de son fils tué.
SEPTIÈME PARTIE
Paris, juillet.
Ferral, s'éventant avec le journal où le Consortium était le plus violemment attaqué, arriva le dernier dans le cabinet d'attente du ministre des Finances : en groupes, attendaient le directeur adjoint du Mouvement Général des Fonds - le frère de Ferral était sagement tombé malade la semaine précédente - le représentant de la Banque de France, celui de la principale banque d'affaires française, et ceux des établissements de crédit. Ferral les connaissait tous : un Fils, un Gendre, et d'anciens fonctionnaires de l'Inspection des Finances et du Mouvement Général des Fonds ; le lien entre l'État et les Établissements était trop étroit pour que ceux-ci n'eussent pas avantage à s'attacher des fonctionnaires qui trouvaient auprès de leurs anciens collègues un accueil favorable. Ferral remarqua leur surprise : il eût été d'usage qu'il arrivât avant eux ; ne le voyant pas là, ils avaient pensé qu'il n'était pas convoqué. Qu'il se permît de venir le dernier les surprenait. Tout les séparait : ce qu'il pensait d'eux, ce qu'ils pensaient de lui, leurs façons de s'habiller. Deux races.
Ils furent introduits presque aussitôt.
Ferral connaissait peu le ministre. Cette expression de visage d'un autre temps venait-elle de ses cheveux blancs, épais comme ceux des perruques de la Régence ? Ce fin visage aux yeux clairs, ce sourire si accueillant - vieux parlementaire - s'accordaient à la légende de courtoisie du ministre ; légende parallèle à celle de sa brusquerie, lorsque le piquait une mouche napoléonienne. Ferral, tandis que chacun prenait place, songeait à une anecdote fameuse : le ministre, alors ministre des Affaires étrangères, secouant par les basques de sa jaquette l'envoyé de la France au Maroc, et, la couture du dos de la jaquette éclatée soudain, sonnant : « Apportez une de mes jaquettes pour Monsieur ! » puis sonnant à nouveau au moment où disparaissait l'huissier : « La plus vieille ! Il n'en mérite pas une autre ! » Son visage eût été fort séduisant sans un regard qui semblait nier ce que promettait la bouche : blessé par accident, un de ses yeux était de verre.
Ils s'étaient assis : le directeur du Mouvement Général des Fonds à la droite du ministre, Ferral à sa gauche ; les représentants, au fond du bureau, sur un canapé.
- Vous savez, messieurs, dit le ministre, pourquoi je vous ai convoqués. Vous avez sans doute examiné la question. Je laisse à M. Ferral le soin de vous la résumer et de vous présenter son point de vue.
Les représentants attendirent patiemment que Ferral, selon la coutume, leur racontât des blagues.
- Messieurs, dit Ferral, il est d'usage, dans un entretien comme celui-ci, de présenter des bilans optimistes. Vous avez sous les yeux le rapport de l'Inspection des Finances. La situation du Consortium, pratiquement, est plus mauvaise que ne le laisse supposer ce rapport. Je ne vous soumets ni postes gonflés, ni créances incertaines. Le passif du Consortium, vous le connaissez, de toute évidence ; je désire attirer votre attention sur deux points de l'actif que ne peut indiquer aucun bilan, et au nom de quoi votre aide est demandée.
Le premier est que le Consortium représente la seule œuvre française de cet ordre en Extrême-Orient. Même déficitaire, même à la veille de la faillite, sa structure demeurerait intacte. Son réseau d'agents, ses postes d'achat ou de vente à l'intérieur de la Chine, les liens établis entre ses acheteurs chinois et ses sociétés de production indochinoises, tout cela est et peut être maintenu. Je n'exagère pas en disant que, pour la moitié des marchands du Yang-Tsé, la France c'est le Consortium, comme le Japon c'est le concern Mitsubishi ; notre organisation, vous le savez, peut être comparée en étendue à celle de la Standard Oil. Or la Révolution chinoise ne sera pas éternelle.
Читать дальше