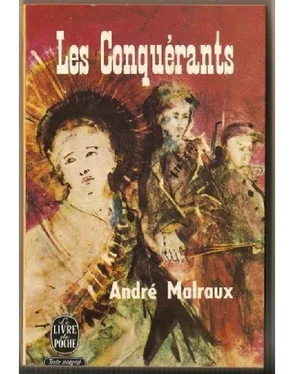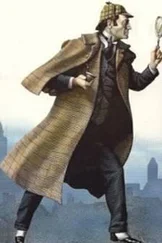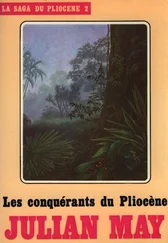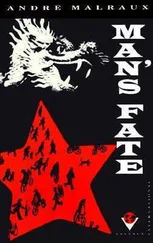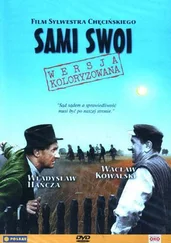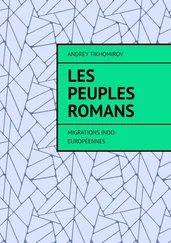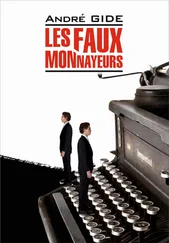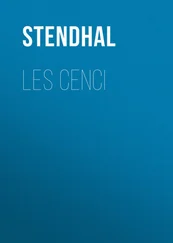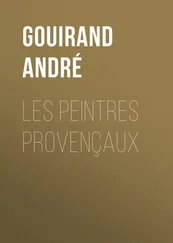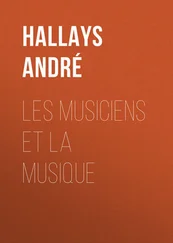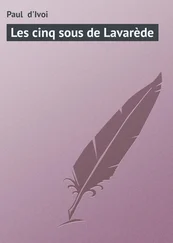La curiosité et même une certaine inquiétude me poussant, je commence à traduire. Qu'est, aujourd'hui, cet homme dont j'ai été l'ami pendant des années ? Je ne l'ai pas vu depuis cinq ans. Au cours de ce voyage, il n'est pas un jour qui ne l'ait imposé à mon souvenir, soit qu'on me parlât de lui, soit que son action fût sensible dans les radios que nous recevions... Je l'imagine, tel que je l'ai vu à Marseille lors de notre dernière entrevue, mais avec un visage formé par l'union de ses visages successifs ; de grands yeux gris, durs, presque sans cils, un nez mince et légèrement courbe (sa mère était juive) et surtout, creusées dans les joues, ces deux rides fines et nettes qui font tomber les extrémités des lèvres minces, comme dans nombre de bustes romains. Ce ne sont pas ces traits, à la fois aigus et marqués, qui animent ce visage, mais la bouche aux lèvres sans mollesse, aux lèvres tendues liées aux mouvements de la mâchoire un peu forte ; la bouche énergique, nerveuse...
Dans l'état de fatigue où le suis, les phrases que je traduis avec lenteur ordonnent mes souvenirs, et ils se groupent à leur suite. La voix domine. Il y a en moi, cette nuit, de l'ivrogne qui poursuit son rêve...
Pierre Garin, dit Garine ou Harine. Né à Genève le 5 novembre 1892, de Maurice Garin, sujet suisse, et de Sophia Alexandrovna Mirsky, russe, son épouse.
Il est né en 1894... Se vieillit-il ?..
Anarchiste militant. Condamné pour complicité dans une affaire anarchiste à Paris en 1914 .
Non. Il ne fut jamais « anarchiste militant ». En 1914 - à vingt ans - encore sous l'influence des études de lettres qu'il venait de terminer et dont il ne restait en lui que la révélation de grandes existences opposées (« Quels livres valent d'être écrits, hormis les Mémoires ? » ) il était indifférent aux systèmes, décidé à choisir celui que les circonstances lui imposeraient. Ce qu'il cherchait parmi les anarchistes et les socialistes extrémistes, malgré le grand nombre d'indicateurs de police qu'il savait rencontrer chez les premiers, c'était l'espoir d'un temps de troubles. Je l'ai entendu plusieurs fois, au retour de quelque réunion (où - ingénuité - il était allé coiffé d'une casquette de Barclay), parler avec une ironie méprisante des hommes qu'il venait de voir et qui prétendaient travailler au bonheur de l'humanité. « Ces crétins-là veulent avoir raison. En l'occurrence, il n'y a qu'une raison qui ne soit pas une parodie : l'emploi le plus efficace de sa force. » L'idée était alors dans l'air, et elle se reliait au jeu de son imagination, tout occupée de Saint-Just.
On le croyait généralement ambitieux. Seule est réelle l'ambition dont celui qu'elle possède prend conscience sous forme d'actes à accomplir ; il était encore incapable de désirer des conquêtes successives, de les préparer, de confondre sa vie avec elles ; son caractère ne se prêtait pas plus que son intelligence aux combinaisons nécessaires. Mais il sentait en lui, tenace, constant, le besoin de la puissance. « Ce n'est pas tant l'âme qui fait le chef que la conquête » m'avait-il dit un jour. Il avait ajouté, avec ironie : « Malheureusement ! » Et, quelques jours plus tard (il lisait alors le Mémorial ) : « Surtout, c'est la conquête qui maintient l'âme du chef. Napoléon, à Sainte-Hélène, va jusqu'à dire : « Tout de même, quel roman que ma vie !.. » Le génie aussi pourrit... »
Il savait que la vocation qui le poussait n'était point celle qui brille un instant, parmi beaucoup d'autres, à travers l'esprit des adolescents, puisqu'il lui faisait d'avance l'abandon de sa vie, puisqu'il acceptait tous les risques qu'elle impliquait. De la puissance, il ne souhaitait ni argent, ni considération, ni respect ; rien qu'elle-même. Si, repris par un besoin puéril de rêverie, il rêvait à elle, c'était de façon presque physique. Plus « d'histoires » ; une sorte de crispation, de force tendue, d'attente. L'image ridicule de l'animal ramassé, prêt à bondir, l'obsédait. Et il finissait par considérer l'exercice de la puissance comme un soulagement, comme une délivrance.
Il entendait se jouer. Brave, il savait que toute perte est limitée par la mort, dont son extrême jeunesse lui permettait de se soucier peu ; quant au gain possible, il ne l'imaginait pas encore sous une forme précise. Peu à peu, aux espoirs confus de l'adolescence, une volonté lucide se substituait, sans dominer encore un caractère dont la marque restait la violence dans cette légèreté que donne, à la vingtième année, la connaissance unique de l'abstrait.
Mais il devait bientôt entrer en contact avec la vie d'une façon brutale ; un matin, à Lausanne, je reçus une lettre dans laquelle un de nos camarades m'informait que Pierre venait d'être inculpé dans une affaire d'avortement ; et, deux jours plus tard, une lettre de lui, où je trouvai quelques détails.
Si la propagande en faveur du malthusianisme était active dans les sociétés anarchistes, les sages-femmes qui acceptaient de provoquer l'avortement par conviction étaient fort peu nombreuses, et un compromis intervenait : elles provoquaient l'avortement « pour la cause » mais se faisaient payer. Pierre, à maintes reprises, avait, mi par conviction, mi par vanité, donné les sommes que n'auraient pu trouver seules des jeunes femmes pauvres. Il disposait de la fortune qu'il avait héritée de sa mère, ce que néglige le rapport de police ; on savait qu'il suffisait de s'adresser à lui : on le sollicitait souvent. À la suite d'une dénonciation, plusieurs sages-femmes furent arrêtées, et il fut poursuivi pour complicité.
Son premier sentiment fut la stupéfaction. Il n'ignorait pas l'illégalité de ce qu'il faisait, mais le grotesque d'un jugement en cour d'assises, appliqué à de telles actions, le laissa désemparé. Il ne parvenait pas, d'ailleurs, à se rendre compte de ce que pouvait être un tel jugement. Je le voyais alors souvent, car on l'avait laissé en liberté provisoire. Les confrontations n'avaient pour lui aucun intérêt : il ne niait rien. Quant à l'instruction, menée par un juge à barbe, indifférent et préoccupé surtout de réduire les faits à une sorte d'allégorie juridique, elle lui semblait une lutte contre un automate d'une médiocre dialectique.
Un jour, il dit à ce juge qui venait de lui poser une question : « Qu'importe ? - Eh ! répondit le juge, cela n'est pas sans importance pour l'application de la peine... » Cette réponse le troubla. L'idée d'une condamnation réelle ne s'était pas encore imposée à lui. Et, bien qu'il fût courageux et méprisât ceux qui devaient le juger, il s'appliqua à faire intervenir en sa faveur auprès d'eux tous ceux qu'il put atteindre : jouer sa vie sur cette carte sale, ridicule, qu'il n'avait pas choisie, lui était intolérable.
Retenu à Lausanne, je ne pus assister aux débats.
Pendant toute la durée du procès, il eut l'impression d'un spectacle irréel ; non d'un rêve, mais d'une comédie étrange, un peu ignoble et tout à fait lunaire. Seul, le théâtre peut donner, autant que la cour d'assises, une impression de convention. Le texte du serment exigé des jurés, lu d'une voix de maître d'école las par le président, le surprit par son effet sur ces douze commerçants placides, soudain émus, visiblement désireux d'être justes, de ne pas se tromper, et se préparant à juger avec application. L'idée qu'ils pouvaient ne rien comprendre aux faits qu'ils allaient juger ne les troublait pas un instant. L'assurance avec laquelle certains témoins déposaient, l'hésitation des autres, l'attitude du président lorsqu'il interrogeait (celle d'un technicien dans une réunion d'ignorants), l'hostilité avec laquelle il parlait à certains témoins à décharge, tout montrait à Pierre le peu de relation entre les faits en cause et cette cérémonie. Au début, il fut intéressé à l'extrême : le jeu de la défense le passionnait. Mais il se lassa, et, pendant l'audition des derniers témoins, il songeait en souriant : « Juger, c'est de toute évidence, ne pas comprendre, puisque si l'on comprenait, on ne pourrait plus juger. » Et les efforts du président et de l'avocat général pour ramener à la notion, commune et familière aux jurés, d'un crime, la suite de ces événements, lui semblèrent à tel point dignes d'une parodie qu'il se prit un instant à rire. Mais la justice, dans cette salle, était si forte, les magistrats, les gendarmes, la foule étaient si bien unis dans un même sentiment que l'indignation n'y avait point de place. Son sourire oublié, Pierre trouva ce même sentiment d'impuissance navrante, de mépris et de dégoût que l'on éprouve devant une multitude fanatique, devant toutes les grandes manifestations de l'absurdité humaine.
Читать дальше