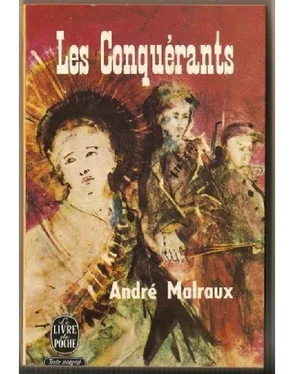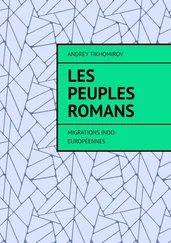Pendant les premiers mois qui suivirent l'arrivée de Borodine, je compris, au ton des lettres de Pierre, qu'une action puissante - enfin - se préparait ; puis les lettres devinrent plus rares, et c'est avec surprise que j'appris que « le ridicule petit Gouvernement de Canton » entrait en lutte contre l'Angleterre et rêvait de reconstituer l'unité de la Chine.
Lorsque Pierre, après ma ruine, me donna la possibilité de venir à Canton comme Lambert la lui avait donnée à lui-même six ans plus tôt, je ne connaissais la lutte de Hongkong contre Canton que par les radios d'Extrême-Orient ; et les premières instructions que je reçus me furent données à Ceylan par un délégué du Kuomintang de Colombo, pendant l'escale. Il pleuvait comme il pleut sous les tropiques ; pendant que j'écoutais le vieux Cantonais, l'auto dans laquelle nous étions assis filait sous les nuages bas ; le pare-brise brouillé faisait sauter au passage, en claquant, les palmes ruisselantes. Il me fallait faire effort pour me persuader que les paroles que j'entendais exprimaient des réalités, des luttes, des morts, de l'angoisse... De retour à bord, au bar, encore étonné des discours du Chinois, j'eus la curiosité de relire les dernières lettres de Pierre, dont le rôle de chef commençait à devenir réel pour moi. Et ces lettres qui sont là, sur mon lit, font maintenant entrer dans cette cabine blanche, à côté de l'image trouble de mon ami, de tant de souvenirs nets ou désagrégés, un océan battu d'une pluie oblique et bordé par la longue ligne grise des hauts plateaux de Ceylan surmontée de nuages immobiles et presque noirs...
« Tu sais combien je souhaite que tu viennes. Mais ne viens pas en croyant trouver ici la vie qui satisfait l'espoir que j'avais lorsque je t'ai quitté. La force dont j'ai rêvé et dont je dispose aujourd'hui ne s'obtient que par une application paysanne, par une énergie persévérante, par la volonté constante d'ajouter à ce que nous possédons l'homme ou l'élément qui nous manque. Peut-être seras-tu étonné que je t'écrive ainsi, moi. Cette persévérance qui me manquait, je l'ai trouvée ici chez des collaborateurs, et je crois l'avoir acquise. Ma force vient de ce que j'ai mis une absence de scrupules complète au service d'autre chose que mon intérêt immédiat... »
J'ai vu chaque jour, en approchant de Canton, afficher les radios par lesquels il a si bien remplacé ses lettres...
Cette note de police est singulièrement incomplète. Je vois au bas de la page deux gros points d'exclamation au crayon bleu. Peut-être est-ce une note ancienne ? Les précisions fournies par la seconde feuille sont d'un tout autre ordre :
Assure aujourd'hui l'existence de la Propagande par des prélèvements sur les envois des coloniaux chinois et sur les cotisations des syndicats. Semble être pour beaucoup dans l'enthousiasme indéniable que rencontre ici l'idée d'une guerre contre les troupes auxquelles nous avons accordé notre appui. Est parvenu, à l'aide d'une prédication incessante, menée par ses agents, à faire accepter les syndicats obligatoires, - sur l'importance desquels je ne crois pas devoir insister, - lorsque Borodine en demanda la création, avant de disposer des piquets de grève. A fait des sept services de la police, publique et secrète, autant de services de propagande. A créé un « groupement d'instruction politique » qui est une école d'orateurs et de propagandistes. A fait rattacher au Bureau Politique, et par là à l'Internationale, le Commissariat de la Justice (ici encore, je ne crois pas devoir insister) et celui des Finances. Enfin, j'insiste sur ce point, il s'efforce actuellement de faire promulguer le décret dont le seul projet a fait demander par nous l'intervention militaire du Royaume-Uni : le décret qui interdit l'entrée du port de Canton à tout bateau ayant fait escale à Hongkong, et dont on a si bien dit qu'il détruirait Hongkong aussi sûrement qu'un cancer . Cette phrase est affichée dans plusieurs bureaux de la Propagande.
Au-dessous, trois lignes sont soulignées deux fois au crayon rouge.
Je me permets d'attirer tout spécialement votre attention sur ceci : cet homme est gravement malade . Il sera obligé de quitter le Tropique avant peu.
J'en doute.
DEUXIÈME PARTIE
PUISSANCES
Juillet
Cris, appels, protestations, ordres des policiers, le vacarme d'hier soir recommence. Cette fois c'est le débarquement. À peine regarde-t-on Shameen aux petites maisons entourées d'arbres. Tous observent le pont voisin protégé par des tranchées et des fils de fer barbelés, et, surtout, les canonnières anglaises et françaises toutes proches dont les canons sont dirigés vers Canton. Un canot automobile nous attend, Klein et moi.
Voici la vieille Chine, la Chine sans Européens. Sur une eau jaunâtre, chargée de glaise, le canot avance comme dans un canal, entre deux rangs serrés de sampans semblables à des gondoles grossières avec leur toiture d'osier. À l'avant, des femmes presque toutes âgées cuisinent sur des trépieds, dans une intense odeur de graisse brûlée ; souvent, derrière elles, apparaît un chat, une cage ou un singe enchaîné. Les enfants nus et jaunes passent de l'un à l'autre, faisant sauter comme un plumeau plat la frange unique de leurs cheveux, plus légers et plus animés que les chats malgré leurs ventres en poire de mangeurs de riz. Les tout petits dorment, paquets dans un linge noir accroché au dos des mères. La lumière frisante du soleil joue autour des arêtes des sampans et détache violemment de leur fond brun les blouses et les pantalons des femmes, taches bleues, et les enfants grimpés sur les toits, taches jaunes. Sur le quai, le profil dentelé des maisons américaines et des maisons chinoises : au-dessus, le ciel sans couleur à force de lumière ; et partout, légère comme une mousse, sur les sampans, sur les maisons, sur l'eau, cette lumière dans laquelle nous pénétrons comme dans un brouillard incandescent.
Nous accostons. Une auto qui nous attendait nous emmène aussitôt à vive allure. Le chauffeur, vêtu de l'uniforme de l'armée, fait ronfler sans cesse son klaxon, et la foule reflue précipitamment, comme poussée par un chasse-neige. À peine ai-je le temps d'entrevoir, perpendiculairement à notre course, une multitude bleue et blanche - beaucoup d'hommes en robes - encadrée par des perspectives de stores ornés de gigantesques caractères noirs et constamment trouée par les marchands ambulants et les manœuvres qui avancent au pas gymnastique, le corps déjeté, l'épaule courbée sous un bambou aux extrémités duquel pendent de lourdes charges. Un instant, apparaissent des ruelles aux dalles crevassées qui finissent dans l'herbe devant quelque bastion à cornes ou quelque pagode moisie. Et, dans un coup de vent, nous distinguons en la croisant l'auto d'un haut fonctionnaire de la République, avec ses deux soldats, parabellum au poing, debout sur les marchepieds.
Quittant le quartier commerçant de la ville, l'auto s'engage sur un boulevard tropical bordé de maisons entourées de jardins, sans promeneurs, où l'éclat blanchâtre et mat de la chaussée brûlante n'est taché que de la silhouette clopinante d'un marchand de soupe bientôt disparu dans une ruelle. Klein, qui va chez Borodine, me quitte devant une maison de style colonial - toit débordant et vérandas - entourés d'une grille semblable à celles qui ornent les chalets des environs de Paris : la maison de Garine. La porte de fer est poussée. Je traverse un petit jardin et parviens à une seconde porte gardée par deux soldats cantonais en uniforme de toile grise. L'un prend ma carte et disparaît. J'attends en regardant l'autre : avec sa casquette plate et son parabellum à la ceinture, il me rappelle les officiers du tsar ; mais sa casquette est rejetée sur l'arrière de sa tête et il est chaussé d'espadrilles. L'autre revient. Je peux monter.
Читать дальше