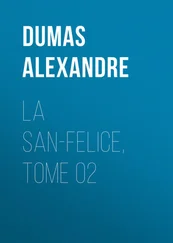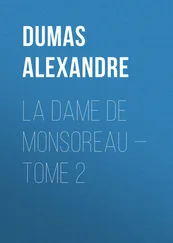Leur maître, M. de Lauzun, nonchalamment assis dans le traîneau bourré de peaux de tigre, se penche sur le côté pour respirer librement, ce qu’il ne réussirait probablement pas à faire en suivant le fil du vent.
Çà et là, quelques traîneaux d’une modeste allure cherchent l’isolement. Une dame masquée, sans doute à cause du froid, monte un de ces traîneaux tandis qu’un beau patineur, vêtu d’une houppelande de velours à brandebourgs d’or, se penche sur le dossier pour donner une impulsion plus rapide au traîneau qu’il pousse et dirige en même temps.
Les paroles entre la dame masquée et le patineur à la houppelande de velours s’échangent à la portée du souffle, et nul ne saurait blâmer un rendez-vous secret donné sous la voûte des cieux, à la vue de Versailles tout entier.
Ce qu’ils disent, qu’importe aux autres puisqu’on les voit; qu’importe à eux qu’on les voie puisqu’on ne les entend pas: il est évident qu’au milieu de tout ce monde ils vivent d’une vie isolée, ils passent dans la foule comme deux oiseaux voyageurs: où vont-ils? à ce monde inconnu que toute âme cherche, et qu’on appelle le bonheur.
Tout à coup, au milieu de ces sylphes qui glissent bien plus qu’ils ne marchent, il se fait un grand mouvement il s’élève un grand tumulte.
C’est que la reine vient d’apparaître au bord de la pièce d’eau des Suisses, qu’on l’a reconnue, et qu’on s’apprête à lui céder la place, quand elle fait de la main signe à chacun de demeurer.
Le cri de «Vive la reine!» retentit; puis, forts de la permission, patineurs qui volent et traîneaux qu’on pousse forment, comme par un mouvement électrique, un grand cercle autour de l’endroit où l’auguste visiteuse s’est arrêtée.
L’attention générale est fixée sur elle.
Les hommes alors se rapprochent par de savantes manœuvres, les femmes s’ajustent avec une respectueuse décence, enfin chacun trouve moyen de se mêler presque aux groupes de gentilshommes et de grands officiers qui viennent offrir leurs compliments à la reine.
Parmi les principaux personnages que le public a remarqués, il en est un fort remarquable qui, au lieu de suivre l’impulsion générale et de venir au-devant de la reine, il en est un qui, au contraire, reconnaissant sa toilette et son entourage, quitte son traîneau et se jette dans une contre-allée où il disparaît avec les personnes de sa suite.
Le comte d’Artois, que l’on remarquait au nombre des plus élégants et plus légers patineurs, ne fut pas des derniers à franchir l’espace qui le séparait de sa belle-sœur, et à venir lui baiser la main.
Puis, en lui baisant la main:
– Voyez-vous, lui dit-il à l’oreille, comme notre frère M. de Provence vous évite?
Et en disant ces mots, il désignait du doigt l’altesse royale qui, à grands pas, marchait dans le taillis plein de givre, pour aller par un détour à la recherche de son carrosse.
– Il ne veut pas que je lui fasse des reproches, dit la reine.
– Oh! quant aux reproches qu’il attend, cela me regarde, et ce n’est point pour cela qu’il vous craint.
– C’est pour sa conscience alors, dit gaiement la reine.
– Pour autre chose encore, ma sœur.
– Pourquoi donc?
– Je vais vous le dire. Il vient d’apprendre que M. de Suffren, le glorieux vainqueur, doit arriver ce soir, et comme la nouvelle est importante, il veut vous la laisser ignorer.
La reine vit autour d’elle quelques curieux, dont le respect n’éloignait pas tellement les oreilles qu’ils ne pussent entendre les paroles de son beau frère.
– Monsieur de Taverney, dit-elle, soyez assez bon pour vous occuper de mon traîneau, je vous prie, et si votre père est là, embrassez-le, je vous donne congé pour un quart d’heure.
Le jeune homme s’inclina et traversa la foule pour aller exécuter l’ordre de la reine.
La foule aussi avait compris: elle a parfois des instincts merveilleux; elle élargit le cercle, et la reine et le comte d’Artois se trouvèrent plus à l’aise.
– Mon frère, dit alors la reine, expliquez-moi, je vous prie, ce que mon frère gagne à ne point me faire part de l’arrivée de M. de Suffren.
– Oh! ma sœur, est-il bien possible que vous, femme, reine et ennemie, vous ne saisissiez pas tout à coup l’intention de ce rusé politique? M. de Suffren arrive, nul ne le sait à la cour. M. de Suffren est le héros des mers de l’Inde, et, par conséquent, a droit à une réception magnifique à Versailles. Donc, M. de Suffren arrive; le roi ignore son arrivée, le roi le néglige sans le savoir, et, par conséquent, sans le vouloir; vous de même, ma sœur. Tout au contraire, pendant ce temps, M. de Provence, qui sait l’arrivée de M. de Suffren, lui, M. de Provence accueille le marin, lui sourit, le caresse, lui fait un quatrain, et, en se frottant au héros de l’Inde, il devient le héros de la France.
– C’est clair, dit la reine.
– Pardieu! dit le comte.
– Vous n’oubliez qu’un seul point, mon cher gazetier.
– Lequel?
– Comment savez-vous tout ce beau projet de notre cher frère et beau frère?
– Comment je le sais? Comme je sais tout ce qu’il fait. C’est bien simple: m’étant aperçu que M. de Provence prend à tâche de savoir tout ce que je fais, j’ai payé des gens qui me content tout ce qu’il fait, lui. Oh! cela pourra m’être utile, et à vous aussi, ma sœur.
– Merci de votre alliance, mon frère, mais le roi?
– Eh bien! le roi est prévenu.
– Par vous?
– Oh! non pas, par son ministre de la Marine que je lui ai envoyé. Tout cela ne me regarde pas, vous comprenez, moi, je suis trop frivole, trop dissipateur, trop fou, pour m’occuper de choses de cette importance.
– Et le ministre de la Marine ignorait aussi, lui, l’arrivée de M. de Suffren en France?
– Eh! mon Dieu! ma chère sœur, vous avez connu assez de ministres, n’est-ce pas, depuis quatorze ans que vous êtes ou dauphine ou reine de France, pour savoir que ces messieurs ignorent toujours la chose importante. Eh bien! j’ai prévenu le nôtre et il est enthousiasmé.
– Je le crois bien.
– Vous comprenez, chère sœur, voilà un homme qui me sera reconnaissant toute sa vie, et justement, j’ai besoin de sa reconnaissance.
– Pour quoi faire?
– Pour négocier un emprunt.
– Oh! s’écria la reine en riant, voilà que vous me gâtez votre belle action.
– Ma sœur, dit le comte d’Artois d’un air grave, vous devez avoir besoin d’argent; foi de fils de France! je mets à votre disposition la moitié de la somme que je toucherai.
– Oh! mon frère! s’écria Marie-Antoinette, gardez, gardez; Dieu merci! je n’ai besoin de rien en ce moment.
– Diable! n’attendez pas trop longtemps pour réclamer ma promesse, chère sœur.
– Pourquoi cela?
– Parce que je pourrais bien, si vous attendiez trop longtemps, n’être plus en mesure de la tenir.
– Eh bien! en ce cas, je m’arrangerai aussi, moi, de façon à découvrir quelque secret d’État.
– Ma sœur, vous prenez froid, dit le prince, vos joues bleuissent, je vous en préviens.
– Voici M. de Taverney qui revient avec mon traîneau.
– Alors, vous n’avez plus besoin de moi, ma sœur?
– Non.
– En ce cas, chassez-moi, je vous prie.
– Pourquoi? vous figurez-vous, par hasard, que vous me gênez en quelque chose que ce soit?
– Non pas, c’est moi, au contraire, qui ai besoin de ma liberté.
– Adieu alors.
– Au revoir, chère sœur.
– Quand?
– Ce soir.
– Qu’y a-t-il donc ce soir?
– Il n’y a pas, mais il y aura.
– Eh bien! qu’y aura-t-il?
Читать дальше