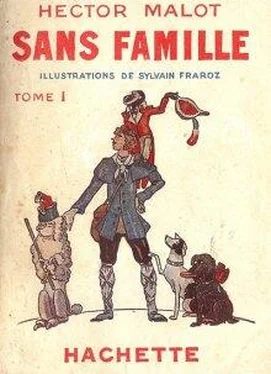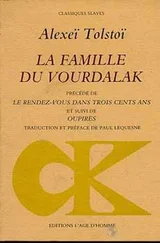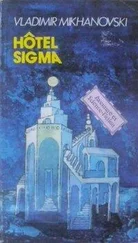Mon père et ma mère étaient seuls ; tandis que ma mère faisait rapidement deux paquets des objets apportés, mon père balayait un coin de la remise ; sous le sable sec qu’il enlevait à grands coups de balai apparut bientôt une trappe : il la leva ; puis comme ma mère avait achevé de ficeler les deux ballots il les descendit par cette trappe dans une cave dont je ne vis pas la profondeur, tandis que ma mère l’éclairait avec la lanterne ; les deux ballots descendus, il remonta, ferma la trappe et avec son balai replaça dessus le sable qu’il avait enlevé ; quand il eut achevé sa besogne il fut impossible de voir où se trouvait l’ouverture de cette trappe ; sur le sable ils avaient tous les deux semé des brins de paille comme il y en avait partout sur le sol de la remise.
Ils sortirent.
Au moment où ils fermaient doucement la porte de la maison, il me sembla que Mattia remuait dans sa couchette, comme s’il reposait sa tête sur l’oreiller.
Avait-il vu ce qui venait de se passer ?
Je n’osai le lui demander : ce n’était plus une épouvante vague qui m’étouffait ; je savais maintenant pourquoi j’avais peur : des pieds à la tête j’étais baigné dans une sueur froide.
Je restai ainsi pendant toute la nuit ; un coq, qui chanta dans le voisinage, m’annonça l’approche du matin ; alors seulement je m’endormis, mais d’un sommeil lourd et fiévreux, plein de cauchemars anxieux qui m’étouffaient.
Un bruit de serrure me réveilla, et la porte de notre voiture fut ouverte ; mais, m’imaginant que c’était mon père qui venait nous prévenir qu’il était temps de nous lever, je fermai les yeux pour ne pas le voir.
— C’est ton frère, me dit Mattia, qui nous donne la liberté ; il est déjà parti.
Nous nous levâmes alors ; Mattia ne me demanda pas si j’avais bien dormi, et je ne lui adressai aucune question ; comme il me regardait à un certain moment, je détournai les yeux.
Il fallut entrer dans la cuisine, mais mon père ni ma mère ne s’y trouvaient point ; mon grand-père était devant le feu, assis dans son fauteuil, comme s’il n’avait pas bougé depuis la veille, et ma sœur aînée, qui s’appelait Annie, essuyait la table, tandis que mon plus grand frère Allen balayait la pièce.
J’allai à eux pour leur donner la main, mais ils continuèrent leur besogne sans me répondre.
J’arrivai alors à mon grand-père, mais il ne me laissa point approcher, et comme la veille, il cracha de mon côté, ce qui m’arrêta court.
— Demande donc, dis-je à Mattia, à quelle heure je verrai mon père et ma mère ce matin.
Mattia fit ce que je lui disais, et mon grand-père en entendant parler anglais se radoucit ; sa physionomie perdit un peu de son effrayante fixité et il voulut bien répondre.
— Que dit-il ? demandai-je.
— Que ton père est sorti pour toute la journée, que ta mère dort et que nous pouvons aller nous promener.
— Il n’a dit que cela ? demandai-je, trouvant cette traduction bien courte.
Mattia parut embarrassé.
— Je ne sais pas si j’ai bien compris le reste, dit-il.
— Dis ce que tu as compris.
— Il me semble qu’il a dit que si nous trouvions une bonne occasion en ville il ne fallait pas la manquer, et puis il a ajouté, cela j’en suis sûr : « Retiens ma leçon : il faut vivre aux dépens des imbéciles. »
Sans doute mon grand-père devinait ce que Mattia m’expliquait, car à ces derniers mots il fit de sa main qui n’était pas paralysée le geste de mettre quelque chose dans sa poche et en même temps il cligna de l’œil.
— Sortons, dis-je à Mattia.
Pendant deux ou trois heures, nous nous promenâmes aux environs de la cour du Lion-Rouge, n’osant pas nous éloigner de peur de nous égarer ; et le jour Bethnal-Green me parut encore plus affreux qu’il ne s’était montré la veille dans la nuit : partout dans les maisons aussi bien que dans les gens, la misère avec ce qu’elle a de plus attristant.
Nous regardions, Mattia et moi, mais nous ne disions rien.
Tournant sur nous-mêmes, nous nous trouvâmes à l’un des bouts de notre cour et nous rentrâmes.
Ma mère avait quitté sa chambre ; de la porte je l’aperçus la tête appuyée sur la table : m’imaginant qu’elle était malade, je courus à elle pour l’embrasser, puisque je ne pouvais pas lui parler.
Je la pris dans mes bras, elle releva la tête en la balançant, puis elle me regarda, mais assurément sans me voir ; alors je respirai une odeur de genièvre qu’exhalait son haleine chaude. Je reculai. Elle laissa retomber sa tête sur ses deux bras étalés sur la table.
— Gin , dit mon grand-père.
Et il me regarda en ricanant, disant quelques mots que je ne compris pas.
Tout d’abord je restai immobile comme si j’étais privé de sentiment, puis après quelques secondes je regardai Mattia, qui lui-même me regardait avec des larmes dans les yeux.
Je lui fis un signe et de nouveau nous sortîmes.
Pendant assez longtemps nous marchâmes côte à côte, nous tenant par la main, ne disant rien et allant droit devant nous sans savoir où nous nous dirigions.
— Où donc veux-tu aller ainsi ? demanda Mattia avec une certaine inquiétude.
— Je ne sais pas ; quelque part où nous pourrons causer ; j’ai à te parler, et ici, dans cette foule, je ne pourrais pas.
En effet, dans ma vie errante, par les champs et par les bois, je m’étais habitué, à l’école de Vitalis, à ne jamais rien dire d’important quand nous nous trouvions au milieu d’une rue de ville ou de village, et lorsque j’étais dérangé par les passants je perdais tout de suite mes idées : or, je voulais parler à Mattia sérieusement en sachant bien ce que je dirais.
Au moment où Mattia me posait cette question, nous arrivions dans une rue plus large que les ruelles d’où nous sortions, et il me sembla apercevoir des arbres au bout de cette rue : c’était peut-être la campagne : nous nous dirigeâmes de ce côté. Ce n’était point la campagne, mais c’était un parc immense avec de vastes pelouses vertes et des bouquets de jeunes arbres çà et là. Nous étions là à souhait pour causer.
Ma résolution était bien prise, et je savais ce que je voulais dire :
— Tu sais que je t’aime, mon petit Mattia, dis-je à mon camarade aussitôt que nous fûmes assis dans un endroit écarté et abrité, et tu sais bien, n’est-ce pas, que c’est par amitié que je t’ai demandé de m’accompagner chez mes parents. Tu ne douteras donc pas de mon amitié, n’est-ce pas, quoi que je te demande.
— Que tu es bête ! répondit-il en s’efforçant de sourire.
— Tu voudrais rire pour que je ne m’attendrisse pas, mais cela ne fait rien, si je m’attendris ; avec qui puis-je pleurer si ce n’est avec toi ?
Et me jetant dans les bras de Mattia, je fondis en larmes ; jamais je ne m’étais senti si malheureux quand j’étais seul, perdu au milieu du vaste monde.
Après une crise de sanglots, je m’efforçai de me calmer ; ce n’était pas pour me faire plaindre par Mattia que je l’avais amené dans ce parc, ce n’était pas pour moi, c’était pour lui.
— Mattia, lui dis-je, il faut partir, il faut retourner en France.
— Te quitter, jamais !
— Je savais bien à l’avance que ce serait là ce que tu me répondrais, et je suis heureux, bien heureux, je t’assure, que tu m’aies dit que tu ne me quitterais jamais, cependant il faut me quitter, il faut retourner en France, en Italie, où tu voudras, peu importe, pourvu que tu ne restes pas en Angleterre.
— Et toi, où veux-tu aller ? où veux-tu que nous allions ?
— Moi ! Mais il faut que je reste ici, à Londres, avec ma famille ; n’est-ce pas mon devoir d’habiter près de mes parents ? Prends ce qui nous reste d’argent et pars.
Читать дальше