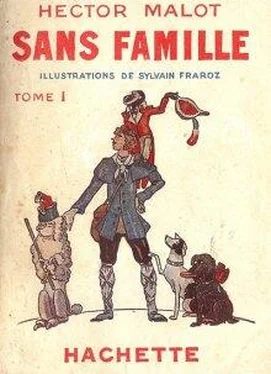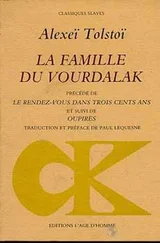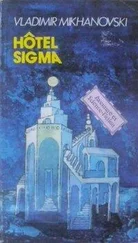Par malheur pour le succès de notre entreprise depuis deux jours le brouillard ne s’était pas éclairci ; le ciel, ou ce qui tient lieu de ciel à Londres, était un nuage de vapeurs orangées, et dans les rues flottait une sorte de fumée grisâtre qui ne permettait à la vue de s’étendre qu’à quelques pas : on sortirait peu, et des fenêtres derrière lesquelles on nous écouterait, on ne verrait guère Capi ; c’était là une fâcheuse condition pour notre recette ; aussi Mattia injuriait-il le brouillard, ce maudit fog , sans se douter du service qu’il devait nous rendre à tous les trois quelques instants plus tard.
Cheminant rapidement, en tenant Capi sur nos talons par un mot que je lui disais de temps en temps, ce qui avec lui valait mieux que la plus solide chaîne, nous étions arrivés dans Holborn qui, on le sait, est une des rues les plus fréquentées et les plus commerçantes de Londres. Tout à coup je m’aperçus que Capi ne nous suivait plus. Qu’était-il devenu ? cela était extraordinaire. Je m’arrêtai pour l’attendre en me jetant dans l’enfoncement d’une allée, et je sifflai doucement, car nous ne pouvions pas voir au loin. J’étais déjà anxieux, craignant qu’il ne nous eût été volé, quand il arriva au galop, tenant dans sa gueule une paire de bas de laine et frétillant de la queue : posant ses pattes de devant contre moi il me présenta ces bas en me disant de les prendre ; il paraissait tout fier, comme lorsqu’il avait bien réussi un de ses tours les plus difficiles, et venait demander mon approbation.
Cela s’était fait en quelques secondes et je restais ébahi, quand brusquement Mattia prit les bas d’une main et de l’autre m’entraîna dans l’allée.
— Marchons vite, me dit-il, mais sans courir.
Ce fut seulement au bout de plusieurs minutes qu’il me donna l’explication de cette fuite.
— Je restais comme toi à me demander d’où venait cette paire de bas, quand j’ai entendu un homme dire : Où est-il le voleur ? le voleur c’était Capi, tu le comprends ; sans le brouillard nous étions arrêtés comme voleurs.
Je ne comprenais que trop, je restai un moment suffoqué : ils avaient fait un voleur de Capi, du bon, de l’honnête Capi !
— Rentrons à la maison, dis-je à Mattia, et tiens Capi en laisse.
Mattia ne me dit pas un mot et nous rentrâmes cour du Lion-Rouge en marchant rapidement. Le père, la mère et les enfants étaient autour de la table occupés à plier des étoffes : je jetai la paire de bas sur la table, ce qui fit rire Allen et Ned.
— Voici une paire de bas, dis-je, que Capi vient de voler, car on a fait de Capi un voleur : je pense que ç’a été pour jouer.
Je tremblais en parlant ainsi, et cependant je ne m’étais jamais senti aussi résolu.
— Et si ce n’était pas un jeu, demanda mon père, que ferais-tu, je te prie ?
— J’attacherais une corde au cou de Capi, et quoique je l’aime bien, j’irais le noyer dans la Tamise : je ne veux pas que Capi devienne un voleur, pas plus que j’en deviendrai un moi-même ; si je pensais que cela doive arriver jamais, j’irais me noyer avec lui tout de suite.
Mon père me regarda en face et il fit un geste de colère comme pour m’assommer ; ses yeux me brûlèrent ; cependant je ne baissai pas les miens ; peu à peu son visage contracté se détendit.
— Tu as eu raison de croire que c’était un jeu, dit-il ; aussi pour que cela ne se reproduise plus, Capi désormais ne sortira qu’avec toi.
Chapitre 16
Les beaux langes ont menti
À toutes mes avances, mes frères Allen et Ned n’avaient jamais répondu que par une antipathie hargneuse, et tout ce que j’avais voulu faire pour eux, ils l’avaient mal accueilli : évidemment je n’étais pas un frère à leurs yeux.
Après l’aventure de Capi, la situation se dessina nettement entre nous, et je leur signifiai, non en paroles, puisque je ne savais pas m’exprimer facilement en anglais, mais par une pantomime vive et expressive, où mes deux poings jouèrent le principal rôle, que s’ils tentaient jamais la moindre chose contre Capi, ils me trouveraient là pour le défendre ou le venger.
N’ayant pas de frères, j’aurais voulu avoir des sœurs ; mais Annie, l’aînée des filles, ne me témoignait pas de meilleurs sentiments que ses frères ; comme eux, elle avait mal reçu mes avances, et elle ne laissait point passer de jour sans me jouer quelque mauvais tour de sa façon, ce à quoi, je dois le dire, elle était fort ingénieuse.
Repoussé par Allen et par Ned, repoussé par Annie, il ne m’était resté que la petite Kate, qui avec ses trois ans était trop jeune pour entrer dans l’association de ses frères et de sa sœur ; elle avait donc bien voulu se laisser caresser par moi, d’abord parce que je lui faisais faire des tours par Capi, et plus tard, lorsque Capi me fut rendu, parce que je lui apportais les bonbons, les gâteaux, les oranges que dans nos représentations les enfants nous donnaient d’un air majestueux en nous disant : « Pour le chien ». Donner des oranges au chien, cela n’était peut-être pas très-sensé, mais je les acceptais avec reconnaissance, car elles me permettaient de gagner ainsi les bonnes grâces de miss Kate.
Ainsi de toute ma famille, cette famille pour laquelle je me sentais tant de tendresse dans le cœur lorsque j’étais débarqué en Angleterre, il n’y avait que la petite Kate qui me permettait de l’aimer ; mon grand-père continuait à cracher furieusement de mon côté toutes les fois que je l’approchais ; mon père ne s’occupait de moi que pour me demander chaque soir le compte de notre recette ; ma mère, le plus souvent n’était pas de ce monde ; Allen, Ned et Annie me détestaient, seule Kate se laissait caresser, encore n’était-ce que parce que mes poches étaient pleines.
Quelle chute !
Aussi dans mon chagrin, et bien que tout d’abord j’eusse repoussé les suppositions de Mattia, en venais-je à me dire que si vraiment j’étais l’enfant de cette famille on aurait pour moi d’autres sentiments que ceux qu’on me témoignait avec si peu de ménagement, alors que je n’avais rien fait pour mériter cette indifférence ou cette dureté.
Quand Mattia me voyait sous l’influence de ces tristes pensées, il devinait très-bien ce qui les provoquait, et alors il me disait, comme s’il se parlait à lui-même :
— Je suis curieux de voir ce que mère Barberin va te répondre.
Pour avoir cette lettre qui devait m’être adressée « poste restante », nous avions changé notre itinéraire de chaque jour, et au lieu de gagner Holborn par West-Smith-Field, nous descendions jusqu’à la poste. Pendant assez longtemps, nous fîmes cette course inutilement, mais à la fin, cette lettre si impatiemment attendue nous fut remise.
L’hôtel général des postes n’est point un endroit favorable à la lecture ; nous gagnâmes une allée dans une ruelle voisine, ce qui me donna le temps de calmer un peu mon émotion, et là enfin, je pus ouvrir la lettre de mère Barberin, c’est-à-dire la lettre qu’elle avait fait écrire par le curé de Chavanon :
« Mon petit Rémi,
« Je suis bien surprise et bien fâchée de ce que ta lettre m’apprend, car selon ce que mon pauvre Barberin m’avait toujours dit aussi bien après t’avoir trouvé avenue de Breteuil, qu’après avoir causé avec la personne qui te cherchait, je pensais que tes parents étaient dans une bonne et même dans une grande position de fortune.
« Cette idée m’était confirmée par la façon dont tu étais habillé lorsque Barberin t’a apporté à Chavanon, et qui disait bien clairement que les objets que tu portais appartenaient à la layette d’un enfant riche. Tu me demandes de t’expliquer comment étaient les langes dans lesquels tu étais emmailloté ; je peux le faire facilement car j’ai conservé tous ces objets en vue de servir à ta reconnaissance le jour où l’on te réclamerait, ce qui selon moi devait arriver certainement.
Читать дальше