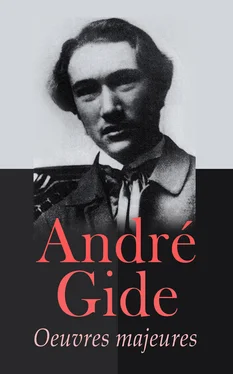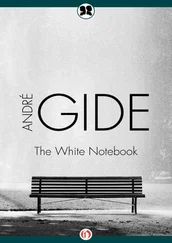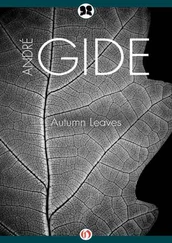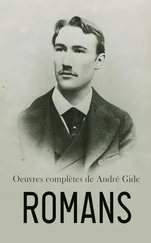Avant Ravenne, où nous nous attarderions donc quinze jours, nous verrions rapidement Rome et Florence, puis, laissant Venise et Vérone, brusquerions la fin du voyage pour ne nous arrêter plus qu’à Paris. Je trouvais un plaisir tout neuf à parler d’avenir avec Marceline ; une certaine indécision restait encore au sujet de l’emploi de l’été ; las de voyages l’un et l’autre, nous voulions ne pas repartir ; je souhaitais pour mes études la plus grande tranquillité ; et nous pensâmes à une propriété de rapport entre Lisieux et Pont-L’Évêque, en la plus verte Normandie, — propriété que possédait jadis ma mère, où j’avais avec elle passé quelques étés de mon enfance, mais où, depuis sa mort, je n’étais pas retourné. Mon père en avait confié l’entretien et la surveillance à un garde, âgé maintenant, qui touchait pour lui puis nous envoyait régulièrement les fermages. Une grande et très agréable maison, dans un jardin coupé d’eaux vives, m’avait laissé des souvenirs enchantés ; on l’appelait La Morinière ; il me semblait qu’il ferait bon y demeurer.
L’hiver prochain, je parlais de le passer à Rome — en travailleur, non plus en voyageur cette fois... Mais ce dernier projet fut vite renversé : dans l’important courrier qui, depuis longtemps, nous attendait à Naples, une lettre m’apprenait brusquement que, se trouvant vacante une chaire au Collège de France, mon nom avait été plusieurs fois prononcé ; ce n’était qu’une suppléance, mais qui précisément, pour l’avenir, me laisserait une plus grande liberté ; l’ami qui m’instruisait de ceci m’indiquait, si je voulais bien accepter, quelques faciles démarches à faire, — et me pressait fort d’accepter. J’hésitai, voyant surtout d’abord un esclavage ; puis songeai qu’il pourrait être intéressant d’exposer, en un cours, mes travaux sur Cassiodore... Le plaisir que j’allais faire à Marceline, en fin de compte me décida. Et, sitôt ma décision prise, je n’en vis plus que l’avantage.
Dans le monde savant de Rome et de Florence, mon père entretenait diverses relations avec qui j’étais moi-même entré en correspondance. Elles me donnèrent tous moyens de faire les recherches que je voudrais, à Ravenne et ailleurs ; je ne songeais plus qu’au travail. Marceline s’ingéniait à le favoriser par mille soins charmants et mille prévenances.
Notre bonheur, durant cette fin de voyage, fut si égal, si calme, que je n’en peux rien raconter. Les plus belles œuvres des hommes sont obstinément douloureuses. Que serait le récit du bonheur ? Rien que ce qui le prépare, puis ce qui le détruit, ne se raconte. Et je vous ai dit maintenant tout ce qui l’avait préparé.
Table des matières
Table des matières
Nous arrivâmes à la Morinière dans les premiers jours de juillet, ne nous étant arrêtés à Paris que le temps strictement nécessaire pour nos approvisionnements et pour quelques rares visites.
La Morinière, je vous l’ai dit, est située entre Lisieux et Pont-L’Évêque, dans le pays le plus ombreux, le plus mouillé que je connaisse. De multiples vallonnements, étroits et mollement courbés, aboutissent non loin à la très large vallée d’Auge qui s’aplanit d’un coup jusqu’à la mer. Nul horizon ; des bois taillis pleins de mystère ; quelques champs, mais des prés surtout, des pacages aux molles pentes, dont l’herbe épaisse est deux fois l’an fauchée, où des pommiers nombreux, quand le soleil est bas, joignent leur ombre, où paissent de libres troupeaux ; dans chaque creux, de l’eau, étang, mare ou rivière ; on entend des ruissellements continus.
Ah ! comme je reconnus bien la maison ! ses toits bleus, ses murs de briques et de pierre, ses douves, les reflets dans les dormantes eaux... C’était une vieille maison où l’on aurait logé plus de douze ; Marceline, trois domestiques, moi-même parfois y aidant, nous avions fort à faire d’en animer une partie. Notre vieux garde, qui se nommait Bocage, avait déjà fait apprêter de son mieux quelques pièces : de leur sommeil de vingt années les vieux meubles se réveillèrent ; tout était resté tel que mon souvenir le voyait, les lambris point trop délabrés, les chambres aisément habitables. Pour nous mieux accueillir, Bocage avait rempli de fleurs tous les vases qu’il avait trouvés. Il avait fait sarcler, ratisser la grand’cour et du parc les plus proches allées. La maison, quand nous arrivâmes, recevait le dernier rayon du soleil, et de la vallée devant elle une immobile brume était montée qui voilait et qui révélait la rivière. Dès avant d’arriver, je reconnus soudain l’odeur de l’herbe ; et quand j’entendis de nouveau tourner autour de la maison les cris aigus des hirondelles, tout le passé soudain se souleva, comme s’il m’attendait et, me reconnaissant, voulait se refermer sur mon approche.
Au bout de quelques jours, la maison devint à peu près confortable ; j’aurais pu me mettre au travail ; je tardais, écoutant encore se rappeler à moi minutieusement mon passé, puis bientôt occupé par une émotion trop nouvelle : Marceline, une semaine après notre arrivée, me confia qu’elle était enceinte.
Il me sembla dès lors que je lui dusse des soins nouveaux, qu’elle eût droit à plus de tendresse ; tout au moins dans les premiers temps qui suivirent sa confidence je passai donc près d’elle presque tous les moments du jour. Nous allions nous asseoir près du bois, sur le banc où jadis j’allais m’asseoir avec ma mère ; là, plus voluptueusement se présentait à nous chaque instant, plus insensiblement coulait l’heure. De cette époque de ma vie, si nul souvenir distinct ne se détache, ce n’est point que j’en garde une moins vive reconnaissance — mais bien parce que tout s’y mêlait, s’y fondait en un uniforme bien-être, où le soir s’unissait au matin sans saccades, où les jours se liaient les uns aux autres sans surprises.
Je repris lentement mon travail, l’esprit calme, dispos, sûr de sa force, regardant le futur avec confiance et sans fièvre, la volonté comme adoucie, et comme écoutant le conseil de cette terre tempérée.
Nul doute, pensais-je, que l’exemple de cette terre, où tout s’apprête au fruit, à l’utile moisson, ne doive avoir sur moi la plus excellente influence. J’admirais quel tranquille avenir promettaient ces robustes bœufs, ces vaches pleines dans ces opulentes prairies. Les pommiers en ordre plantés aux favorables penchants des collines annonçaient cet été des récoltes superbes ; je rêvais sous quelle riche charge de fruits allaient bientôt ployer leurs branches. De cette abondance ordonnée, de cet asservissement joyeux, de ces souriantes cultures, une harmonie s’établissait, non plus fortuite mais dictée, un rythme, une beauté tout à la fois humaine et naturelle, où l’on ne savait plus ce que l’on admirait, tant étaient confondus en une très parfaite entente l’éclatement fécond de la libre nature, l’effort savant de l’homme pour la régler. Que serait cet effort, pensais-je, sans la puissante sauvagerie qu’il domine ? Que serait le sauvage élan de cette sève débordante sans l’intelligent effort qui l’endigue et l’amène en riant au luxe ? — Et je me laissais rêver à telles terres où toutes forces fussent si bien réglées, toutes dépenses si compensées, tous échanges si stricts, que le moindre déchet devînt sensible ; puis, appliquant mon rêve à la vie, je me construisais une éthique qui devenait une science de la parfaite utilisation de soi par une intelligente contrainte.
Où s’enfonçaient, où se cachaient alors mes turbulences de la veille ? Il semblait, tant j’étais calme, qu’elles n’eussent jamais été. Le flot de mon amour les avait recouvertes toutes...
Читать дальше