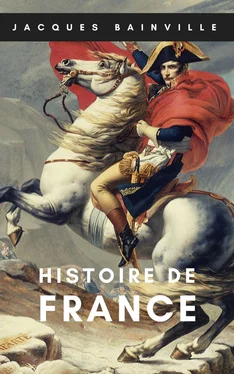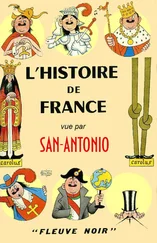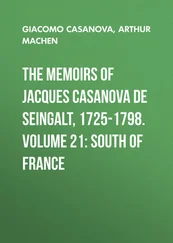Les débuts de la nouvelle monarchie furent extraordinairement heureux et ressemblent d’une façon singulière, mais en plus grand, aux débuts de Clovis. Les Carolingiens savaient ce qu’ils voulaient. Pas une hésitation, pas une faute dans leur marche. À sa mort, en 767, Pépin a pacifié et réuni la Gaule entière, y compris l’indocile Aquitaine. Les derniers Arabes restés en Provence et en Narbonnaise ont repassé les Pyrénées. Loin que le pays soit exposé aux invasions, barbares et infidèles se mettent sur la défensive. Et voilà que le pape, menacé dans Rome par les Lombards, abandonné par l’empereur de Constantinople qui penche déjà vers le schisme, a demandé la protection du roi des Francs. Alors se noue un lien particulier entre la papauté et la France. Pépin constitue et garantit le pouvoir temporel des papes. Par là il assure la liberté du pouvoir spirituel qui, dans la suite des temps, échappera à la servitude de l’Empire germanique, et la France respirera tandis que se dérouleront les luttes du Sacerdoce et de l’Empire. La religion romaine ne pourra pas devenir l’instrument d’une domination européenne : sauvegarde de notre indépendance nationale. Si Pépin n’a pu calculer aussi loin, il savait du moins que, par cette alliance avec l’Église, il affermissait sa dynastie à l’intérieur. Au dehors, la France devenait la première des puissances catholiques, la « fille aînée de l’Église », et c’était une promesse d’influence et d’expansion.
La nouvelle dynastie s’appuyait donc sur l’Église comme l’Église s’appuyait sur elle. Étienne II avait renouvelé la consécration qu’il avait donnée à Pépin. Il avait couronné lui-même le nouveau roi, et ce couronnement, c’était un sacre. De plus le pape avait salué Pépin du titre de patrice avec l’assentiment de l’empereur d’Orient qui se désintéressait de l’Italie. L’union de l’Église et des Carolingiens allait restaurer l’empire d’Occident, devenu l’empire de la chrétienté.
Empereur : ce fut le titre et le rôle de Charles, fils de Pépin, Charles le Grand, Carolus magnus , Charlemagne. Encore a-t-il fallu, pour que Charles fût grand, que son frère Carloman, avec lequel il avait partagé les domaines de Pépin, mourût presque tout de suite. L’autre Carloman, leur oncle, s’était jadis effacé devant son aîné. Sans ces heureuses circonstances au début des deux règnes, on serait retombé dans les divisions mérovingiennes, car déjà Charles et Carloman avaient peine à s’entendre. L’État français ne sera vraiment fondé que le jour où le pouvoir se transmettra de mâle en mâle par ordre de primogéniture. Il faudra attendre les Capétiens.
Cependant Charlemagne eut le bénéfice de l’unité. Il eut aussi celui de la durée. Non seulement l’intelligence et la volonté du souverain étaient supérieures, mais elles purent s’exercer avec suite pendant quarante-cinq ans.
Dès qu’il fut le seul maître, en 771, Charlemagne se mit à l’œuvre. Son but ? Continuer Rome, refaire l’Empire. En Italie, il bat le roi des Lombards et lui prend la couronne de fer. Il passe à l’Espagne : c’est son seul échec. Mais le désastre de Roncevaux, le cor de Roland, servent sa gloire et sa légende : son épopée devient nationale. Surtout, sa grande idée était d’en finir avec la Germanie, de dompter et de civiliser ces barbares, de leur imposer la paix romaine. Sur les cinquante-trois campagnes de son règne, dix-huit eurent pour objet de soumettre les Saxons. Charlemagne alla plus loin que les légions, les consuls et les empereurs de Rome n’étaient jamais allés. Il atteignit jusqu’à l’Elbe. « Nous avons, disait-il fièrement, réduit le pays en province selon l’antique coutume romaine. » Il fut ainsi pour l’Allemagne ce que César avait été pour la Gaule. Mais la matière était ingrate et rebelle. Witikind fut peut-être le héros de l’indépendance germanique, comme Vercingétorix avait été le héros de l’indépendance gauloise. Le résultat fut bien différent. On ne vit pas chez les Germains cet empressement à adopter les mœurs du vainqueur qui avait fait la Gaule romaine. Leurs idoles furent brisées, mais ils gardèrent leur langue et, avec leur langue, leur esprit. Il fallut imposer aux Saxons la civilisation et le baptême sous peine de mort tandis que les Gaulois s’étaient latinisés par goût et convertis au christianisme par amour. La Germanie a été civilisée et christianisée malgré elle, et le succès de Charlemagne fut plus apparent que profond. Pour la « Francie », les peuples d’Outre-Rhin, réfractaires à la latinité, restaient des voisins dangereux, toujours poussés aux invasions. L’Allemagne revendique Charlemagne comme le premier de ses grands souverains nationaux. C’est un énorme contre-sens. Ses faux Césars n’ont jamais suivi l’idée maîtresse, l’idée romaine de Charlemagne : une chrétienté unie. Les contemporains s’abandonnèrent à l’illusion que la Germanie était entrée dans la communauté chrétienne, acquise à la civilisation et qu’elle cessait d’être dangereuse pour ses voisins de l’Ouest. Ils furent un peu comme ceux des nôtres qui ont eu confiance dans le baptême démocratique de l’Allemagne pour la réconcilier avec nous. Cependant Charlemagne avait recommencé Marc-Aurèle et Trajan. Il avait protégé l’Europe contre d’autres barbares, slaves et mongols. Sa puissance s’étendait jusqu’au Danube. L’empire d’Occident était restauré comme il l’avait voulu. Il ne lui manquait plus que la couronne impériale. Il la reçut des mains du pape, en l’an 800, et les peuples, avec le nouvel Auguste, crurent avoir renoué les âges. Restauration éphémère. Mais le titre d’empereur gardera un tel prestige que, mille ans plus tard, c’est encore celui que prendra Napoléon.
De l’Empire reconstitué, Charlemagne voulut être aussi le législateur. Il organisa le gouvernement et la société ; le premier il donna une forme à la féodalité, née spontanément dans l’anarchie des siècles antérieurs et qui, par conséquent, n’avait pas été une invention ni un apport des envahisseurs germaniques. Lorsque l’État romain, puis l’État mérovingien avaient été impuissants à maintenir l’ordre, les faibles, les petits avaient cherché aide et protection auprès des plus forts et des plus riches qui, en échange, avaient demandé un serment de fidélité. « Je te nourrirai, je te défendrai, mais tu me serviras et tu m’obéiras. » Ce contrat de seigneur à vassal était sorti de la nature des choses, de la détresse d’un pays privé d’autorité et d’administration, désolé par les guerres civiles. Les Carolingiens eux-mêmes avaient dû leur fortune à leur qualité de puissants patrons qui possédaient une nombreuse clientèle. L’idée de Charlemagne fut de régulariser ces engagements, de les surveiller, d’en former une hiérarchie administrative et non héréditaire, où entraient « des hommes de rien » et dont le chef suprême serait l’empereur. Charlemagne voyait bien que la féodalité avait déjà des racines trop fortes pour être supprimée par décret. Il voyait aussi qu’elle pourrait devenir dangereuse et provoquer le morcellement de l’autorité et de l’État. Il voulut dominer ce qu’il ne pouvait détruire. Le souverain lui-même, en échange de services civils et militaires, concéda, à titre révocable, à titre de bienfait ( bénéfice ), des portions de son domaine, allégeant ainsi la tâche de l’administration, s’attachant une autre catégorie de vassaux. Ce fut l’origine du fief. Et tout ce système, fondé sur l’assistance mutuelle, était fort bien conçu. Mais il supposait, pour ne pas devenir nuisible, pour ne pas provoquer une autre anarchie, que le pouvoir ne s’affaiblirait pas et que les titulaires de fiefs ne se rendraient pas indépendants et héréditaires, ce qui ne devait pas tarder.
Читать дальше