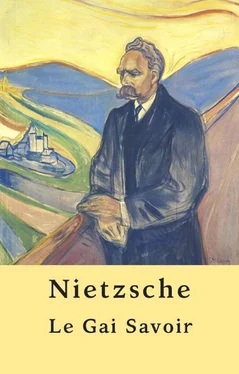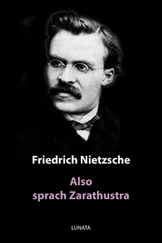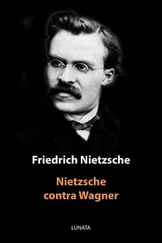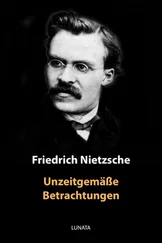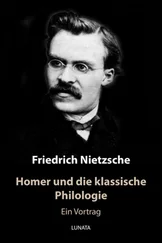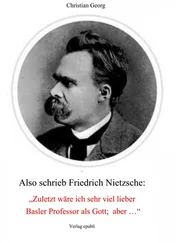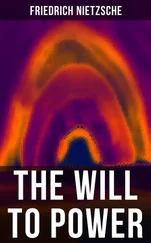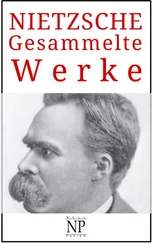NOS ÉRUPTIONS. — Il y a une infinité de choses que l’humanité s’est appropriées pendant des stades antérieurs, mais d’une façon si faible et si embryonnaire que personne n’a pu en percevoir l’appropriation, des choses qui, beaucoup plus tard, peut-être après des siècles, jaillissent soudain à la lumière : elles sont devenues fortes et mûres dans l’intervalle. À certaines époques tel ou tel talent, telle ou telle vertu semblent faire complètement défaut, de même à certains hommes : mais on n’a qu’à attendre jusqu’aux enfants et petits-enfants, si l’on en a le temps, — ceux-ci apportent à la lumière l’âme de leurs grands-parents, cette âme dont les grands-parents eux-mêmes ne savaient rien encore. Souvent le fils déjà devient le révélateur de son père : celui-ci se comprend mieux lui-même depuis qu’il a un fils. Nous avons tous en nous des plantations et des jardins inconnus ; et, pour me servir d’une autre image, nous sommes tous des volcans en travail qui auront leur heure d’éruption : il est vrai que personne ne sait si ce moment est proche ou loin, Dieu lui-même l’ignore.
UNE ESPÈCE D’ATAVISME. — J’interprète le plus volontiers les hommes exceptionnels d’une époque comme les pousses tardives, soudainement émergées, de cultures passées et des forces de ces cultures : en quelque sorte comme l’atavisme d’un peuple et de ses mœurs : — c’est ainsi seulement que l’on pourra trouver chez eux quelque chose à interpréter ! Maintenant ils apparaissent étranges, rares, extraordinaires : et celui qui sent en lui ces forces est obligé de les soigner, de les défendre contre un monde ennemi, de les vénérer et de veiller à leur croissance : et il devient ainsi soit un grand homme, soit un original et un fou, à moins qu’il ne périsse à temps. Autrefois ces qualités rares étaient habituelles et elles étaient, par conséquent, considérées comme vulgaires : elles ne distinguaient point. Peut-être étaient-elles exigées, posées comme condition ; il était impossible de grandir avec elles, pour une raison déjà, c’est qu’il n’y avait pas de danger pour que l’on devienne, avec elles, fou et solitaire. C’est surtout dans les familles, et dans les castes conservatrices d’un peuple que se présentent de pareils contre-coups d’instincts anciens, tandis que l’apparition d’un tel atavisme n’est pas probable là où les races, les usages, les évaluations de valeurs alternent rapidement. Car, parmi les forces d’évolution chez les peuples, l’allure signifie autant qu’en musique ; dans notre cas particulier, un andante de l’évolution est absolument nécessaire, car c’est là l’allure d’un esprit passionné et lent : et c’est de cette espèce qu’est l’esprit des familles conservatrices.
LA CONSCIENCE. — Le conscient est l’évolution dernière et tardive du système organique, et par conséquent aussi ce qu’il y a dans ce système de moins achevé et de moins fort. D’innombrables méprises ont leur origine dans le conscient, des méprises qui font périr un animal, un homme plus tôt qu’il ne serait nécessaire, « malgré le destin, » comme dit Homère. Si le lien conservateur des instincts n’était pas infiniment plus puissant, s’il ne servait pas, dans l’ensemble, de régulateur : l’humanité périrait par ses jugements absurdes, par ses divagations avec les yeux ouverts, par ses jugements superficiels et sa crédulité, en un mot par sa conscience : ou plutôt sans celle-ci elle n’existerait plus depuis longtemps ! Toute fonction, avant d’être développée et mûre, est un danger pour l’organisme : tant mieux si elle est bien tyrannisée pendant son développement. C’est ainsi que le conscient est tyrannisé et pas pour le moins par la fierté que l’on y met ! On s’imagine que c’est là le noyau de l’être humain, ce qu’il a de durable, d’éternel, de primordial ! On tient le conscient pour une quantité stable donnée ! On nie sa croissance, son intermittence ! On le considère comme l’ « unité de l’organisme » ! — Cette ridicule surestimation, cette méconnaissance de la conscience a eu ce résultat heureux que par là le développement trop rapide de la conscience a été empêché. Parce que les hommes croyaient déjà posséder le conscient, ils se sont donné peu de peine pour l’acquérir — et, maintenant encore, il n’en est pas autrement. Une tâche demeure toute nouvelle et à peine perceptible à l’œil humain, à peine clairement reconnaissable, la tâche de s’incorporer le savoir et de le rendre instinctif. Cette tâche ne peut être aperçue que par ceux qui ont compris que, jusqu’à présent, seules nos erreurs ont été incorporées et que toute notre conscience se rapporte à des erreurs !
DU BUT DE LA SCIENCE. — Comment, le dernier but de la science serait de créer à l’homme autant de plaisir et aussi peu de déplaisir que possible ? Mais comment, si le plaisir et le déplaisir étaient tellement solidement liés l’un à l’autre que celui qui voudrait goûter de l’un autant qu’il est possible, serait forcé de goûter aussi de l’autre autant qu’il est possible, — que celui qui voudrait apprendre à « jubiler jusqu’au ciel » devrait aussi se préparer à être « triste jusqu’à la mort » [1] ? Et il en est peut-être ainsi ! Les stoïciens du moins le croyaient, et ils étaient conséquents lorsqu’ils demandaient le moins de plaisir possible pour que la vie leur causât le moins de déplaisir possible (lorsque l’on prononce la sentence « le vertueux est le plus heureux » l’on présente en même temps l’enseigne de l’école aux masses et l’on donne une subtilité casuistique pour les gens les plus subtils). Aujourd’hui encore vous avez le choix : soit aussi peu de déplaisir que possible , bref, l’absence de douleur — et, en somme, les socialistes et les politiciens de tous les partis ne devraient, honnêtement, pas promettre davantage à leurs partisans — soit autant de déplaisir que possible , comme prix pour l’augmentation d’une foule de jouissances et de plaisirs, subtils et rarement goûtés jusqu’ici ! Si vous vous décidez pour la première alternative, si vous voulez diminuer et amoindrir la souffrance des hommes, eh bien ! il vous faudra diminuer et amoindrir aussi la capacité de joie . Il est certain qu’ avec la science on peut favoriser l’un et l’autre but. Peut-être connaît-on maintenant la science plutôt à cause de sa faculté de priver les hommes de leur plaisir et de les rendre plus froids, plus insensibles, plus stoïques. Mais on pourrait aussi lui découvrir des facultés de grande dispensatrice des douleurs . Et alors sa force contraire serait peut-être découverte en même temps, sa faculté immense de faire luire pour la joie un nouveau ciel étoilé !
POUR LA DOCTRINE DU SENTIMENT DE PUISSANCE. — À faire du bien et à faire du mal on exerce sa puissance sur les autres — et l’on ne veut pas davantage ! À faire du mal , sur ceux à qui nous sommes forcés de faire sentir notre puissance ; car la douleur est pour cela un moyen beaucoup plus sensible que le plaisir : — la douleur s’informe toujours des causes, tandis que le plaisir est porté à s’en tenir à lui-même et à ne pas regarder en arrière. À faire le bien et à vouloir le bien sur ceux qui dépendent déjà de nous d’une façon ou d’une autre (c’est-à-dire qui sont habitués à penser à nous comme à leur cause) ; nous voulons augmenter leur puissance puisque de cette façon nous augmentons la nôtre, ou bien nous voulons leur montrer l’avantage qu’il y a à être sous notre domination, — ainsi ils se satisferont davantage de leur situation et seront plus hostiles et plus prêts à la lutte contre les ennemis de notre puissance. Que nous fassions des sacrifices soit à faire le bien, soit à faire le mal, cela ne change pas la valeur définitive de nos actes ; même si nous y apportions notre vie comme fait le martyr en faveur de son église, ce serait un sacrifice apporté à notre besoin de puissance, ou bien en vue de conserver notre sentiment de puissance. Celui qui sent qu’il « est en possession de la vérité » combien d’autres possessions ne laisse-t-il pas échapper pour sauver ce sentiment ! Que de choses ne jette-t-il par par-dessus bord pour se maintenir « en haut », — c’est-à-dire au-dessus de ceux qui sont privés de la vérité ! Certainement la condition où nous nous trouvons pour faire le mal est rarement aussi infiniment agréable que celle où nous nous trouvons pour faire du bien, — c’est là un signe qu’il nous manque encore de la puissance, ou bien c’est la révélation de l’humeur que nous cause cette pauvreté, c’est l’annonce de nouveaux dangers et de nouvelles incertitudes pour notre capital de puissance et notre horizon est voilé par ces précisions de vengeance, de raillerie, de punition, d’insuccès. Ce n’est que pour les hommes les plus irritables et les plus vides du sentiment de puissance qu’il peut être agréable d’imprimer au récalcitrant le sceau de la puissance, pour ceux qui ne voient qu’un fardeau et un ennui dans l’aspect des hommes déjà assujettis (ceux-ci étant l’objet de la bienveillance). Il s’agit de savoir comment on a l’habitude d’ épicer sa vie ; c’est une affaire de goût de préférer l’accroissement de puissance lent ou soudain, sûr ou dangereux et hardi, — on cherche toujours telle ou telle épice selon son tempérament. Un butin facile, pour les natures altières, est quelque chose de méprisable ; un sentiment de bien-être ne leur vient qu’à l’aspect d’hommes non abattus qui pourraient devenir leurs ennemis, et de même à l’aspect de toutes les possessions difficilement accessibles ; ils sont souvent durs envers celui qui souffre, car ils ne le jugent pas digne de leur effort et de leur fierté, mais ils se montrent d’autant plus courtois envers leurs semblables, avec qui la lutte serait certainement honorable, si l’occasion devait s’en présenter. C’est sous l’effet du sentiment de bien-être que procure cette perspective que les hommes d’une caste chevaleresque se sont habitués à l’échange d’une politesse de choix. — La pitié est le sentiment le plus agréable chez ceux qui sont peu fiers et n’ont point l’espérance d’une grande conquête : pour eux, la proie facile — et tel est celui qui souffre — est quelque chose de ravissant. On vante la pitié, comme étant la vertu des filles de joie.
Читать дальше