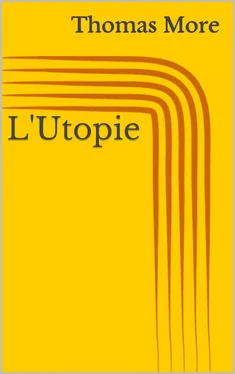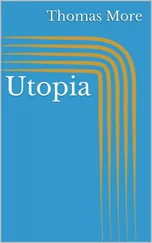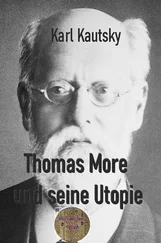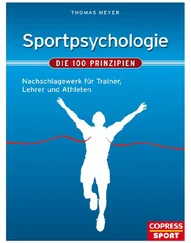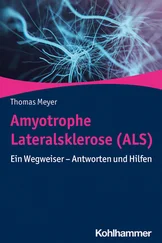Introduction
L’Utopie de Thomas Morus est un renseignement précieux pour les économistes qui étudient les diverses phases de la science sociale ; pour les hommes d’état attentifs aux développements de la politique anglaise.
Du reste, cette publication n’est pas l’œuvre de l’esprit de parti. Il y a loin de la société vraiment évangélique de Thomas Morus au communisme sensuel et athée de nos jours.
Une autre différence essentielle sépare l’Utopie de la plupart des systèmes de nos réformateurs modernes.
Ceux-ci brisent d’un seul coup les nationalités. La nationalité d’un peuple n’est pas, à leurs yeux, la ceinture de sa force et de son indépendance, mais la chaîne qui le retient esclave et affaibli. Ils font des plans immédiats pour le genre humain ; ils prennent tous les peuples à la fois, sans distinction d’âge ni de mœurs ; puis les jettent pêle-mêle dans le moule où doit se fondre la grande famille homogène, une, indissoluble.
Thomas Morus ne procède pas ainsi. Son livre n’est pas précisément le code du genre humain, ni le programme de la paix universelle. C’est plutôt une formule d’organisation intérieure et de politique extérieure, à l’usage d’une nation distincte qui, pour un Anglais, ne pouvait être que l’Angleterre. Cette nation, au point de vue de l’auteur, a sur les pays voisins la supériorité d’intelligence, de richesse, d’activité et d’influence. Peu à peu elle les absorbe dans sa propre substance ; elle les assimile à sa vie sociale par le commerce, la colonisation, la conquête. Cette assimilation progressive de plusieurs peuples en un seul n’est-elle pas la marche naturelle des choses ? Du moins, l’histoire tend à prouver que, jusqu’à présent ; telle a été la loi des destinées humaines.
La rédaction de l’Utopie est rapide, concise et méthodique ; on voit que l’auteur n’avait pas de temps à perdre, et qu’il se pressait d’enfermer une foule d’idées sous le plus petit volume. La forme de l’ouvrage est très simple ; c’est une conversation intime où Thomas Morus aborde ex abrupto les questions les plus neuves et les plus difficiles. Sa parole est tantôt satirique et enjouée, tantôt d’une sensibilité touchante, souvent d’une énergie sublime. Chez cet homme de bien, le cœur parlait aussi fort que la tête.
L’Utopie se divise en deux livres : l’un critique et l’autre dogmatique.
Le premier livre est le miroir fidèle des injustices et des misères de la société féodale ; il est, en particulier, le martyrologe du peuple anglais sous le règne de Henri VII. Ce prince, qu’une insurrection avait fait roi, eut à combattre plus d’une insurrection pour se maintenir. Il versa donc le sang de ses sujets ; mais sa préoccupation dominante fut de prendre leur argent, par tous les moyens qu’un pouvoir à peu près sans limite fournissait à la cupidité la plus effrénée. Il entassa impôts sur impôts, couvrit l’Angleterre d’un vaste réseau de prohibitions, de délits et d’amendes, et fit de la justice un vrai crible, par où il tamisait toutes les fortunes privées. Le Parlement, au lieu de résister aux ignobles instincts du monarque, lui servait absolument de machine à battre monnaie [1].
Le peuple d’Angleterre n’était pas seulement la victime de l’avarice de son roi, d’autres causes d’oppression et de souffrance le tourmentaient encore. La noblesse possédait, de commun avec le clergé, la majeure partie du sol et de la richesse publique ; et ces biens immenses, placés dans des mains paresseuses ou égoïstes, demeuraient stériles pour la masse des travailleurs. De plus, à cette époque d’anarchie, les grands seigneurs entretenaient à leurs gages une multitude de valets armés, soit par amour du faste, soit pour s’assurer l’impunité, soit pour en faire des instruments en toute occasion de violence ou de débauche. Cette valetaille était le fléau et la terreur du paysan et de l’ouvrier. D’un autre côté, le commerce et l’industrie de la Grande-Bretagne ne pouvaient avoir qu’une existence chétive et bornée, avant les voyages de Colomb et de Gama. L’activité infatigable de ce peuple, qui menace aujourd’hui d’envahir tout le globe, se consumait dans les guerres civiles, ne trouvant pas d’issue au dehors. Ainsi, les générations s’accumulaient sans but, sans travail et sans pain. L’agriculture tombait en ruine, parce que la culture proprement dite était délaissée pour l’élève des bêtes à laine, opération qui donnait alors de brillants bénéfices. En conséquence, les gros capitalistes accaparaient le sol outre mesure, changeaient les terres labourables en prairies ; ce qui réduisait une foule de gens de la campagne à la plus affreuse disette.
Ce triste état de choses multipliait nécessairement dans une progression effrayante la mendicité, le vagabondage, le vol et l’assassinat. Au lieu de guérir tant de maux par une administration habile et bienfaisante, les politiques du temps ne savaient leur appliquer d’autres remèdes que la prison et le bourreau. La loi anglaise était même sévère jusqu’à l’absurdité et la barbarie ; elle tuait indistinctement le voleur et l’assassin, pressée, pour ainsi dire, de noyer la misère publique dans le sang.
On concevra maintenant l’amertume des critiques et la violence des colères de Thomas Morus contre une société aussi profondément désorganisée. Sa malédiction est impitoyable pour le privilégié oisif et corrompu ; sa compassion, pleine d’amour et de larmes pour le malheureux qui travaille et qui souffre. Depuis l’Utopie, rien n’a été écrit de plus hardi, de plus neuf, de plus révolutionnaire et de plus démocratique en fait de démolition et de réforme. À lire ces pages toutes brûlantes de la passion de la justice, on croit entendre le jugement dernier des iniquités sociales, et comme une prophétie des terribles représailles exercées par Cromwell, et chez nous par 93.
Si l’auteur de l’Utopie est dans la vérité quand il attaque la législation et l’administration de son pays, il n’a pas le même droit d’accuser la politique de la France. Louis XII et François I erétaient des types d’honneur et de loyauté auprès de souverains tels que Ferdinand le Catholique, Maximilien I er, Jules II, Léon X et Henri VIII. Mais l’année où l’Utopie fut écrite (1516), le cardinal Wolsey, violant les traités d’avril 1515, payait secrètement l’invasion du duché de Milan par l’empereur, préparait une coalition contre François I er, et cherchait à détacher le peu d’alliés fidèles à ce prince. Thomas Morus, que le cardinal avait récemment chargé d’une mission diplomatique en Flandre, devait subir l’influence de ces événements, sans parler de l’influence éternelle de l’antagonisme national. Voilà pourquoi il épouvante ses lecteurs du fantôme de l’ambition de la France ; rappelle à l’archiduc Charles ses mariages manqués avec les princesses Claude et Renée ; rappelle aux Vénitiens le traité de Blois et la ligue de Cambrai, qui leur reprit Crémone et la Ghiarra d’Adda ; pourquoi il justifie, par l’énumération de prétendus griefs, la violation flagrante des traités que la cour de Londres commettait alors.
Le plus singulier de ces griefs est dans le reproche adressé au ministère français de se méfier de la stabilité de l’alliance anglaise. Certes, il y avait de bonnes raisons pour cela ; et, au commencement du seizième siècle, cette alliance se manifestait déjà extrêmement inconstante et mobile. Depuis le 23 mars 1510 jusqu’en avril 1515, l’Angleterre avait fait avec la France trois traités d’amitié et de paix, et signé contre elle trois ligues de guerre offensive. À l’heure même où l’auteur de l’Utopie se plaint de la méfiance des ministres français, Wolsey continuait à ourdir cette suite d’intrigues d’où sortit la ligue défensive de Londres, du 29 octobre 1516 [2].
Читать дальше