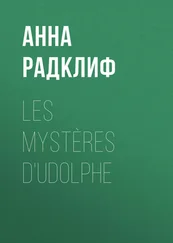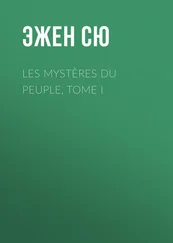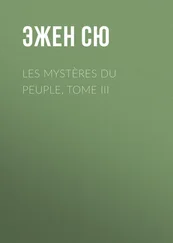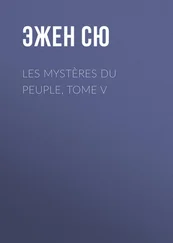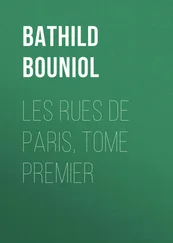Jouir de tout et toujours, c’était, selon l’abbé, glorifier Dieu dans sa magnificence et dans l’éternité de ses dons.
Ces théories portèrent leurs fruits.
Au milieu de cette cour régulière et vertueuse, habituée, par l’exemple du maître, aux honnêtes plaisirs, aux innocentes distractions, Rodolphe, instruit par l’abbé, rêvait déjà les folles nuits de Versailles, les orgies de Choisy, les violentes voluptés du Parc-aux-Cerfs, et aussi çà et là, par contraste, quelques amours romanesques.
L’abbé n’avait pas manqué non plus de démontrer à Rodolphe qu’un prince de la Confédération germanique ne pouvait avoir d’autre prétention militaire que celle d’envoyer son contingent à la Diète.
D’ailleurs, l’esprit du temps n’était plus à la guerre.
Couler délicieusement et paresseusement ses jours au milieu des femmes et des raffinements du luxe, se reposer tour à tour de l’enivrement des plaisirs sensuels par les délicieuses récréations des arts, chercher parfois dans la chasse, non pas en sauvage Nemrod, mais en intelligent épicurien, ces fatigues passagères qui doublent le charme de l’indolence et de la paresse, telle était, selon l’abbé, la seule vie possible pour un prince qui (comble de bonheur!) trouvait un Premier ministre capable de se vouer courageusement au fastidieux et lourd fardeau des affaires de l’État.
Rodolphe, en se laissant aller à des suppositions qui n’avaient rien de criminel parce qu’elles ne sortaient pas du cercle des probabilités fatales, se proposait, lorsque Dieu rappellerait à lui le grand-duc son père, de se vouer à cette vie que l’abbé Polidori lui peignait sous de si chaudes et de si riantes couleurs, et de prendre ce prêtre pour Premier ministre.
Nous le répétons, Rodolphe aimait tendrement son père, et il l’eût profondément regretté, quoique sa mort lui eût permis de faire le Sardanapale au petit pied. Il est inutile de dire que le jeune prince gardait le plus profond secret sur les malheureuses espérances qui fermentaient en lui.
Sachant que les héros de prédilection du grand-duc étaient Gustave-Adolphe, Charles XII et le grand Frédéric (Maximilien-Rodolphe avait l’honneur d’appartenir de très-près à la maison royale de Brandebourg), Rodolphe pensait avec raison que son père, qui professait une admiration profonde pour ces rois-capitaines toujours bottés et éperonnés, chevauchant et guerroyant, regarderait son fils comme perdu s’il le croyait capable de vouloir remplacer dans sa cour la gravité tudesque par les mœurs faciles et licencieuses de la Régence. Un an, dix-huit mois se passèrent ainsi; Murph n’était pas encore de retour, quoiqu’il annonçât prochainement son arrivée.
Sa première répugnance vaincue par l’obséquiosité de l’abbé, Rodolphe profita des enseignements scientifiques de son précepteur et acquit sinon une instruction très-étendue, au moins des connaissances superficielles, qui, jointes à un esprit naturel, vif et sage, lui permettaient de passer pour beaucoup plus instruit qu’il ne l’était réellement et de faire le plus grand honneur aux soins de l’abbé.
Murph revint d’Angleterre avec sa famille et pleura de joie en embrassant son ancien élève.
Au bout de quelques jours, sans pouvoir pénétrer la raison d’un changement qui l’affligeait profondément, le digne squire trouva Rodolphe froid, contraint envers lui, et presque ironique lorsqu’il lui rappela leur vie rude et agreste.
Certain de la bonté naturelle du cœur du jeune prince, averti par un secret pressentiment, Murph le crut momentanément perverti par la pernicieuse influence de l’abbé Polidori qu’il détestait d’instinct, et qu’il se promettait d’observer attentivement.
De son côté, le prêtre, vivement contrarié du retour de Murph, dont il redoutait la franchise, le bon sens et la pénétration, n’eut qu’une seule pensée, celle de perdre le gentilhomme dans l’esprit de Rodolphe.
C’est à cette époque que Tom et Sarah furent présentés et accueillis à la cour de Gerolstein avec la plus extrême distinction.
Quelque temps avant leur arrivée, Rodolphe était parti avec un aide de camp et Murph pour inspecter les troupes de quelques garnisons. Cette excursion étant toute militaire, le grand-duc avait jugé convenable que l’abbé ne fût pas de ce voyage. Le prêtre, à son grand regret, vif Murph reprendre pour quelques jours ses anciennes fonctions auprès du jeune prince.
Le squire comptait beaucoup sur cette occasion de s’éclairer tout à fait sur la cause du refroidissement de Rodolphe. Malheureusement celui-ci, déjà savant dans l’art de dissimuler, et croyant dangereux de laisser pénétrer ses projets d’avenir par son ancien mentor, fut pour lui d’une cordialité charmante, feignit de regretter beaucoup le temps de sa première jeunesse et ses rustiques plaisirs, et le rassura presque complètement.
Nous disons presque, car certains dévouements sont doués d’un admirable instinct. Malgré les témoignages d’affection que lui donnait le jeune prince, Murph pressentait vaguement qu’il y avait un secret entre eux deux; en vain il voulut éclaircir ses soupçons, ses tentatives échouèrent devant la précoce duplicité de Rodolphe.
Pendant ce voyage, l’abbé n’était pas resté oisif.
Les intrigants se devinent ou se reconnaissent à certains signes mystérieux qui leur permettent de s’observer jusqu’à ce que leur intérêt les décide à une alliance ou à une hostilité déclarée.
Quelques jours après l’établissement de Sarah et de son frère à la cour du grand-duc, Tom était particulièrement lié avec l’abbé Polidori.
Ce prêtre s’avouait à lui-même, avec un odieux cynisme, qu’il avait une affinité naturelle, presque involontaire, pour les fourbes et pour les méchants; ainsi, disait-il, sans deviner positivement le but où tendaient Tom et Sarah, il s’était trouvé attiré vers eux par une sympathie trop vive pour ne pas leur supposer quelque dessein diabolique.
Quelques questions de Tom Seyton sur le caractère et les antécédents de Rodolphe, questions sans portée pour un homme moins en éveil que l’abbé, l’éclairèrent tout à coup sur les tendances du frère et de la sœur; seulement il ne crut pas à la jeune Écossaise des vues à la fois si honnêtes et si ambitieuses.
La venue de cette charmante fille parut à l’abbé un coup du sort. Rodolphe avait l’imagination enflammée d’amoureuses chimères; Sarah devait être la réalité ravissante qui remplacerait tant de songes charmants; car, pensait l’abbé, avant d’arriver au choix dans le plaisir et à la variété dans la volupté, on commence presque toujours par un attachement unique et romanesque. Louis XIV et Louis XV n’ont été peut-être fidèles qu’à Marie Mancini et à Rosette d’Arey.
Selon l’abbé, il en serait ainsi de Rodolphe et de la belle Écossaise. Celle-ci prendrait sans doute une immense influence sur un cœur soumis au charme enchanteur d’un premier amour. Diriger, exploiter cette influence et s’en servir pour perdre Murph à jamais, tel fut le plan de l’abbé.
En homme habile, il fit parfaitement entendre aux deux ambitieux qu’il faudrait compter avec lui, étant seul responsable auprès du grand-duc de la vie privée du jeune prince.
Ce n’était pas tout, il fallait se défier d’un ancien précepteur de ce dernier qui l’accompagnait alors dans une inspection militaire; cet homme rude, grossier, hérissé de préjugés absurdes, avait eu autrefois une grande autorité sur l’esprit de Rodolphe et pouvait devenir un surveillant dangereux; et, loin d’excuser ou de tolérer les folles et charmantes erreurs de la jeunesse, il se regarderait comme obligé de les dénoncer à la sévère morale du grand-duc.
Читать дальше