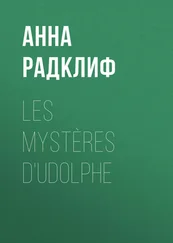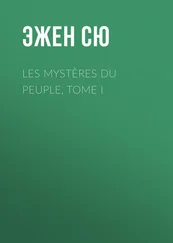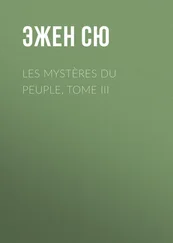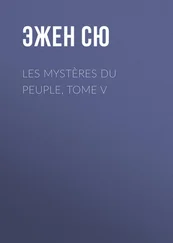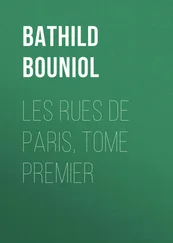Malheureusement, cet espoir insensé ne dura pas longtemps: le prince termina la conversation en me disant que le temps des grandes guerres était fini; que je devais profiter de mon nom, de mes alliances, de l’éducation que j’avais reçue et de l’étroite amitié qui unissait mon père au prince de M. Premier ministre de l’empereur, pour parcourir la carrière diplomatique au lieu de la carrière militaire, ajoutant que toutes les questions qui se décidaient autrefois sur les champs de bataille se décideraient désormais dans les congrès; que bientôt les traditions tortueuses et perfides de l’ancienne diplomatie feraient place à une politique large et humaine, en rapport avec les véritables intérêts des peuples, qui de jour en jour avaient davantage la conscience de leurs droits; qu’un esprit élevé, loyal et généreux pourrait avoir avant quelques années un noble et grand rôle à jouer dans les affaires politiques, et faire ainsi beaucoup de bien. Il me proposait enfin le concours de sa souveraine protection pour me faciliter les abords de la carrière qu’il m’engageait instamment à parcourir.
Vous comprenez, mon ami, que si le prince avait eu le moindre projet sur moi, il ne m’eût pas fait de telles ouvertures. Je le remerciai de ses offres avec une vive reconnaissance, en ajoutant que je sentais tout le prix de ses conseils, et que j’étais décidé à les suivre.
J’avais d’abord mis la plus grande réserve dans mes visites au palais; mais, grâce à l’insistance du grand-duc, j’y vins bientôt presque chaque jour vers les trois heures. On y vivait dans toute la charmante simplicité de nos cours germaniques. C’était la vie des grands châteaux d’Angleterre, rendue plus attrayante par la simplicité cordiale, la douce liberté des mœurs allemandes. Lorsque le temps le permettait, nous faisions de longues promenades à cheval avec le grand-duc, la grande-duchesse, ma cousine, et les personnes de leur maison. Lorsque nous restions au palais, nous nous occupions de musique, je chantais avec la grande-duchesse et ma cousine, dont la voix avait un timbre d’une pureté, d’une suavité sans égales, et que je n’ai jamais pu entendre sans me sentir remué jusqu’au fond de l’âme. D’autres fois, nous visitions en détail les merveilleuses collections de tableaux et d’objets d’art, ou les admirables bibliothèques du prince, qui, vous le savez, est un des hommes les plus savants et les plus éclairés de l’Europe; assez souvent je revenais dîner au palais, et, les jours d’Opéra, j’accompagnais au théâtre la famille grand-ducale.
Chaque jour passait comme un songe; peu à peu ma cousine me traita avec une familiarité toute fraternelle; elle ne me cachait pas le plaisir qu’elle éprouvait à me voir, elle me confiait tout ce qui l’intéressait; deux ou trois fois elle me pria de l’accompagner lorsqu’elle allait avec la grande-duchesse visiter ses jeunes orphelines; souvent aussi elle me parlait de mon avenir avec une maturité de raison, avec un intérêt sérieux et réfléchi qui me confondait de la part d’une jeune fille de son âge; elle aimait aussi beaucoup à s’informer de mon enfance, de ma mère, hélas! toujours si regrettée. Chaque fois que j’écrivais à mon père, elle me priait de la rappeler à son souvenir; puis, comme elle brodait à ravir, elle me remit un jour pour lui une charmante tapisserie à laquelle elle avait longtemps travaillé. Que vous dirai-je, mon ami? un frère et une sœur, se retrouvant après de longues années de séparation, n’eussent pas joui d’une intimité plus douce. Du reste, lorsque, par le plus grand des hasards, nous restions seuls, l’arrivée d’un tiers ne pouvait jamais changer le sujet ou même l’accent de notre conversation.
Vous vous étonnerez peut-être, mon ami, de cette fraternité entre deux jeunes gens, surtout en songeant aux aveux que je vous fais; mais plus ma cousine me témoignait de confiance et de familiarité, plus je m’observais, plus je me contraignais, de peur de voir cesser cette adorable familiarité. Et puis, ce qui augmentait encore ma réserve, c’est que la princesse mettait dans ses relations avec moi tant de franchise, tant de noble confiance, et surtout si peu de coquetterie, que je suis presque certain qu’elle a toujours ignoré ma violente passion. Il me reste un léger doute à ce sujet, à propos d’une circonstance que je vous raconterai tout à l’heure.
Si cette intimité fraternelle avait dû toujours durer, peut-être ce bonheur m’eût suffi; mais par cela même que j’en jouissais avec délices, je songeais que bientôt mon service ou la carrière que le prince m’engageait à parcourir m’appellerait à Vienne ou à l’étranger; je songeais enfin que prochainement peut-être le grand-duc penserait à marier sa fille d’une manière digne d’elle…
Ces pensées me devinrent d’autant plus pénibles que le moment de mon départ approchait. Ma cousine remarqua bientôt le changement qui s’était opéré en moi. La veille du jour où je la quittai, elle me dit que depuis quelque temps, elle me trouvait sombre, préoccupée. Je tâchai d’éluder ces questions, j’attribuai ma tristesse à un vague ennui.
– Je ne puis vous croire, me dit-elle; mon père vous traite presque comme un fils, tout le monde vous aime; vous trouver malheureux serait de l’ingratitude.
– Eh bien! lui dis-je sans pouvoir vaincre mon émotion, ce n’est pas de l’ennui, c’est du chagrin, oui, c’est un profond chagrin que j’éprouve.
– Et pourquoi? Que vous est-il arrivé? me demanda-t-elle avec intérêt.
– Tout à l’heure, ma cousine, vous m’avez dit que votre père me traitait comme un fils… qu’ici tout le monde m’aimait… Eh bien! avant peu il me faudra renoncer à ces affections si précieuses, il faudra enfin… quitter Gerolstein, et je vous l’avoue, cette pensée me désespère.
– Et le souvenir de ceux qui nous sont chers… n’est-ce donc rien, mon cousin?
– Sans doute… mais les années, mais les événements amènent tant de changements imprévus!
– Il est du moins des affections qui ne sont pas changeantes: celle que mon père vous a toujours témoignée… celle que je ressens pour vous est de ce nombre, vous le savez bien; on est frère et sœur… pour ne jamais s’oublier, ajouta-t-elle en levant sur moi ses grands yeux bleus humides de larmes.
Ce regard me bouleversa, je fus sur le point de me trahir; heureusement je me contins.
– Il est vrai que les affections durent, lui dis-je avec embarras; mais les positions changent… Ainsi, ma cousine, quand je reviendrai dans quelques années, croyez-vous qu’alors cette intimité, dont j’apprécie tout le charme, puisse encore durer?
– Pourquoi ne durerait-elle pas?
– C’est qu’alors vous serez sans doute mariée, ma cousine… vous aurez d’autres devoirs… et vous aurez oublié votre pauvre frère.
Je vous le jure, mon ami, je ne lui dis rien de plus; j’ignore encore si elle vit dans ces mots un aveu qui l’offensa, ou si elle fut comme moi douloureusement frappée des changements inévitables que l’avenir devait nécessairement apporter à nos relations; mais, au lieu de me répondre, elle resta un moment silencieuse, accablée; puis, se levant brusquement, la figure pâle, altérée, elle sortit après avoir regardé pendant quelques secondes la tapisserie de la jeune comtesse d’Oppenheim, une de ses dames d’honneur, qui travaillait dans l’embrasure d’une des fenêtres du salon où avait lieu notre entretien.
Le soir même de ce jour, je reçus de mon père une nouvelle lettre qui me rappelait précipitamment ici. Le lendemain matin j’allai prendre congé du grand-duc; il me dit que ma cousine était un peu souffrante, qu’il se chargerait de mes adieux pour elle; il me serra paternellement dans ses bras, regrettant, ajouta-t-il, mon prompt départ, et surtout que ce départ fût causé par les inquiétudes que me donnait la santé de mon père; puis, me rappelant avec la plus grande bonté ses conseils au sujet de la nouvelle carrière qu’il m’engageait très-instamment à embrasser, il ajouta qu’au retour de mes missions, ou pendant mes congés, il me reverrait toujours à Gerolstein avec un vif plaisir.
Читать дальше