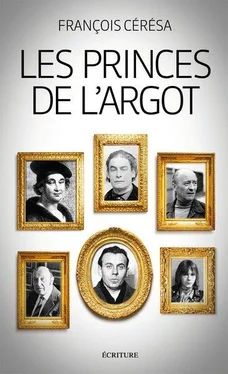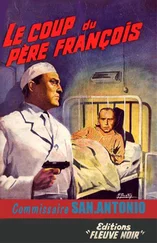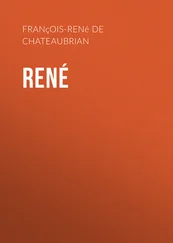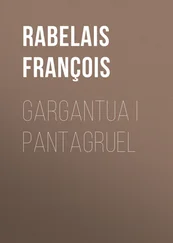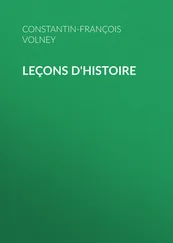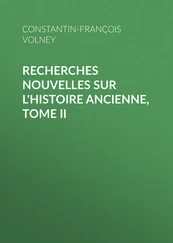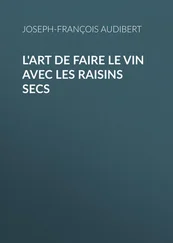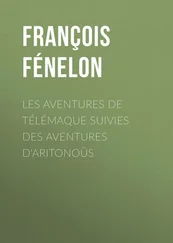Nous ne sommes pas là pour raconter (seulement pour résumer) la vie d’un sacré loustic qui, après en avoir pris pour huit ans de chapeau de paille, après s’être évadé trois fois du collège (bagne), après avoir été le chef d’une brigade recrutée parmi les forçats libérés en 1809, mériterait un livre à lui seul — essentiellement pour le langage. Le langage, Vidocq, il connaît. Asticoté par des encombrants en 1827 (en fait, une basse intrigue), il est contraint de démissionner de la Sûreté criminelle qu’il avait créée et dirigeait depuis dix-huit ans. Il en profite pour écrire ses Mémoires , les publier en 1828 et récidiver dix ans plus tard avec Les Voleurs , un livre sans grand intérêt, rédigé par un gratte-papier, qui propose néanmoins quelques lettres de pégriots, dont celle-ci, où un voleur déclare sa flamme à la fille pour qui il a le béguin :
Girofle largue,
Depuis le relui où j’ai gambillé avec tézigue et remouché tes chasses et ta frime d’altèque, le dardant a coqué le rifle dans mon palpitant, qui n’aquige plus que pour tézigue ; je ne roupille que poitou ; je paumerai la sorbonne si ton palpitant ne fade pas les sentiments du mien. Le relui et la sorgue, je ne rembroque que tézigue, et si tu ne prends à la bonne, tu m’allumeras bientôt caner.
Traduction :
Aimable femme,
Depuis le jour où j’ai dansé avec toi et vu tes jolis yeux et ta mine piquante, l’amour a mis le feu dans mon cœur qui ne bat plus que pour toi ; je ne dors plus, je perdrai la tête si ton cœur ne partage pas les sentiments du mien. Le jour et la nuit, je ne vois que toi et, si tu ne m’aimes, tu me verras bientôt mourir.
✩
Tout cela respire le laborieux. On sent que le gratte-papier a fanfaronné de la plume. Dans les Mémoires , autre son de cor. C’est du sérieux. Les expressions s’emmanchent au fond des bois. Encanaillement garanti. Du coup, énorme succès commercial. Un vrai roman policier, avec tout ce qu’il faut de picaresque pour entartiner le caveton. De Bicêtre à Toulon, on croise des effaceurs qui ont fait suer un chêne (qui ont tué un homme), qui maquillent à la sorgue (qui volent la nuit), qui écornent des boucards (qui dévalisent des boutiques), qui ont envie de buter un riflard qui a battu morasse (un bourgeois qui a crié au secours), un guinal qui refourgue des coucous et des brides d’Orient (un juif qui revend des montres et des chaînes d’or). Le pantre est le bourgeois, le canapé le rencard des invertis (il y en a un rue Saint-Fiacre !). La tronche est la figure, la tante l’homosexuel. Le taf est la peur, se faire arquepincer signifie se faire arrêter, etc. Tout l’argot moderne se profile. Le personnage de Vidocq ne manque pas d’envergure. On se souvient de Bernard Noël dans Les Aventures de Vidocq , réalisées par Marcel Bluwal, et des Nouvelles Aventures de Vidocq avec Claude Brasseur, toujours mises en scène par Marcel Bluwal. C’était de la bonne télé. L’excellent Bernard Noël, mort à quarante-cinq ans d’un cancer, avait le bagout, la carrure et l’ampleur de l’ancien bagnard. On imagine bien le moujingue d’Arras, déjà ficelle, ce qui est normal pour un fils de boulanger, commettre divers larcins, voler ses darons, s’engager dans l’armée révolutionnaire, se battre à Valmy, à Jemappes, quitter l’armée, arnaquer et escroquer de pauvres imbéciles entre Paris et le nord de la France. Il faut attendre 1796 pour le voir condamné à huit ans de travaux forcés pour « faux en écritures publiques et authentiques ». À Bicêtre, il est initié à la savate (un ersatz de karaté et de boxe française), puis incorporé dans la chaîne de Bicêtre. Côté jactance, il est vite au courant. Dans les Mémoires , ça donne :
Il était difficile que le capitaine, c’était Viez, ne s’enivrât pas un peu de ces hommages ; cependant comme il était habitué à de pareils honneurs, il ne perdait pas la tête, et il reconnaissait parfaitement les siens. Il aperçut Desfosseux : « Ah ! ah ! dit-il, voilà un ferlanpier qui a déjà voyagé avec nous. Il m’est revenu que tu as manqué d’être fauché à Douai, mon garçon… »
On s’aperçoit que Vidocq ne néglige pas le classique. C’est presque lumineux. À l’exception de « ferlanpier » (qui signifie « vaurien »), Vidocq (ou plutôt son éditeur Tenon — il vaut mieux se procurer l’édition de Jean Savant) ne multiplie pas les effets argotiques. On dirait La Scoumoune . Vidocq écrit sa langue, comme il dit.
Après Bicêtre, Brest. Dans l’air iodé, aucun parfum de crêpe au calva ou de far au beurre. Vidocq est à la traverse. Il essaye deux fois de se faire la belle. On le repère. C’est un numéro. À propos de la belle, connaissait-on déjà la chanson citée par Albert Londres dans Adieu Cayenne ?
Tes amants t’appellent la Belle
Tout net, tout court.
Le boiteux, l’aveugle, le sourd,
En pensant à toi mon amour
Ont des ailes !
Vidocq connaît la chanson, mais pas les chansons. Et en fait de chanter, il déchante. Le tout dans le jargon des fourchettes, des poisses, des piqueurs, des chourineurs, des psychopathes, de tous ces repris de justice qui ont la cervelle dans les saloirs. Ce qu’il projette, c’est de s’évader. Et à fond la gamelle. Puisqu’on le considère comme un caïd, il va leur montrer un peu. C’est un affranchi. Rien à voir avec le film stupide de Pitof avec Depardieu en Vidocq assailli par les effets spéciaux. Une histoire qui ne tient pas debout, truffée de sciences occultes et de magie noire, chère à l’amphigourique Jean-Christophe Grangé, roi du meurtre trashy et des guignolades façon Scream . Pour trouver un Vidocq qui tient la route vingt-quatre images par seconde, il vaut revoir la version muette de Gérard Bourgeois, Vidocq , tournée en 1911, avec l’emblématique Harry Baur, futur Jean Valjean des Misérables de Raymond Bernard (tiens, comme c’est bizarre !).
Quoi qu’il en soit, Vidocq, du haut de son mètre soixante-dix, ce qui n’est pas si mal à l’époque, cheveux châtain clair, œil gris, nez droit, solide des épaules et du bréchet, s’évade de Brest déguisé en matelot (c’est un vrai transformiste). Il est repris en 1799 et s’évade de nouveau en 1800. Au large, cognes, marloupattes et forcenés de la bagouse, c’est presque la quille !
✩
Entre Toulon et Lyon, Vidocq ne rencontre pas d’évêque Myriel et ne vole pas de chandelier. Les durs du milieu l’ont à la bonne. C’est une réalité : on le respecte. Avec sa gueule carrée, il n’aime pas la rondeur. Ce type qui ne se bat que pour sa cause a acquis une notoriété sans égale. Quand il enquille l’honnêteté et jette aux orties sa défroque de mauvais garçon, ça frissonne dans le mitan. On perd ses bas. Que se passe-t-il ? La révolution des cultures ? Le bouleversement des équilibres ? Bref, le jour où Vidocq propose ses services d’indicateur à la police de Paris, il a trente-quatre ans, un pedigree de grand sachem, une connaissance encyclopédique de la cognade (l’ensemble de la maréchaussée), et surtout une envie métaphysique de chanstiquer. Et pour changer, il changera. C’est un arriviste, Vidocq. Rester un pousse-mégots, c’est hors de question. Il va se donner les moyens de réussir dans la renifle (la police). Et sans perdre un instant.
Aussi vite dit, aussi vite fait. Voie impériale avec Napoléon et Fouché, voie royale avec les roitelets qui suivent. Vidocq va se frotter avec tous les indélicats de la capitale, et même avec les chauffeurs du Nord, ceux qui vous raffaudent les paturons (chauffent les pieds) pour savoir où vous avez planquarès le carle (l’argent), les éconocroques, des flaculs pleins de billes (des sacs pleins de pièces). Bon nombre de chourineurs (assassins) et de boucardiers (voleurs) se font raccourcir sur la veuve rasibus (guillotine). Tout peut se lire dans les quatre volumes des Mémoires . C’est rapide comme le courant d’air du couperet.
Читать дальше