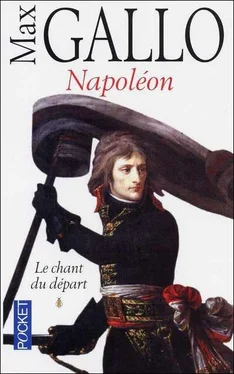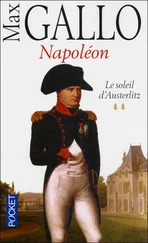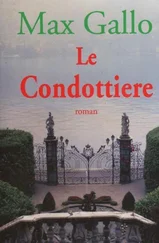« Parmi les bizarreries de la Révolution française, dit-il, celle-ci n'est pas la moindre : ceux qui nous donnaient la mort comme à des rebelles sont aujourd'hui nos protecteurs, ils sont animés par nos sentiments. »
Lorsque, durant ces premiers mois de l'année 1790, Napoléon sort dans les rues d'Ajaccio, seul ou en compagnie de Joseph, il éprouve ce plaisir d'être salué, entouré de cette curiosité affectueuse et reconnaissante qui accompagne ceux en lesquels le peuple reconnaît ses chefs ou ses représentants.
On veut échanger quelques mots avec lui. On félicite Joseph d'avoir été nommé officier municipal.
Un clan Bonaparte se constitue peu à peu, et Napoléon tient à montrer à ses partisans qu'il est à la fois un inspirateur et un patriote modeste.
Il se fait inscrire sur les rôles de la garde nationale comme simple soldat, et il prend son tour de faction devant la porte de Marius-Joseph Peraldi, qui a été nommé colonel de cette garde.
Qui s'y trompe ?
Napoléon, par des indiscrétions, apprend que La Férandière, le commandant de la garnison d'Ajaccio, a écrit au ministre pour le dénoncer. « Ce jeune officier a été élevé à l'École Militaire, écrit La Férandière, sa sœur, à Saint-Cyr, et sa mère a été comblée de bienfaits du gouvernement. Il serait bien mieux à son corps, car il fermente sans cesse. »
Aussitôt Napoléon prend les devants, et écrit, dès le 16 avril 1790, à son colonel, afin de solliciter un nouveau congé.
« Ma santé délabrée, dit-il, ne me permet point de joindre le régiment avant la seconde saison des eaux minérales d'Orezza, c'est-à-dire le 15 octobre. »
Il joint à sa lettre un certificat médical attestant de la véracité de ses dires. Et il est vrai que de temps à autre, peut-être à la suite de ses promenades dans les salines, il se sent fiévreux.
Le 29 mai, un congé de quatre mois lui sera accordé à compter du 15 juin 1790.
Il est libéré. Il a de plus en plus le sentiment que sa volonté et son désir peuvent forcer toutes les portes. Qu'il lui suffit de vouloir pour pouvoir. Dès lors qu'il a choisi un but à atteindre, il importe seulement de rassembler méthodiquement les moyens de se mettre en mouvement, et si la volonté demeure, pas un obstacle ne résistera.
Il veut rester en Corse afin de continuer d'y « fermenter » l'île, de pousser Joseph à faire partie de la délégation qui devait aller à la rencontre de Pascal Paoli en route vers la Corse.
Il faut qu'il soit présent en Corse pour ce retour du Babbo . Il ne peut abandonner l'île au moment où le peuple en mouvement va rencontrer son héros, celui auquel Napoléon a adressé ses offres de service.
Le 24 juin 1790, Joseph s'est embarqué pour Marseille. Pascal Paoli a quitté Paris après avoir été acclamé à l'Assemblée nationale et accueilli par Robespierre au club des Jacobins, et la délégation dont Joseph fait partie doit le rencontrer à Lyon.
Napoléon, le lendemain 25 juin, est à sa table de travail.
Tout à coup, il entend la rumeur d'une foule en marche et des cris.
Depuis quelques jours, un conflit oppose la municipalité d'Ajaccio et les citoyens de la ville aux autorités de la garnison. La municipalité réclame des armes, l'accès à la forteresse. La Férandière et le major Lajaille refusent.
Napoléon saisit son fusil et, sans avoir pris le temps de passer sa veste, d'enfiler ses bottes et de coiffer son chapeau, il descend dans la rue.
Les manifestants le reconnaissent, l'acclament comme leur chef. Il hésite, puis, parce qu'il a déjà eu en face de lui des émeutiers, il sait jusqu'à quelles extrémités peut aller une foule, il prend leur commandement, jouant avec leur volonté, acceptant l'arrestation de Français mais les protégeant de violences plus graves.
C'est ainsi que le major Lajaille est arrêté, retenu par la municipalité. Mais à cet instant Napoléon se tient en retrait comme il l'avait fait à Bastia le 5 novembre 1789. Il ne se décide à intervenir à nouveau dans le premier rôle qu'au moment où la municipalité, après avoir relâché le major Lajaille, veut rédiger un mémoire pour justifier cette « journée du 25 juin ». Il accuse La Férandière d'avoir fomenté « d'infâmes complots contre la loi » et tenté une « coupable rébellion ». Il dénonce ceux des Corses qui se sont mis au service de la France de l'Ancien Régime, « qui vivent au milieu de nous, qui ont prospéré dans l'avilissement universel et qui aujourd'hui détestent une constitution qui nous rend à nous la liberté ! »
Comment, écrivant cela, ne penserait-il pas à son père, Charles Bonaparte, qui fut de ces Corses-là ?
Un dimanche de juillet 1790, alors que Napoléon se promène avec son frère Joseph place de l'Olmo, un groupe de Corses ayant à leur tête un abbé Recco, neveu de leur ancien professeur de mathématiques à Ajaccio, se précipite. Ils accusent Napoléon d'avoir fomenté l'émeute du 25 juin, d'avoir persécuté des Français et les Corses dignes de ce nom. Lui, un Bonaparte, dont le père, jadis partisan de Paoli puis courtisan de M. de Marbeuf, lui, un Bonaparte d'origine toscane.
Des amis de Napoléon s'interposent, menacent de mort quiconque oserait le toucher. Napoléon a conservé son sang-froid. « Nous ne serions pas français ? s'écrie-t-il. Orrenda bestemmia , horrible blasphème ! J'attaquerai en justice les scélérats qui le profèrent ! »
On échange encore quelques injures, puis chaque groupe se retire.
Napoléon rentre avec Joseph à la maison de la rue Saint-Charles. Il est silencieux et pensif.
Il vient de mesurer les haines qui divisent les Corses. Ceux qui furent partisans de Paoli et lui restèrent fidèles, et ceux qui acceptèrent, comme Charles Bonaparte, de collaborer avec les autorités françaises. Ceux qui ont choisi de rallier la cause de la France révolutionnaire, et donc de se sentir citoyens de cette nation, et ceux qui ne renoncent pas à la cocarde blanche ; ceux, enfin, qui rêvent d'indépendance.
Au mois de septembre 1790, Napoléon marche à la rencontre de Pascal Paoli, qui a débarqué à Bastia. Depuis, le Babbo règne en maître sur l'île, faisant arrêter ses ennemis, les Français, allant de village en village entouré d'une foule d'admirateurs et de courtisans. Paoli est accueilli partout comme le Sauveur, le Dictateur.
Napoléon se mêle avec son frère aux jeunes gens qui forment autour de Pascal Paoli une cohorte qui cavalcade et se dispute le privilège de faire partie de son escorte d'honneur.
Napoléon observe ce cortège dont il fait partie. À l'entrée des villages, on a dressé des arcs de triomphe. Les habitants lancent des vivats, tirent avec leurs mousquets.
Napoléon chevauche à côté de Paoli. Il regarde cet homme vieilli qui a vécu vingt ans en Angleterre, recevant 2 000 livres sterling de pension du gouvernement anglais. Il mesure que, dans l'entourage de Paoli, il n'est qu'un parmi d'autres. Peut-être même est-il suspect à cause de l'uniforme d'officier français qu'il porte, à cause de l'attitude qu'a eue son père. Et puis, il y a la vieille opposition entre gens de Bastia et gens d'Ajaccio, ceux di quà et ceux di là , d'en deçà et d'au-delà des monts. Paoli se méfie d'Ajaccio. Les Bonaparte sont ajacciens.
La troupe arrive à Ponte Novo.
Là, en 1769, Paoli a été battu par les Français. Il caracole, descend de cheval, explique avec complaisance à Napoléon les positions des deux camps, celles qu'il avait fait occuper et défendre par ses partisans. On écoute avec respect son récit du combat. Napoléon conclut d'une voix sèche, en officier qui connaît le métier des armes : « Le résultat de ces dispositions a été ce qu'il devait être. »
Читать дальше