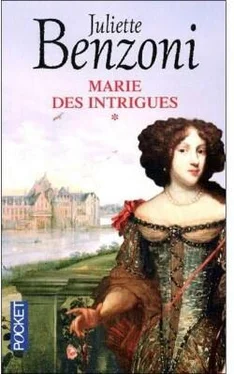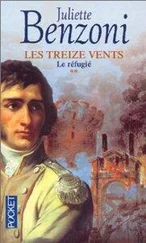Juliette Benzoni
Marie des intrigues
« L’amour n’est rien s’il n’est pas folie, une chose insensée, défendue et une aventure dans le mal… »
Thomas Mann, La Montagne magique.
PREMIÈRE PARTIE
UNE SOIF DE VENGEANCE
CHAPITRE I
LA MAISON DE LA GALIGAÏ
Le tonnerre volant de seize sabots ferrés dévalait la route étroite emportant à sa suite un carrosse dont la caisse vert foncé sans armoiries et les mantelets de cuir rabattus ne permettaient pas de distinguer l’occupant. On venait de traverser Boissy-Saint-Léger en trombe, évitant la fermeture des portes et, de justesse, une charrette sauvée de la collision par l’ouverture d’une grange. C’était un jour frileux d’avril 1622. Il était déjà tard et il s’agissait d’arriver avant la nuit close.
Pas de laquais à l’arrière du véhicule lancé à un train d’enfer. Un seul se cramponnait au siège où il était assis à côté du vigoureux cocher aussi large que haut dont la poigne maîtrisait avec aisance les quatre démons furieux de son attelage. Il se nommait Peran. C’était un Breton massif et silencieux avec, sous le chapeau noir au ras des sourcils, une figure qu’on aurait dite taillée au burin dans son granit natal. Au service de la Duchesse depuis l’enfance de celle-ci, il lui vouait un dévouement absolu, une totale obédience, ne discutant sa parole qu’au cas où son imprévisible fantaisie lui faisait courir un danger.
Au-dedans de la voiture habillée de velours vert et garnie de coussins pour amortir les cahots du chemin, deux femmes sensiblement du même âge se tenaient assises chacune dans son coin en observant un mutisme absolu. On n’avait pas échangé une parole depuis Paris. L’une d’elles était une jolie fille brune au teint clair vêtue avec élégance de drap gris soutaché de soie, blanche comme la petite fraise de dentelle empesée qui semblait soutenir un visage fin, un peu grave peut-être mais éclairé par de beaux yeux veloutés couleur de châtaigne. Des yeux qui revenaient sans cesse au profil immobile de sa compagne avec, dans leur profondeur, une inquiétude que l’on n’osait exprimer. Jamais encore Elen du Latz, suivante privilégiée de la Duchesse, ne lui avait vu cette figure tendue, ces lèvres serrées, ces prunelles scintillantes de larmes qu’un brûlant orgueil retenait au bord des paupières. Et elle ne comprenait pas ce qui pouvait mettre dans cet état celle qui était sans doute la plus belle et la plus enviée des dames du royaume.
Sans doute était-elle veuve depuis peu mais jusqu’à ce jour, elle semblait supporter sans peine excessive un deuil qui, à dire vrai, ne l’accablait pas. A dix-sept ans, Marie-Aimée de Rohan-Montbazon s’était vue mariée au grand ami du jeune roi Louis XIII, Charles d’Albert, duc de Luynes, riche comme un puits de tous les dons et charges obtenus de la reconnaissance royale dont la dernière, l’épée de connétable, ne lui convenait en rien parce qu’il était dans l’incapacité absolue d’en assumer les responsabilités. Entre autres grâces on lui avait permis d’épouser la plus jolie jouvencelle du royaume, capable de faire rêver n’importe quel homme, fût-il roi ou pape ! Elle avait tout : la séduction, l’éclat, le charme, la beauté bien sûr mais aussi un esprit vif et une joie de vivre qui la rendaient irrésistible. Nonchalant, tendre ou moqueur, son sourire lui ouvrait les cœurs cependant que son rire en cascade était capable de dérider la plus sourcilleuse des douairières. En outre, Marie savait jouer en artiste de sa voix douce et chaude, celle d’une sirène lorsqu’il lui plaisait de chanter. Ce qui n’était pas rare. Habillant toujours à ravir un corps ensorcelant, elle joignait à son élégance une allure royale bien qu’elle ne fût pas grande, et les énormes fraises en « meule de moulin » alors à la mode offrant sur leur rayonnement de dentelles empesées le plus ravissant visage ne faisaient qu’y ajouter. La jeune duchesse possédait des traits fins et aristocratiques, des lèvres fraîches et pulpeuses, de longs yeux d’outremer changeants sous un front pur et élevé couronné d’une somptueuse chevelure fauve coiffée en hauteur – à cause de la fraise ! – et surmontée, pour le moment, d’un amusant chapeau à la dernière mode dont le bord relevé s’ornait d’une agrafe de diamants…
Et voilà que le feu follet semblait éteint, la sirène, réduite au silence. C’était comme une brume entourant une statue et la couleur funèbre des vêtements n’arrangeait rien… Pourquoi ? Elen se tourmentait d’autant plus que jusqu’ici Marie se confiait à elle…
Tout avait commencé cinq heures plus tôt par l’arrivée à l’hôtel de Luynes d’un M. de Folaine, gentilhomme de la Chambre portant une lettre en provenance du camp de Toury où était le Roi. Il ne fit que toucher terre, indiquant seulement qu’il n’y avait pas de réponse.
La Duchesse se trouvait dans l’appartement de ses enfants – elle en avait trois ! – où la nourrice était en train d’allaiter la petite dernière, Marie-Anne née en janvier. Non qu’elle fût une mère très attentive. Ce n’était pas l’usage et, dans les grandes familles, surtout lorsque l’on occupait une charge importante – elle était surintendante de la Maison de la Reine –, il était normal que les enfants vécussent à l’écart de leurs parents, confiés aux soins de nourrices, de gouvernantes ou de gouverneurs à la tête d’une nombreuse domesticité. Mais, depuis la mort de son époux survenue le 14 décembre précédent, dans le sud du royaume où le Roi faisait campagne, mort que Louis XIII n’avait guère pleurée, Marie, sensible aux nuances, avait senti que la famille du défunt n’avait peut-être plus trop de bienveillance à attendre du souverain. Aussi délaissait-elle l’appartement du Louvre exigu et malcommode qu’on lui avait donné en remplacement de celui – magnifique et proche de la Reine ! – auquel elle avait droit jusque-là, pour se retrancher dans le superbe hôtel de la rue Saint-Thomas-du-Louvre que son défunt époux avait construit. Quelque chose lui disait que la mort de Luynes apportait au Roi plus de soulagement que de peine. Ce fut donc chez elle que la lettre royale l’atteignit.
Elle la lut sans que bougeât un muscle de son visage, si mobile cependant. En revanche elle devint pâle, mais comme elle jetait le message au feu sans rien dire, avec au coin des lèvres un pli de dédain, Elen n’osa pas poser de question. La Duchesse d’ailleurs n’ouvrit la bouche que pour quelques ordres brefs : envoyer sur-le-champ un coureur à son château de Lésigny pour annoncer son arrivée, préparer un coffre de voyage, demander son carrosse avec le seul Peran et un laquais pour dans une heure. Puis ordonna à Elen de se tenir prête à l’accompagner. En attendant, elle écrivit une lettre qu’elle fit porter chez la Reine, s’enferma quelques minutes dans son oratoire – chose étrange car sa piété était fort tiède ! – puis changea de vêtements et, sans prendre la peine d’informer son majordome sur la durée de son absence, elle monta en voiture avec sa suivante, toujours sans prononcer un mot.
Le silence se prolongeait quand on fut en vue de Lésigny, le joli château neuf de briques et de pierres blanches construit dix ans plus tôt par Concino Concini. L’aventurier florentin que l’engouement de Marie de Médicis, veuve d’Henri IV et régente durant la minorité de son fils, avait voulu tout-puissant au point d’en faire un maréchal de France, ne manquait ni de goût ni de prudence. Charmante avec ses hautes fenêtres claires et ses pavillons gracieux, la demeure champêtre se mirait dans des douves en eau qu’enjambait un pont dormant terminé en pont-levis permettant d’isoler le château.
Читать дальше