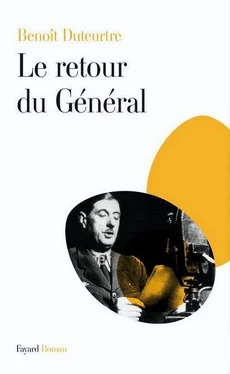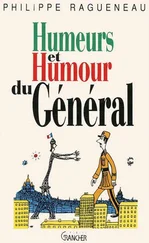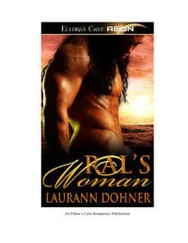Le résidu de service public prévoyait donc l’entretien de cabines sur tout le territoire ; mais il comportait également l’obligation de n’indiquer aucun numéro de renseignements à l’intérieur, afin de respecter la concurrence entre les différentes marques ; si bien qu’après avoir introduit ma carte de crédit dans l’appareil, je tâchai de me remémorer ces récents indicatifs, imprimés sur des affiches publicitaires au moment de leur lancement tapageur. Mais les centres de renseignements étaient désormais si nombreux que ma mémoire s’embrouillait. À chaque formule que j’essayais (118–119, 118–111…), une même voix mécanique indiquait que ce numéro n’était pas attribué .
De guerre lasse, je finis par composer le 12 en espérant — en supposant, même — que le résidu de service public me prodiguerait au moins des informations nécessaires. Je connus un instant de joie quand une voix synthétique au débit rapide me confirma :
« Suite à un changement de réglementation, le numéro que vous venez de composer ne permet plus d’accéder aux services de renseignements téléphoniques. Ces services sont désormais accessibles via des numéros à 6 chiffres commençant par 118… »
À ce point, j’imaginais qu’allait suivre une énumération. Je fus donc fort désappointé d’entendre simplement la voix poursuivre :
« La liste de ces numéros est disponible sur le site internet www.appel118.fr. »
Ceux qui avaient conçu ce message étaient-ils des naïfs ou des pervers ? Supposaient-ils que toute personne égarée comme moi en pleine montagne, sur une route chaotique et sous une pluie diluvienne, dans l’orage d’un soir d’été, a sous la main son ordinateur et une connexion internet ? Certes, j’aurais dû ; mais, justement, je n’en avais pas ! Et nous étions encore nombreux dans mon cas. Le piège se refermait sur la voix qui conclut :
« En cas d’urgence, vous pouvez composer le 15 pour le SAMU, le 17 pour la police, le 18 pour les pompiers, le 112 pour le numéro d’urgence européen. France Télécom vous remercie de votre appel. »
L’idée même de ce numéro d’urgence européen , quand j’étais en train de chercher celui d’un hôtel à quelques kilomètres de là, aurait dû renforcer ma haine. Mais cela ne changeait rien à l’affaire, et je tournai un regard désespéré vers cette place de village plongée dans la lumière blafarde d’un réverbère. La pluie battait toujours ; des éclairs déchiraient le ciel et cette immense solitude se doublait d’un sentiment de culpabilité : d’abord parce que j’avais l’impression de revivre sans fin la même histoire ; ensuite parce que j’aurais dû noter le numéro de l’hôtel ; enfin parce que notre voiture arrêtée en pleine nuit, phares allumés, dans un village de l’Isère, n’allait pas tarder à paraître suspecte ; or nous n’avions tenu aucun compte de l’interdiction de fumer, pourtant clairement signalée à l’intérieur de ce véhicule loué pour quelques jours. Tout cela allait nous attirer des ennuis.
Accomplissant un nouvel effort, je tâchai alors de me concentrer, puis de reformuler l’un de ces numéros qui étaient certainement choisis pour se retenir facilement. J’essayai à tout hasard une autre formule commençant par 118… et le miracle se produisit. Mieux encore, malgré l’heure tardive, une voix enregistrée m’annonça que je serais bientôt mis en contact avec une personne humaine, à condition de m’acquitter du coût du service : 1,35 euro, plus 11 centimes la minute, soit 10 francs au minimum, c’est-à-dire vingt fois l’unité de base des anciens appels téléphoniques. Dans mon archaïque jeunesse, le service des renseignements depuis une cabine était gratuit. À présent, d’après les indications figurant dans l’édicule, seuls les numéros d’urgence (police, pompiers, Europe) étaient encore accessibles, tandis que ceux des renseignements obéissaient à une libre facturation des compagnies. Et, contrairement aux promesses tapageuses, tous les services concurrents avaient augmenté leurs tarifs. J’avais néanmoins franchi une étape, et l’urgence, maintenant, était d’obtenir le fichu numéro de cet hôtel.
Quelques secondes passèrent avant qu’une voix féminine me réponde enfin. Elle le fit d’ailleurs très aimablement et son fort accent me laissa supposer que cette préposée travaillait dans un pays d’Afrique du Nord. Pour un coût trois fois moindre, et sans aucune protection sociale, elle y effectuait la tâche qu’accomplissait auparavant une jeune Française touchant désormais le revenu minimum d’insertion — ce qui répondait bien à ce concept de « nivellement par le bas » dont m’avait parlé Anthony Bénard. La jeune fille, en tout cas, était aimable, attentive, comme souvent le personnel des pays pauvres, et elle sembla comprendre ma demande. Puisque l’hôtel était perché sur un col perdu, je peinai à lui indiquer le nom de la commune ; mais, suivant les recoupements que je lui indiquais, elle finit par dénicher le précieux numéro et je la remerciai vivement avant de raccrocher, puis d’appeler enfin cet hôtel. Le tarif affiché était de trois euros minimum par communication, soit quarante fois l’ancienne taxe téléphonique de base.
Je songeai alors que si le service des télécommunications semblait — dans ce cas précis — moins rapide, moins pratique et nettement plus cher que tout ce que j’avais connu par le passé, il n’avait pas encore complètement disparu. Quelque chose fonctionnait, malgré tout, dans ce système : il convenait de m’en réjouir et d’apprendre à l’utiliser.
Il pleuvait toujours. Les phares de la voiture, transperçant l’averse, éclairaient trois grosses poubelles de tri sélectif. Au pied des bacs multicolores, quelques bouteilles en plastique traînaient sur le socle bétonné et les déchets glissaient au fil de l’eau. C’est alors que la porte d’une maison s’est ouverte et que j’ai vu sortir un homme chauve, en jogging, tenant un sac en plastique et dans l’autre main son téléphone dernier cri. L’air joyeux, il parlait à quelqu’un, décrivant peut-être l’orage qui s’abattait sur nous. Sitôt jeté son sac dans l’orifice graisseux, il m’a aperçu dans la lumière blafarde de la cabine, puis m’a adressé un petit salut avant de rentrer chez lui. Il paraissait serein, confiant, comme s’il voulait me confirmer que tout n’était pas perdu ; et je suis reparti en courant vers la voiture au milieu des gouttes qui crépitaient sur le sol.
Sur la place du marché, ce dimanche, il y a des cèpes. La clientèle se presse aux étalages ; des voix fusent dans la fraîcheur de l’automne ; quelques visages sourient pour des raisons mystérieuses et je me faufile entre les corps. J’ai bien envie de déjeuner sur la place, d’essayer ce nouveau bistrot qui vient d’ouvrir sous une fausse devanture de vieux rade parisien. Y croire encore sans trop râler, dire bonjour au patron, demander un verre de rouge, poser mon journal devant moi et commander, plein d’espoir, un œuf mayonnaise.