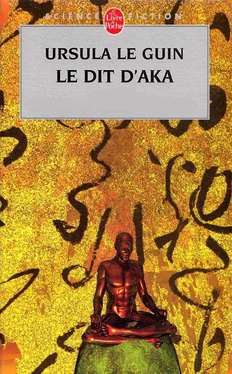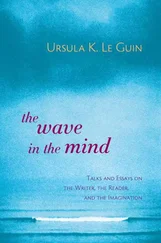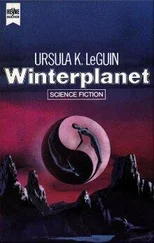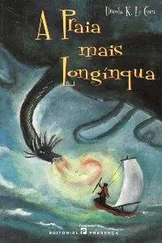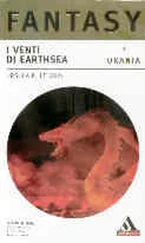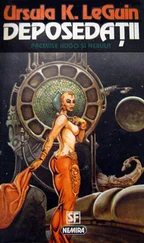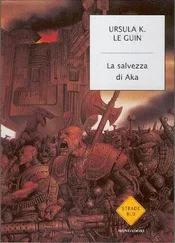Les villageois sortirent tous pour accueillir les visiteurs – une mêlée confuse de visages sales, brûlés par le soleil et souriants, d’enfants courant en tous sens, de bébés timides ligotés dans des cocons de cuir et accrochés à des poteaux tels des trophées miniatures, et de minules bêlantes que flanquaient leurs nouveau-nés silencieux et tout blancs. La vie, la vie, abondante, dans ces lieux déserts et lointains.
Haut dans le ciel, comme d’habitude, deux geyma spiralaient sur leurs fines ailes noires dans le sombre éclat du ciel bleu.
Odiédine et le jeune couple, Siez et Tobadan, étaient déjà occupés à bénir les huttes, les bébés, le bétail, à passer du baume sur les plaies et sur les yeux abîmés par la fumée, et à dire. Bénir, si c’était le terme exact – le mot qu’ils utilisaient signifiait « inclure » ou « adopter » –, consistait à psalmodier rituellement au son du tambourin et à donner un morceau de papier rouge ou bleu sur lequel le maz inscrivait le nom et l’âge du récipiendaire, et l’épisode personnel qu’on lui indiquait.
— J’ai épousé Témazi cet hiver.
— J’ai construit ma maison dans le village.
— J’ai eu un fils l’hiver dernier. Il a vécu un jour et une nuit. Il s’appelait Énu.
— Mon troupeau a vu naître vingt-deux minulibi cette saison.
— Je m’appelle Ibien. J’ai eu six ans ce printemps.
Pour autant que Sutty pouvait en juger, les villageois ne savaient lire, au mieux, que quelques caractères. Ils manipulaient les morceaux de papier avec respect et une satisfaction manifeste. Ils les étudiaient longuement, dans tous les sens, puis les pliaient avec soin et les glissaient dans le sac ou le coffret magnifiquement décoré et réservé à cet effet qu’ils gardaient dans leur maison ou leur tente. Les maz avaient effectué de telles bénédictions ou adoptions dans tous les villages traversés qui n’avaient pas de maz résidents. Certaines des boîtes à dits sculptées et décorées contenaient des centaines de ces petits mémentos rouges et bleus, des dits de vies actuelles et de vies passées.
Odiédine en rédigeait pour une famille, Tobadan dispensait des herbes et des baumes à une autre famille, et Siez, ayant terminé sa psalmodie, était allé s’asseoir avec le reste des habitants pour dire un dit. Jeune homme taciturne aux paupières toujours mi-closes, il se changeait en moulin à paroles dans les villages.
Fatiguée, prise d’une vague migraine – ils avaient dû encore monter d’un kilomètre en altitude – et bercée par la chaleur du soleil, Sutty rejoignit le demi-cercle d’hommes, de femmes et d’enfants attentifs assis en tailleur dans la poussière pour l’écouter.
— Le dit ! annonça Siez d’une voix sonore, impressionnante, avant de marquer une pause.
Son public émit un chuchotis appréciateur, ah, ah. On échangea quelques murmures.
— Le dit d’une histoire !
Ah, ah , murmures, murmures.
— L’histoire de Takiéki chéri !
Oui, oui. Takiéki chéri, oui.
— Et l’histoire commence ! L’histoire commence alors que Takiéki chéri habite encore chez sa vieille mère, car il est adulte, mais bête. Sa mère meurt. Elle était pauvre. Tout ce qu’elle lui laisse, c’est le sac de fèves qu’elle a mis de côté pour l’hiver. Le propriétaire arrive et expulse Takiéki.
Ah, ah , murmuraient les auditeurs en hochant la tête d’un air peiné.
— Et Takiéki s’en va par le sentier, son sac de fèves sur l’épaule. Il marche, il marche et, au sommet de la colline suivante, il voit un homme en haillons qui vient vers lui. Ils s’arrêtent tous les deux au moment de se croiser, et l’autre lui dit : « C’est un gros sac que tu as là, jeune homme. Tu veux bien me montrer ce qu’il y a dedans ? » Et Takiéki le lui montre. « Des fèves ! » s’écrie l’homme en haillons.
Des fèves , chuchota un enfant.
— « Et ce sont de bien belles fèves ! Mais elles ne te dureront jamais tout l’hiver. Je te propose un marché, jeune homme. Je te donne un bouton de cuivre, de vrai cuivre, en échange de tes fèves ! » Et Takiéki répond alors : « Oh ! oh ! tu crois me rouler, mais je ne suis pas si bête ! »
Ah, ah.
— Et Takiéki reprend son sac et continue. Et il marche, et il marche et, sur la colline suivante, il voit une femme en haillons qui vient vers lui. Ils s’arrêtent tous les deux au moment de se croiser, et l’autre dit : « C’est un gros sac que tu as là, jeune homme. Que tu dois être fort ! Je peux voir ce qu’il y a dedans ? » Et Takiéki le lui montre. « De belles fèves ! s’écrie la femme en haillons. Si tu les partages avec moi, jeune homme, je te suivrai, et je ferai l’amour avec toi chaque fois que tu le voudras, tant que les fèves dureront. »
Une femme donna un petit coup de coude à sa voisine, avec un large sourire.
— « Oh ! oh ! dit Takiéki, tu crois me rouler, mais je ne suis pas si bête ! » Et il jette son sac sur son épaule et s’en va. Et il marche, et il marche et, sur la colline suivante, il voit un homme-et-femme venir vers lui.
Ah, ah , tout doucement.
— L’homme a la peau aussi sombre que le crépuscule et la femme la peau aussi claire que l’aurore, et ils portent des vêtements aux couleurs vives, et des bijoux aux couleurs vives, rouges, bleus. Ils s’arrêtent au moment de se croiser, et il/elle/ils dit/disent : « C’est un gros sac que tu as là, jeune homme. Tu veux bien nous montrer ce qu’il y a dedans ? » Et Takiéki le lui/leur montre. Et le/la/les maz dit/disent : « De bien belles fèves ! Mais elles ne te dureront jamais tout l’hiver. » Takiéki ne sait que répondre. Le/la/les maz lui dit/disent : « Takiéki chéri, si tu nous donnes le sac de fèves que ta mère t’a donné, tu recevras en échange la ferme qui se trouve derrière cette colline, avec cinq granges pleines de grain, cinq resserres pleines de nourriture, et cinq étables pleines d’éberdines. Le corps de ferme comprend cinq grandes pièces, son toit est en or, et la maîtresse de maison se trouve dans la maison, et elle attend d’être ta femme. » Et Takiéki répond : « Oh, oh, vous croyez me rouler, mais je ne suis pas si bête ! » Et il continue sa route, il la continue, il franchit la crête de la colline, et il longe la ferme avec ses cinq granges, ses cinq resserres, ses cinq étables et son toit en or, et il a continué de marcher, Takiéki chéri.
Ah, ah, ah ! dirent tous les auditeurs, profondément satisfaits. Et ils se détendirent, et bavardèrent, et portèrent à Siez une tasse et un pot de thé fumant afin qu’il se désaltère, et ils attendirent avec respect son prochain dit.
Pourquoi Takiéki était-il « chéri » ? se demanda Sutty. Parce que stupide ? (Des pieds nus posés sur l’air.) Parce que sage ? Un sage se serait-il défié des maz ? Ce devait être stupide de refuser ferme, granges et épouse. Le récit signifiait-il qu’une ferme, des granges et une épouse ne valent pas un sac de fèves pour un saint ? Ou qu’un saint, un ascète, est un idiot ? Si les gens parmi lesquels elle vivait depuis un an admiraient la mesure, ils méprisaient les privations. Le jeûne demeurait étranger à leur culture, et ils ne voyaient aucune vertu à l’inconfort ou à la pauvreté.
Dans une parabole terrienne, Takiéki aurait sans doute dû donner les fèves à l’homme en haillons, en échange du bouton de cuivre ou non, et, après sa mort, il aurait reçu sa juste récompense au paradis. Mais sur Aka, la récompense, fiduciaire ou spirituelle, était instantanée. Siez, en effectuant ses devoirs de maz, n’emmagasinait ni la vertu ni la sainteté, il recevait un salaire : louanges, logis, dîner, provisions de voyage et satisfaction du travail accompli. Les exercices ne visaient pas un idéal de santé ou de longévité, mais un bien-être immédiat dans le plaisir de leur pratique. La méditation offrait une transcendance immédiate et passagère, et non un nirvana absolu. L’économie akienne se basait sur l’argent comptant, et non sur le crédit.
Читать дальше