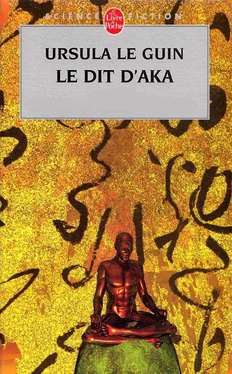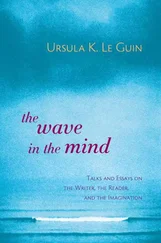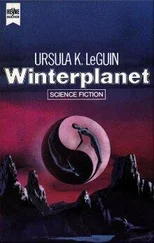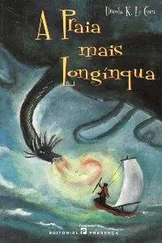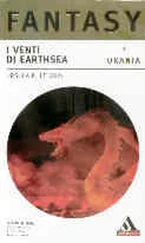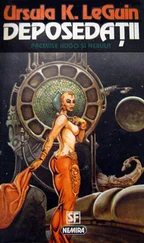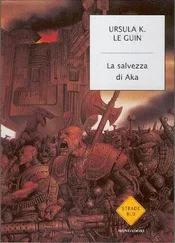Sans cesse, dans ses notes : À vérifier. Elle changea les termes, les amenda, les corrigea, encore et encore. Bientôt, sa définition ne la satisfaisait plus – même si elle la jugeait moins fausse que peu adéquate. Le mot même de religion la gênait. Elle se mit à appeler ce qu’elle étudiait le système, le Grand Système. Puis la Forêt, car elle avait appris que, dans l’ancien temps, on le qualifiait de chemin à travers la forêt. Puis la Montagne, quand elle découvrit que certains de ses mentors appelaient ce qu’ils lui enseignaient le chemin vers la montagne. Elle finit par l’appeler le Dit. Mais ça, ce fut après avoir connu Maz Élyed.
Elle avait de longues discussions avec son noteur sur le fait de savoir si l’on pouvait traduire un mot de dovzien, ou du vocabulaire plus ancien et en partie non dovzien dont se servaient les « érudits », par sacré ou sanctifié. Il y avait des termes qu’elle traduisait par puissance, mystère, échappant-à-la-maîtrise-des-gens, procédant-de-l’harmonie. Ils n’étaient jamais réservés à un endroit précis, ni à un type d’acte spécifique. Il apparaissait plutôt que l’ancien mode de pensée akien considérait tout endroit, tout acte, comme mystérieux, puissant et potentiellement sacré, à condition d’être perçu de la manière appropriée. Et il semblait que la perception implique la description : dire l’endroit, l’acte, l’événement, la personne… en parler, en faire un récit.
Mais ces récits n’avaient rien d’évangiles ; ils ne se prétendaient pas vérité supérieure, ils essayaient de dire la vérité. De percevoir le sacré. On ne vous demandait pas de croire, simplement d’écouter.
— Ah, c’est comme ça qu’on m’a appris cette histoire, disait-on après avoir raconté une parabole ou un événement historique ou récité une vieille légende bien connue. C’est comme ça que ça se passe dans ce dit.
Les saints dans ces histoires atteignaient à la sainteté, pour autant qu’il s’agisse de cela, de bien des façons, dont aucune ne lui semblait particulièrement sacrée. Il n’y avait pas de règles de conduite comme la pauvreté, la chasteté et l’obéissance, il n’était pas nécessaire d’échanger tous ses biens terrestres contre un bol de mendiant en bois, ni de se retirer au sommet d’une montagne. Certains des héros et des maz célèbres des récits étaient riches, voire extravagants ; leur vertu cardinale était apparemment la générosité : ils construisaient de vastes, de superbes umyazu pour accueillir leurs trésors, ou ils partaient en procession en compagnie de centaines d’amis tous montés sur des éberdines harnachées d’argent. Certains des héros étaient des guerriers, d’autres, des chefs puissants, certains, des cordonniers ou encore des boutiquiers. Certains des saints de ces récits formaient un couple d’amoureux, et le récit concernait leur amour. Il n’y avait pas de règles. Il y avait toujours une alternative. Si les conteurs, quand ils commentaient les légendes et les récits qu’ils disaient, signalaient parfois qu’il y avait une façon de procéder qui était bonne, ou juste, ils ne la définissaient jamais. Et « bien » ne se concevait que comme un adverbe, sans exception : bien manger, bien vivre, bien faire l’amour. « Le bien », cela n’existait pas davantage que le Bien et le Mal en tant qu’entités, ou que puissances ennemies. Non.
Ce système n’avait rien d’une religion, disait Sutty à son noteur avec un enthousiasme grandissant. Il avait, bien sûr, une dimension spirituelle. En fait, il était la dimension spirituelle de la vie de ceux qui le vivaient. Mais il n’y avait jamais eu sur Aka de religion en tant qu’institution exigeant la foi et exerçant une autorité, ou en tant que communauté façonnée par la connaissance de divinités étrangères ou par des institutions concurrentes. Jusqu’à maintenant.
Les terres habitables d’Aka se composaient d’un vaste continent unique, dont le Dovza occupait la partie sud-ouest, et d’un grand archipel au large de la côte est. Les Akiens, qu’aucun océan ne séparait, présentaient tous le même type physique, nuancé de quelques variantes locales. Tous les Observateurs l’avaient noté, tous avaient souligné cette homogénéité ethnique, ce manque de diversité sociétale et culturelle, mais pas un n’avait vraiment saisi que, parmi les Akiens, les étrangers n’existaient pas. Jusqu’à l’atterrissage des vaisseaux de l’Ékumen, il n’y en avait jamais eu.
C’était là une donnée simple, mais particulièrement réfractaire au mode de pensée terrien. Pas d’étrangers. Pas d’autres, au sens du mot « autres » qu’il prend sur Terre : l’implacable séparation en tribus, les frontières arbitraires et infranchissables, les haines ethniques entretenues pendant des siècles, des millénaires. « Les gens », ici, cela ne voulait pas dire « mon peuple », mais « le peuple », tout le monde, l’humanité entière. Un « barbare » n’était pas un étranger incompréhensible, mais une personne sans instruction. Sur Aka, tout conflit avait un caractère familial. Chaque guerre était une guerre civile.
Une des longues épopées dont Sutty avait entendu des fragments racontait une interminable vendetta autour d’une vallée fertile, qui avait commencé par une querelle entre un frère et une sœur à la suite d’un héritage. Les rivalités économiques entre régions et villes-États qui hantaient l’histoire d’Aka se terminaient souvent par des conflits armés. Mais guerres et vendettas se résolvaient sur le champ de bataille, entre soldats professionnels. Les annales faisaient apparaître qu’il était rare que des soldats détruisent des villes ou des cultures ou s’en prennent à des civils et qu’ils commettaient ce faisant un crime haïssable pour lequel on les châtiait avec la dernière sévérité. Les Akiens se combattaient par cupidité ou par ambition, jamais par haine ni au nom d’une croyance. Ils se combattaient selon les règles, et ils suivaient tous les mêmes règles. Ils ne formaient qu’un peuple. Leur système de pensée, leur mode de vie étaient universels. Ils chantaient une seule chanson, quoique à plusieurs voix.
Une grande part du caractère communautaire de leur société s’appuyait sur l’écriture, de l’avis de Sutty. Avant la révolution culturelle dovzienne, il existait plusieurs langues principales et d’innombrables dialectes, mais tout le monde se servait des mêmes idéogrammes, que chacun comprenait. Pour gauche et archaïque que soit, sous certains aspects, une écriture non alphabétique, elle avait réussi à fixer et à préserver – comme l’avaient fait les idéogrammes chinois sur Terre – une multitude de langues et de dialectes ; elle permettait de lire des textes vieux de milliers d’années sans qu’il soit besoin de les traduire, bien que les mots, du point de vue phonétique, soient désormais méconnaissables. Cela avait dû constituer la motivation première des réformateurs dovziens dans leur décision d’éradiquer l’écriture ancienne : elle représentait un obstacle au progrès, et, plus encore, une force conservatrice avérée. Elle maintenait le passé en vie.
À Dovza-Ville, elle n’avait rencontré personne qui ait su, ou admis savoir, lire l’écriture ancienne. Les questions initiales qu’elle avait parfois posées lui avaient valu tant de désapprobation et de rejet passif qu’elle avait vite appris à se taire sur ce sujet. Les officiels chargés de s’occuper d’elle ne lui avaient jamais rien demandé. On ne se servait plus de ce système de notation depuis des décennies, de sorte qu’il ne leur était pas venu à l’esprit qu’elle puisse le connaître. Il n’était donc pas si absurde de se demander, ainsi qu’elle l’avait fait, si elle était la dernière personne au monde dans ce cas. Cette perspective l’avait proprement terrifiée. Elle avait eu le sentiment de porter le fardeau de toute l’histoire d’un peuple qui n’était pas le sien. Si elle oubliait ne fût-ce qu’un mot, un caractère, un signe de ponctuation, toutes ces vies, tous ces siècles de pensée et d’émotions en seraient diminués d’autant, à jamais.
Читать дальше