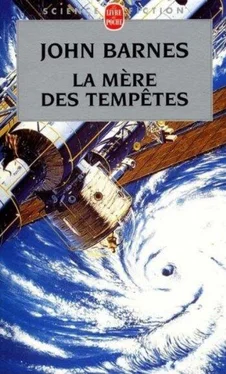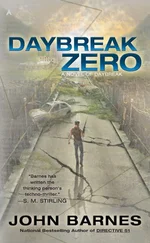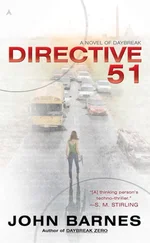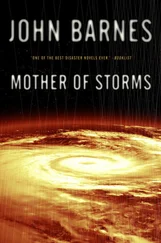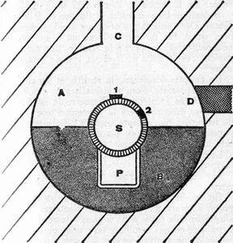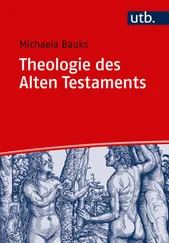John Barnes
La mère des tempêtes
À Kara Dalkey,
évidemment.
À mon point de vue, aucun danger ne menace autant l’espèce humaine et la vie sur Terre que l’échauffement d’origine anthropique de la planète, ce qu’on nomme aussi le résultat de l’effet de serre.
Comparons-le en effet à quelques autres périls considérés comme majeurs.
Pendant le dernier demi-siècle, les craintes les plus vives ont été attachées à un possible conflit nucléaire. Une guerre nucléaire régionale dont la vraisemblance apparaît malheureusement assez grande dans les trente prochaines années ferait entre un million et trente millions de morts : elle ne menacerait pas de disparition l’humanité ni la vie sur Terre. Un échange thermonucléaire généralisé du type destruction mutuelle assurée (en anglais M.A.D.) tel qu’on a pu le redouter durant la Guerre froide et dont la probabilité a beaucoup diminué, ferait sans doute entre cinq cents millions et deux milliards de morts, mais même en cas d’hiver nucléaire subséquent, l’humanité survivrait vraisemblablement et peut-être la civilisation industrielle, de même que la plus grande partie de la vie terrienne.
Une épidémie, comme celle du SIDA, peut faire plusieurs dizaines de millions de morts mais, même non maîtrisée, il est vraisemblable qu’elle s’éteindrait d’elle-même comme celle de la grippe dite espagnole qui fit en 1918 vingt-cinq millions de morts dans le monde, soit plus que la Première Guerre mondiale et presque autant que la Seconde. Si dans un pays donné voire dans une région du monde, ainsi en Afrique pour le SIDA, les effets démographiques peuvent être catastrophiques, à l’aune de la démographie mondiale de telles indentations semblent presque négligeables. L’effroyable prévalence du SIDA en Afrique subsaharienne n’infléchit pas, au moins pour l’instant, une courbe démographique fortement ascendante (et inquiétante pour d’autres raisons) pour l’ensemble du sous-continent.
La collision avec la Terre d’un gros astéroïde, par exemple de la taille de celui qui mit fin au règne des dinosaures il y a soixante-cinq millions d’années, présente une probabilité à peu près négligeable à l’échelle historique : disons qu’elle peut intervenir en moyenne une fois tous les dix millions d’années. Depuis l’apparition sur notre planète de la vie au moins telle que nous la connaissons, plusieurs dizaines d’accidents cosmiques de cette ampleur n’ont pas réussi à l’éradiquer même s’ils ont introduit de sérieuses réorientations dans le cours de l’évolution.
Un cataclysme géologique comme l’épanchement des Trappes du Dekkan, à peu près contemporain de la collision citée et selon certains en relation avec elle, est encore moins probable à l’échelle historique et nous n’en voyons aucun signe précurseur.
En revanche, le relâchement insidieux et progressif dans l’atmosphère terrestre depuis le début du XIXe siècle, c’est-à-dire depuis le début de l’industrialisation, de gaz à effet de serre dont le dioxyde de carbone, le méthane, l’ozone, plus quelques composés dont la capacité à accumuler de la chaleur est encore plus redoutable, peut à terme constituer un risque définitif pour la civilisation, pour l’espèce humaine, et même dans le pire des scénarios pour la quasi-totalité des formes de vie sur Terre.
Le roman de John Barnes qu’on va lire illustre une partie des dangers les plus bénins, si l’on ose écrire, qui nous menacent à plus ou moins long terme si l’humanité persiste dans son aveuglement.
Je ne me donnerai pas le ridicule de rappeler ici quelques chiffres. Il existe sur le sujet une littérature abondante, souvent encore polémique, où le lecteur pourra aisément les trouver. Je suggérerai d’autre part, à ceux qui disposent d’un accès à Internet, de consulter le site en français de Jean-Marc Jancovici, qui propose une remarquable synthèse, claire, complète et tenue à jour, des données disponibles sur le sujet [1] On le trouvera à l’adresse :
avec des liens vers d’autres sources d’information plus techniques.
Je me bornerai donc à évoquer quelques dimensions plus sociologiques, politiques ou philosophiques du problème, qui sont souvent négligées par les commentateurs [2] Accessoirement, je me suis toujours demandé quelle était la quantité de chaleur que l’humanité avait émise sur la planète depuis son apparition, ou plus concrètement, depuis trois siècles. Comme absolument toutes les activités humaines se ramènent à un dégagement de chaleur, fût-il différé, on devrait pouvoir procéder à une évaluation à partir de celle de la masse des combustibles consommés. Peut-être cette grandeur est-elle négligeable en comparaison d’autres sources strictement planétaires de chaleur comme les volcans et les feux de forêts. En tout cas ma curiosité n’a jamais été satisfaite.
.
Il y a une dizaine d’années seulement, le sujet était encore controversé bien que les années 1980 aient été en moyenne les plus chaudes du siècle, contrariant une tendance naturelle vers un léger refroidissement voire vers un petit âge glaciaire. Les météorologues eux-mêmes étaient divisés, certains parlant d’une variation statistique demeurant dans les normes, et la grande presse, voire la presse d’information scientifique, se voulant dans l’ensemble rassurante. Je ne pense pas qu’aujourd’hui beaucoup de véritables spécialistes doutent de la réalité de réchauffement planétaire d’origine humaine même si énormément d’incertitudes demeurent sur son rythme, ses conséquences à plus ou moins long terme et sur les possibilités de l’enrayer. Malheureusement, malgré quelques remous politiques, dont le bien incertain protocole de Kyoto, le consensus demeure à peu près général, hormis quelques effets de manche, sur l’idée qu’il n’y a pas le feu, que la planète en a vu d’autres, qu’elle est capable de se rééquilibrer toute seule, qu’on est bien loin d’avoir tout compris, et qu’il est donc urgent de continuer comme avant.
L’indifférence de l’opinion et des gouvernants eux-mêmes peut se comprendre même si l’avenir ne l’excuse pas. Le phénomène, ou plutôt l’ensemble complexe des phénomènes, est inscrit dans le long terme, de l’ordre de décennies ou au mieux de siècles, un terme bien plus long que celui des mouvements de l’opinion ou des échéances électorales, ou même d’une vie humaine. C’est un temps long dans le cadre duquel les sociétés démocratiques n’ont l’habitude ni de réfléchir ni d’agir. Les sociétés totalitaires non plus du reste, voire moins encore, malgré leur prétention à bâtir des empires de mille ans ou à mettre fin à l’histoire, si l’on considère que l’Union soviétique a été le plus gigantesque et le plus irresponsable pollueur industriel de la planète.
Pour nos sociétés, un siècle, ou même un demi-siècle, c’est autant dire l’éternité. La seule exception notable a concerné, dans des cercles finalement restreints, les temps du nucléaire et plus précisément de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Les responsables savent parfaitement qu’il leur faut compter avec des produits, des sous-produits et des déchets, en volumes limités et maîtrisables, dont l’activité, et en particulier la nocivité, se mesure en dizaines d’années, en milliers d’années, voire en millions d’années [3] Voir les textes qui accompagnent le roman de Lester de Rey, Crise , et en particulier ma postface « Les temps du nucléaire », Robert Laffont, 1978.
. Malheureusement, les opposants à l’énergie nucléaire ont vu dans ces termes éloignés autant d’inacceptables et en ont conclu à un rejet formel, souvent presque religieux, de toute forme d’énergie nucléaire. Comme on y reviendra brièvement plus loin, cette attitude n’est pas sans conséquence sur le problème examiné ici.
Читать дальше