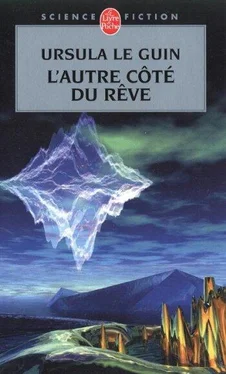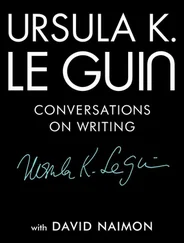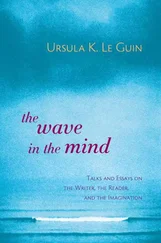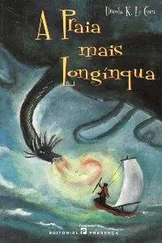Repoussés par les astronefs des étrangers, qui possédaient un appareil capable de prendre le contrôle du système de guidage des missiles, les MBAE firent demi-tour quelque part dans la stratosphère et revinrent exploser ici et là dans l’État de l’Oregon. L’horreur déferla sur les pentes orientales desséchées des Cascades. Gold Beach et les Dalles furent anéanties dans un orage de feu. Portland ne fut pas directement touché, mais un MBAE errant vint frapper le mont Hood près du vieux cratère et réveilla le volcan éteint. Des jets de vapeur et des tremblements de terre suivirent aussitôt et, à midi, le premier jour de l’Invasion Étrangère, le 1er avril, une brèche s’était ouverte dans la face nord-ouest qui était en violente éruption. Le flot de lave dévala les pentes fumantes et déboisées, et menaça les communes de Zigzag et de Rhododendron. Un cône de cendres commença à se former et dans Portland, à soixante-dix kilomètres de là, l’air fut bientôt gris et suffocant. Quand vint le soir, et que le vent se mit à souffler vers le sud, l’atmosphère s’éclaircit un peu près du sol, révélant la lueur orange sombre de l’éruption à travers les nuages de l’est. Le ciel, tout en pluie et en cendres, se mit à tonner quand passèrent les XXTT-9900, cherchant vainement les vaisseaux étrangers. D’autres vols de bombardiers et de chasseurs arrivaient encore de la côte est et d’autres pays du Pacte ; beaucoup se combattirent entre eux et furent abattus. Le sol était secoué par les tremblements de terre et les avions qui s’écrasaient. Un des vaisseaux étrangers ne s’était posé qu’à une douzaine de kilomètres de la ville, et les faubourgs du sud-ouest furent pulvérisés par les bombardiers qui dévastèrent méthodiquement la zone où était signalé l’astronef. En fait, on venait d’annoncer qu’il n’était plus là. Mais il fallait faire quelque chose. Des bombes tombèrent par erreur sur de nombreux autres quartiers de la ville, comme cela arrive toujours avec les bombardiers à réaction. Il ne resta plus une vitre aux fenêtres dans le centre de Portland. Par contre, toutes les rues étaient jonchées de débris de verre, sur trois ou quatre centimètres d’épaisseur. Les réfugiés du sud-ouest de Portland durent les traverser ; des femmes portaient leurs enfants et marchaient en gémissant de douleur, leurs fines chaussures criblées d’éclats de verre.
William Haber se tenait debout devant la large fenêtre de son bureau, à l’institut onirologique de l’Oregon, regardant le feu jaillir et retomber près des quais et, plus loin, la lueur sanglante de l’éruption. La vitre de sa fenêtre était intacte ; rien ne s’était posé ou n’avait explosé près de Washington Park jusqu’à présent, et les tremblements de terre, qui avaient fait s’effondrer des buildings entiers dans la rivière, n’avaient pas eu d’autres conséquences, ici, en haut de la colline, que de faire vibrer les carreaux. Il pouvait entendre, très faiblement, les cris des éléphants, dans le zoo. Des éclairs d’un rouge inhabituel zébraient de temps en temps le ciel au nord, peut-être au-dessus du confluent de la Willamette et de la Columbia ; il était difficile de localiser quelque chose avec précision dans ce brouillard de cendres et ce crépuscule brumeux. De nombreux quartiers de la ville étaient plongés dans l’obscurité en raison des coupures de courant ; d’autres scintillaient faiblement, bien que les lampadaires ne fussent pas allumés.
Il n’y avait personne d’autre dans le bâtiment de l’Institut.
Haber avait passé toute la journée à chercher où George Orr pouvait bien se trouver. Quand son enquête s’était révélée vaine et que toute investigation supplémentaire avait été rendue impossible par l’agitation et la dégradation de la ville, il était revenu à l’institut. Il avait dû faire presque tout le chemin à pied et avait trouvé l’expérience éprouvante. Un homme dans sa position, avec tant d’appels téléphoniques à donner et à recevoir, conduisait bien sûr une élec-auto. Mais la batterie était à plat et la foule qui encombrait la rue l’avait empêché d’atteindre un chargeur. Il avait dû descendre et marcher contre la marée humaine, remonter le courant et cela l’avait énervé. Il n’aimait pas la foule. Mais finalement, il avait réussi à s’en dégager et s’était retrouvé tout seul, marchant dans le grand parc parmi les pelouses, les bosquets et les bois.
Haber se considérait comme un loup solitaire. Il n’avait jamais voulu d’épouse, ni d’amis proches ; il avait choisi une recherche opiniâtre qu’il poursuivait quand les autres dormaient ; il évitait les complications. Il avait presque entièrement limité sa vie sexuelle à des rencontres d’une nuit, des semi-pros, parfois des femmes et parfois des jeunes gens, il savait dans quels bars, cinémas ou saunas il devait aller pour trouver qui il voulait. Il obtenait ce qu’il désirait, et se séparait rapidement de son ou sa partenaire, avant que l’un des deux ne commence à avoir besoin de l’autre. Il appréciait son indépendance, sa liberté.
Mais il trouvait terrible d’être seul, tout seul dans cet énorme parc indifférent, pressant le pas, courant presque vers l’institut, parce qu’il n’avait pas d’autre endroit où aller. Quand il y arriva, tout était silencieux, complètement désert.
Miss Crouch gardait un transistor dans le tiroir de son bureau. Il le prit et le mit en marche, afin d’écouter les dernières nouvelles ou, du moins, d’entendre une voix humaine.
Il y avait ici tout ce dont il avait besoin ; des lits – des douzaines – et de la nourriture : les machines distributrices de sandwiches et de sodas pour les équipes de nuit des laboratoires. Mais il n’avait pas faim. Il sentait en lui une sorte d’apathie. Il écouta la radio, mais celle-ci ne prêtait pas attention à lui. Il était tout seul, et rien ne semblait réel dans la solitude. Il avait besoin de quelqu’un, n’importe qui, pour lui parler, pour lui dire ce qu’il ressentait afin d’être sûr de ressentir quelque chose. Cette angoisse d’être seul était si forte qu’il faillit presque sortir de l’institut pour rejoindre la foule, mais l’apathie était encore plus forte que la peur. Il ne fit rien, et le soir s’assombrit.
Sur le mont Hood, la lueur rouge s’élargissait parfois énormément, puis pâlissait à nouveau. Quelque chose explosa dans le sud-ouest de la ville, mais il ne pouvait pas le voir depuis son bureau ; bientôt, les nuages furent éclairés par en dessous d’un reflet blême, qui semblait provenir de cette direction. Haber sortit dans le couloir pour voir ce qui pouvait être vu, portant la radio avec lui. Des gens montaient les escaliers ; il ne les avait pas entendus. Il se contenta de les regarder pendant un instant.
— Docteur Haber ! dit l’un d’eux.
C’était Orr.
— Vous arrivez au bon moment, déclara amèrement Haber. Où diable étiez-vous durant toute cette journée ? Venez !
Orr monta en boitillant ; le côté gauche de son visage était enflé et ensanglanté, sa lèvre était coupée et il avait perdu la moitié d’une incisive. La femme qui l’accompagnait paraissait moins blessée, mais plus fatiguée : les yeux vitreux, elle vacillait sur ses jambes. Orr la fit asseoir sur le divan du bureau.
— Elle a reçu un coup sur la tête ? demanda Haber d’une voix très médicale.
— Non. La journée a été rude.
— Je vais bien, murmura la femme, frissonnant légèrement.
Orr fut rapide et plein de sollicitude. Il lui enleva ses chaussures crottées et la couvrit de la couverture en poils de chameau qui était au pied du lit ; Haber se demanda qui elle était, mais ne s’attarda pas à y réfléchir. Il commençait à réagir.
Читать дальше