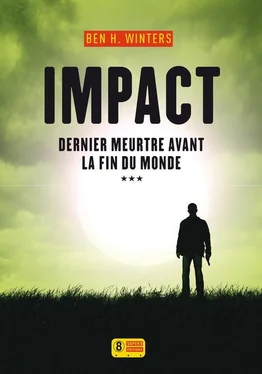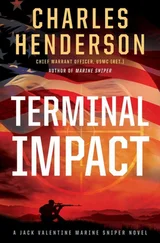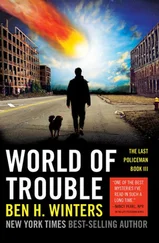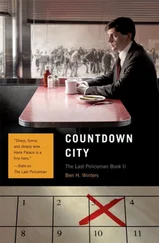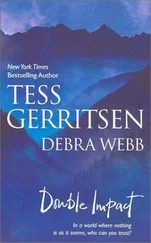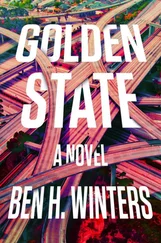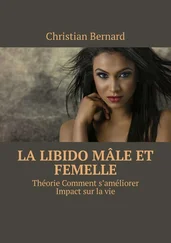Quand Sandy m’a demandé un nom, j’ai dit « Naomi » sans réfléchir – même si Alison Koechner est la fille que j’ai aimée le plus longtemps et Trish McConnell celle que j’ai abandonnée, j’ai dit « Naomi » tout de suite.
Je pense à elle dans les plages de calme, ces moments dégagés par l’absence de télévision, de radio et du tumulte de la compagnie humaine normale, les moments qui ne sont pas comblés par des raisonnements d’enquêteur ni par le discret roulement de tambour de la peur.
J’ai rencontré Naomi Eddes au cours d’une enquête, et essayé de la protéger sans y parvenir. Une nuit ensemble, c’est tout ce que nous avons eu, c’est à peu près ça : un dîner chez Mr. Chow , thé au jasmin et nouilles sautées, puis chez moi, et c’est tout.
Parfois, quand je ne peux plus m’en empêcher, j’imagine comment les choses se seraient terminées pour nous, sans cela. Des avenirs possibles font surface comme des poissons remontés des profondeurs : comme des souvenirs d’événements qui n’ont jamais pu se produire. Nous aurions pu être un jour une de ces heureuses familles de sitcom, joyeusement bordéliques, avec un alphabet aimanté multicolore tout en désordre sur la porte du frigo, avec les corvées du quotidien et le jardinage, les enfants que l’on accompagne à la porte le matin. Des conversations murmurées tard le soir, quand nous aurions été les seuls de la maisonnée à ne pas dormir.
Inutile de s’attarder là-dessus.
Ce n’est pas seulement le présent d’une personne qui meurt avec elle, quand elle est assassinée, noyée ou qu’un rocher géant lui tombe sur la tête. C’est le passé, aussi, tous les souvenirs qui n’appartenaient qu’à elle, ce qu’elle a pensé et jamais dit. Et tous ces futurs possibles, tout ce que la vie lui aurait réservé. Le passé, le futur, le présent, tous brûlés ensemble comme un fagot.
Le scénario le plus probable, cependant, toutes choses étant égales, si Maïa n’avait jamais obscurci le ciel : j’aurais simplement fini seul. Comme l’inspecteur Russel : un bureau propre, pas de photos, carnet ouvert, empilant les heures. Inspecteur consciencieux à quarante ans, vieux sage du service à soixante, débris docile à quatre-vingt-cinq, ruminant encore des affaires résolues ou non des années plus tôt.
* * *
Tous les étals installés en bord de route par les amish se ressemblent : des caisses en bois qui grincent, des paniers vides. Les fruits et légumes, bien évidemment, sont de l’histoire ancienne. Idem pour les tartes et les gâteaux ; le miel amish, le fromage amish, les bretzels amish.
Sur une quinzaine de kilomètres, j’ai l’impression d’en voir des dizaines, et chaque fois je descends de vélo pour chercher soigneusement la moindre trace de bétonnage. À un endroit, de minces poteaux cylindriques soutiennent un auvent en bois ; à un autre, de jolies marches arrondies relient les présentoirs extérieurs à la petite boutique. Encore et toujours, mon corps endolori descend de la bicyclette, la cale sur sa béquille, et se met à quatre pattes pour scruter un terrain abandonné, à la recherche d’un logo rouge tout simple, le mot joy. Encore et toujours, Houdini saute de la remorque et farfouille à mes côtés comme s’il savait ce que nous cherchons – et nous passons ensemble devant des paniers d’osier vides et des carnets de fin papier à reçus.
Une journée entière comme ça. Presque toute une journée gâchée, à ne rien trouver, puis vient la fin de l’après-midi, et chaque fois que je remonte en selle je me dis : peut-être que c’est tout, peut-être que je n’irai pas plus loin, mais je ne peux pas faire demi-tour ; imagine, si je rentrais les mains vides ? J’ai mal partout, je crève de faim, les repas de poulet sont déjà un lointain souvenir et toutes ces enseignes délavées, décorées de tartes et de bretzels, n’arrangent rien.
« Bon, dis-je à Houdini lorsque j’en suis à la sixième, la huitième ou la centième de ces petites échoppes abandonnées. Alors, on fait quoi, maintenant ? »
Il y a Cortez, à Rotary, qui m’attend avec impatience, assis en tailleur sur une trappe secrète : Alors ? Il y a l’inspecteur Culverson, au Somerset , souvenir bénit, tirant avec ironie sur son cigare. Ne me fais pas dire que je te l’avais bien dit, Stretch.
Sauf que tout à coup, voilà – cinq cents mètres plus loin sur la Route n° 4, alors qu’il reste juste assez de jour pour que j’y voie clair –, voilà. Ce n’est pas une marque en creux sur un poteau planté en terre, tout compte fait, ni au bas d’une marche, mais deux mots au-dessus de ma tête, inscrits sur un immense panneau, tout là-haut, en lettres rouges hautes de trois mètres. joy farms.
Et puis, en dessous, en lettres plus petites : fermé, plus personne ici. Et encore en dessous : jésus = le salut.
Il y a aussi un petit étal au pied du panneau, et quelques minutes d’investigation me suffisent pour trouver un étroit chemin, perpendiculaire à la route, qui s’en va dans les champs de maïs. Je m’arrête, regardant tour à tour le panneau et la route, puis je souris, tout simplement, je souris jusqu’à en avoir les joues crispées, rien que pour ressentir ce que ça fait, ne fût-ce qu’une seconde. Ensuite, j’engage mon vélo dans le chemin.
Au bout de quelques centaines de mètres à serpenter entre les rangs de maïs, ce chemin devient un sentier, et quand il diminue encore il devient impraticable pour la remorque, si bien que je sors mon couteau suisse et me sers de la clé pour la détacher. Je laisse le chariot derrière moi et continue de rouler, de plus en plus loin entre les champs. Au bout de dix minutes, un quart d’heure, les nuages se disloquent et commencent à m’inonder le front. Mes roues deviennent glissantes sur le sentier mouillé. Je plisse les paupières, m’essuie les yeux, les essuie encore, je pédale avec davantage de prudence, ralentis. La sente étroite serpente encore dans le maïs jusqu’à ce que je me retrouve à un croisement, puis un autre. Je choisis mon itinéraire au hasard, et comprends au bout d’un moment que je suis perdu dans un dédale de chemins de terre. Il pleut à verse, maintenant, ce qui contribue à m’égarer. Je me dresse en danseuse sur les pédales et me penche un peu en avant, en tâchant de protéger Houdini avec mon corps – Houdini qui a trouvé le moyen de s’endormir. Je continue, de plus en plus loin sur un chemin couvert de gravier, et c’est dur, il pleut des cordes, les gouttes traversent mes sourcils et me détrempent les joues, l’espace d’un instant je tourne les yeux vers les cultures de maïs noyées, et quand je regarde à nouveau devant moi il y a un homme, grand, large d’épaules, coiffé d’un chapeau noir, à cheval, en plein milieu du chemin, des rideaux de pluie s’ouvrant en deux sur son visage, un fusil de chasse braqué sur moi.
Je lui dis bonjour.
Il tire un coup en l’air.
J’ai un mouvement de recul et je braque le guidon vers la droite, ce qui me fait sortir du chemin pour m’échouer dans les tiges de maïs. Je me débarrasse du vélo, Houdini saute du panier. Je pars en courant, les mains sur la tête. Encore deux coups de fusil. Chacun émet une détonation puissante, ka-boummm , comme s’il me tirait dessus avec un canon.
« Arrêtez ! je crie depuis le sol, les mains plaquées des deux côtés de la tête. Arrêtez, je vous en supplie ! » Je rampe entre les tiges et les rideaux de pluie. Le cœur battant à tout rompre. Le chien se met debout en trébuchant, trempé par la pluie, regarde autour de lui et se met à aboyer.
La fusillade a cessé. Je suis au sol. Je ne suis pas touché, pas blessé, trempé de pluie, à demi dissimulé par les rangs de maïs. Je vois les sabots du cheval avancer vers moi en soulevant des gerbes d’éclaboussures.
Читать дальше