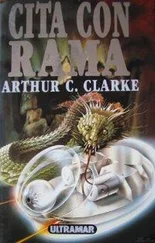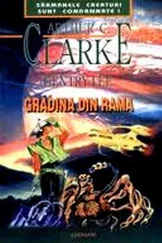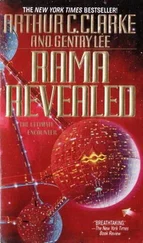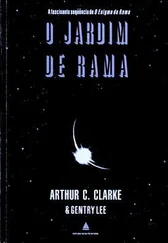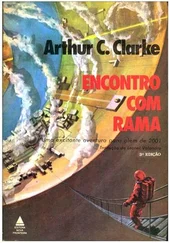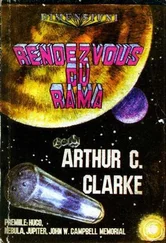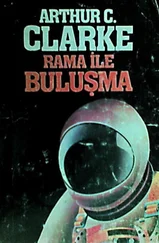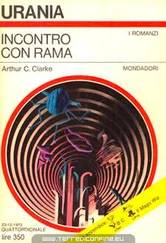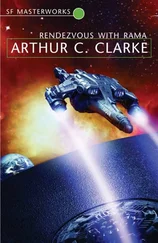— Cette mission est la plus importante de mon existence. Je tiens à servir à la fois Dieu et l’humanité, et c’est pourquoi je m’efforce de m’y préparer le mieux possible. J’espère découvrir si les Raméens possèdent ou non une âme, et ce désir pourrait influencer mes actions.
Il attendit quelques secondes avant d’ajouter :
— À ce propos, Votre Sainteté, les informations récoltées lors du précédent rendez-vous ont-elles permis aux théologiens de trouver des preuves de spiritualité chez les Raméens ?
Jean-Paul V secoua la tête.
— Non. Mais un de mes archevêques, un dévot qui laisse parfois son zèle religieux prendre le pas sur sa logique, affirme que les structures internes de Rama I – symétrie, formes géométriques, redondance basée sur le nombre trois – font penser à un temple. Peut-être a-t-il raison. Je ne saurais le dire. Nous ne pouvons pour l’instant nous prononcer sur la spiritualité de ceux qui ont fabriqué ce vaisseau.
— C’est stupéfiant ! Je n’avais encore jamais considéré la question sous ce jour. Imaginez que Rama ait vraiment un caractère sacré. David Brown n’en reviendrait pas, affirma le général en riant. Il soutient que les pauvres êtres humains ignorants que nous sommes ne pourront pas déterminer la finalité d’un tel appareil parce que la technologie de ses constructeurs nous dépasse. Et il réfute la possibilité d’une religion raméenne. Pour lui, des êtres évolués à ce point ont dû se débarrasser de toutes leurs superstitions. Il pense que c’est indispensable pour atteindre le stade où il devient possible de voyager dans l’espace interstellaire.
— Ce Brown est un athée, je crois ?
— Il ne s’en cache pas. Il proclame que les croyances religieuses sont un carcan pour l’esprit et assimile tous ceux qui ne partagent pas ce point de vue à des imbéciles.
— Et les autres membres de l’expédition ? Ont-ils des opinions aussi catégoriques ?
— Il est le seul à se déclarer ouvertement athée, mais je suspecte Wakefield, Tabori et Turgenyev de partager ses convictions. Le commandant Borzov semble avoir un faible pour la religion, comme la plupart des survivants du Chaos. Il m’interroge souvent sur ma foi, en tout cas.
Le général O’Toole se tut pour compléter mentalement sa liste.
— Les deux Européennes, Desjardins et Sabatini, sont catholiques mais pas pratiquantes. L’amiral Heilmann est luthérien les jours de Pâques et de Noël. Takagishi consacre du temps à la méditation et à l’étude du zen. Je ne saurais me prononcer, poux les deux autres.
Le souverain pontife se leva et gagna la fenêtre.
— Quelque part dans l’espace un véhicule spatial étrange et merveilleux, créé par des êtres nés près d’une étoile lointaine, se dirige vers nous. Nous envoyons un groupe de douze humains à sa rencontre…
Il se tourna vers le visiteur.
— Si ce vaisseau nous est envoyé par Dieu, il est probable que vous seul pourrez le déterminer.
O’Toole ne répondit rien. Le pape regarda à nouveau par la fenêtre et attendit près d’une minute avant d’ajouter :
— Non, mon fils, je ne peux dissiper vos doutes. Dieu seul connaît les réponses aux questions que vous vous posez. Priez pour qu’il vous les inspire quand le moment sera venu.
Il se tourna vers le militaire.
— Je suis ravi de découvrir que vous vous sentez à ce point concerné. J’ai l’intime conviction que c’est Dieu qui vous a désigné pour participer à cette mission.
Le général O’Toole comprit que l’entretien tirait à sa fin.
— Saint-Père, je vous remercie d’avoir accepté de me recevoir et de me consacrer un peu de votre temps précieux. J’en suis profondément honoré.
Jean-Paul V sourit et vint lui donner une accolade avant de le raccompagner jusqu’à la porte du bureau.
11. SAINT-MICHEL-DE-SIENNE
La station de métro débouchait en face de l’entrée du Parc international de la Paix. Sitôt après avoir pris l’escalier mécanique le général O’Toole put voir dans la clarté de l’après-midi le dôme de la chapelle sur sa droite, à moins de deux cents mètres. Sur sa gauche, dans le lointain, il apercevait le sommet du vieux Colisée au-dessus d’un ensemble de bâtiments administratifs.
L’Américain entra d’un pas rapide dans le parc et obliqua vers la chapelle. Il passa devant une fontaine – un des éléments du monument érigé aux enfants du monde – et s’arrêta pour regarder les sculptures animées qui jouaient dans l’eau froide du petit bassin. O’Toole bouillait d’impatience. Quelle journée extraordinaire ! se dit-il. Je viens d’être reçu par le pape et je vais visiter la chapelle Saint-Michel.
Quand Michel de Sienne avait été canonisé, en 2188 – cinquante ans après sa mort et, fait peut-être plus significatif, trois ans après l’élection de Jean-Paul V –, tous avaient estimé que le Parc international de la Paix représentait le lieu idéal où ériger une chapelle qui lui serait consacrée. Ce grand parc s’étendait de la piazza Venezia au Colisée, au milieu des rares ruines de l’ancien Forum épargnées par la déflagration nucléaire. Choisir son emplacement exact s’avérait plus délicat. Le mémorial des Cinq Martyrs dressé en l’honneur des hommes et des femmes qui avaient courageusement conjugué leurs efforts pour rétablir l’ordre à Rome après le désastre était le centre d’intérêt de ce lieu depuis des années et la chapelle Saint-Michel-de-Sienne ne devait pas éclipser le majestueux pentagone de marbre à ciel ouvert érigé dans l’angle sud-est en 2155.
Après maints débats il fut décidé que la chapelle serait bâtie du côté opposé, au nord-ouest, à l’épicentre de l’explosion nucléaire et à seulement dix mètres de l’emplacement où se dressait autrefois la colonne Trajane, avant qu’elle n’eût été instantanément réduite en vapeur par la chaleur intense de la sphère de feu. Le rez-de-chaussée du monument était réservé à la méditation et la prière. Douze absidioles s’ouvraient sur son pourtour, six avec des sculptures et autres œuvres d’art conformes aux thèmes classiques du catholicisme romain et les six autres dédiées aux grandes religions du monde. Cette répartition œcuménique de l’espace avait été décidée pour offrir un certain confort de l’esprit aux nombreux pèlerins non catholiques qui venaient rendre hommage au bien-aimé saint Michel.
Le général O’Toole ne s’attarda pas au rez-de-chaussée. Il s’agenouilla pour réciter une prière dans la chapelle Saint-Pierre et accorda un coup d’œil à la statue en bois du Bouddha qui occupait le renfoncement à côté de l’entrée, mais comme beaucoup de touristes il était impatient d’admirer les fresques du niveau supérieur. Dès qu’il sortit de l’ascenseur, O’Toole fut sidéré par les dimensions et la beauté des célèbres tableaux. Il avait en face de lui un portrait grandeur nature d’une jeune femme de dix-huit ans à la longue chevelure blonde. C’était le soir de Noël 2115 et elle sortait en gardant la tête basse d’une vieille église de Sienne. Elle laissait derrière elle un bébé aux cheveux bouclés, enveloppé d’une couverture et placé dans un panier, à même le sol glacial de la nef. Il s’agissait de la naissance de saint Michel, la première des douze fresques du pourtour de la chapelle qui retraçaient la vie du saint.
O’Toole se dirigea vers le kiosque situé à droite de l’ascenseur pour louer un guide de poche. Il inséra dans son oreille le petit écouteur jetable, choisit la langue anglaise, pressa le bouton « Introduction » et glissa l’appareil dans sa poche pendant qu’il admirait la finesse des traits du bambin visible sur le premier panneau et qu’une voix féminine lui murmurait :
Читать дальше