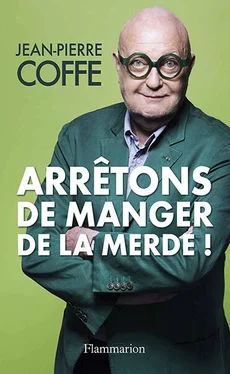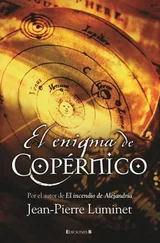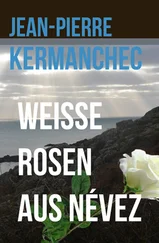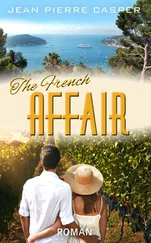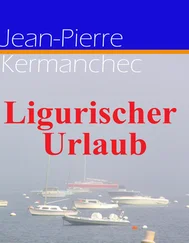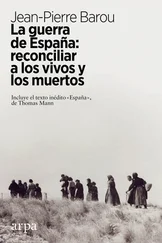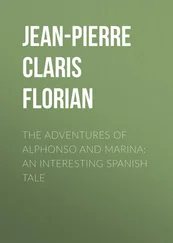Produire autrement signifie, pour certains, que jusqu’à présent ils « produisaient mal », aussi beaucoup d’agriculteurs se sentent « insultés », « incompris ». Le paysan est fier, on l’a encouragé à nourrir de plus en plus de bouches, et il considère à juste titre qu’il a rempli sa mission. Maintenant, on lui dit qu’il pollue et qu’il devrait être responsable de son territoire. Les mentalités évoluent, lentement, trop lentement. En 2009, le gouvernement a lancé un plan d’action nommé « Écophyto ». Son but est d’inciter les paysans à découvrir d’autres horizons, des systèmes de production plus raisonnés, plus raisonnables. Deux mille fermes pilotes expérimentent au quotidien des techniques pour réduire l’usage de fongicides et autres produits « phytopharmaceutiques ». On les encourage à pratiquer la rotation des cultures, le désherbage mécanique, la pulvérisation à bas volume, etc. Projet ambitieux, mais qui devrait passer par le biais de l’enseignement dans les lycées agricoles, où l’on promeut encore l’agriculture extensive, le recours aux ingénieurs et aux gourous du phytosanitaire. Aura-t-on le courage de bouleverser les habitudes ? Les pieuses ambitions, c’est bien, les décisions, c’est mieux.
Rien n’a changé depuis la seconde moitié du XIXe siècle, ou si, des bouleversements ont eu lieu, mais qui ne sont pas allés dans le bon sens. Lisez plutôt ce texte écrit en 1854, sous le règne de Napoléon III, au retour d’un voyage en Grande-Bretagne (il aurait pu être écrit après un périple en France). L’auteur, Léonce de Lavergne [5] Essai sur l’économie rurale de l’Angleterre, de l’Écosse et de l’Irlande , Guillaumin, Paris, p. 214–215.
, économiste libéral, fait un constat préoccupant qui laisse paraître ses inquiétudes. Malheureusement, il influencera la politique agricole française :
« Les cochons, comme les bœufs, sont nourris sans sortir, dans des loges fermées et sur des planchers percés (…) On ne peut se défendre d’un sentiment pénible en voyant ces pauvres bêtes (…) Ces fabriques de viande (…) où l’animal vivant est traité absolument comme une machine, ont quelque chose de rebutant (…) Mais la grande voix de la nécessité parle ; il faut à toute force nourrir cette population qui s’accroît sans cesse, et dont les besoins augmentent plus vite que le nombre ; il faut abaisser autant que possible le prix de revient de la viande pour s’accommoder aux prix nouveaux et y trouver encore des bénéfices.
Déjà, des plaintes s’élèvent sur la qualité de la viande (…) on dit que les tourteaux lui communiquent un mauvais goût (…) il est possible aussi que quelque maladie nouvelle se développe tout à coup parmi ces races inertes et obèses. »
Il est regrettable que Monsieur de Lavergne n’ait pas eu le temps de constater l’échec de ces initiatives ; les premiers élevages industriels échouèrent tant en France qu’en Angleterre : sans antibiotiques — découverts au XXe siècle seulement —, les animaux mouraient dans leur univers concentrationnaire. Une chance ? Non, un répit pour le cochon français.
Jusqu’en 1935, l’élevage des cochons était l’apanage des fermiers qui engraissaient deux ou trois porcs pour faire face à la consommation familiale. Ils étaient lourds et gras, vivaient à la va comme j’te pousse, les restes de table les contentaient, l’eau de vaisselle allongeait la soupe, ils vivaient en extérieur, glanaient, et selon l’abondance des récoltes, se satisfaisaient de quelques pommes de terre, topinambours et betteraves. Les deux tiers des cochons élevés en France étaient de races indéterminées. Petit à petit, les races régionales s’imposèrent : cul noir du Limousin, porc de Bayeux, porc basque, porc gascon, porc de Miélan, porc de l’Ouest, craonnais…
Les premières porcheries « dignes de ce nom » s’installèrent à proximité des fromageries. Les cochons nourris au petit-lait étaient très appréciés des charcutiers.
Très vite, les porcheries se multiplièrent à la périphérie des grandes villes. Songez que, en 1955, on recensait trois cents porcheries dans la région parisienne. Elles recyclaient les déchets alimentaires des restaurants et des casernes, mais les habitants se plaignaient des odeurs, des mouches, des rats, corollaires de la « nouvelle industrie ».
Avant la fin de la guerre, un porc d’origine anglaise, le Large White, fit parler de lui, et sa conquête des porcheries françaises commença. Solide musculature, fécondité exceptionnelle : toutes les qualités pour séduire les éleveurs déjà en quête de productivité.
La révolution se préparait. Dans les villes, les ouvriers réclamaient de la viande bon marché, et dans les campagnes, les agriculteurs voulaient gagner davantage. Les planificateurs, eh oui, on les appelle ainsi, furent formels : « rationaliser la production ». On assista alors à la naissance des premières usines à cochon, ce qu’il est convenu d’appeler dans le jargon : des élevages hors sol. Qu’est-ce que cela veut dire ? De sa naissance jusqu’à son départ à l’abattoir, le cochon vivait avec quelques centaines de congénères, claquemuré dans un bâtiment. Comme la poule pondeuse, il vivait mal son enfermement. Le malentendu s’installa entre les éleveurs et le cochon. Les premiers lui demandaient de manger peu et de grossir vite, et le second voulait faire du gras. Les généticiens trouvèrent l’hybride idéal, en accouplant le Large White avec le Land Race, d’origine danoise. Victoire ! Les truies hybrides cochonnèrent (mettre bas, du verbe cochonner, expression en usage dans le monde porcin) comme des lapines : huit… dix… douze… quinze porcelets par portée ! Un bonus de cinq gorets en vingt ans. Hourra !
La vie n’est pas toujours rose pour le cochon. Je vous déconseille vivement de tenter une visite dans un élevage. Âme sensible, défenseur du bien-être animal, s’abstenir. Entassés comme des sardines, parqués comme des fauves en cage, les porcs vivent reclus dans des espaces exigus, éclairés à la lueur des néons, sortant le groin pour s’abreuver dans l’auge. Ils piétinent sur des caillebotis, excréments et urines sont évacués directement dans une fosse, l’atmosphère est irrespirable, à la limite de l’asphyxie par l’ammoniac. Il fallut attendre 2003, le 2 janvier, précisément, pour que Bruxelles se décide à légiférer sur leur bien-être. Tout relatif, rassurez-vous : « Tous les porcs doivent pouvoir accéder en permanence à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes, telles que la paille, le foin, la sciure de bois, le compost de champignon, la tourbe, ou un mélange de ces matériaux, qui ne compromettent pas la santé des animaux. » Les éleveurs furent contre, mais des subventions les apaisèrent.
Dans les élevages concentrationnaires, les maladies sont fréquentes et les dépenses vétérinaires augmentent proportionnellement au nombre d’animaux, la piqûre d’antibiotique est donc toujours à portée de main… Les antibiotiques ne sont pas employés uniquement pour soigner les bêtes, mais aussi pour activer la croissance. En 1999, en Europe, le monde animal consommait 4 700 tonnes d’antibiotiques, 29 % pour soigner les animaux et 6 % comme facteur de croissance. À la même époque, la consommation humaine était de 8 005 tonnes. Rassurez-vous, l’utilisation de facteurs de croissance a chuté de 50 % (source FEDESA, Fédération européenne de la santé animale). Vous paraissez rassurés ? Sachez que, sur les animaux gavés d’antibiotiques, la résistance aux bactéries ne fait que s’accroître. C’est peut-être identique pour les humains !
Читать дальше