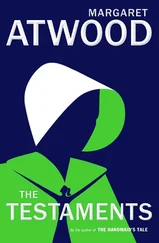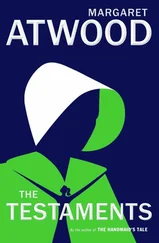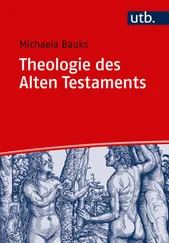TRANSCRIPTION LUDIQUE
Distinguons deux choses. D'un côté: la tendance générale à réhabiliter des principes oubliés de la musique du passé, tendance qui traverse toute l'œuvre de Stravinski et celle de ses grands contemporains; de l'autre côté: le dialogue direct que Stravinski mène une fois avec Tchaïkovski, une autre fois avec Pergolèse, puis avec Gesualdo, etc. ; ces "dialogues directs", transcriptions de telle ou telle œuvre ancienne, de tel ou tel style concret, sont la manière propre à Stravinski qu'on ne rencontre pratiquement pas chez ses contemporains compositeurs (on la rencontre chez Picasso).
Adorno interprète ainsi les transcriptions de Stravinski (je souligne les mots-clés): "Ces notes [à savoir les notes dissonantes, étrangères à l'harmonie, que Stravinski utilise, par exemple, dans Pulcinella, M.K.] deviennent les traces de la violence exercée par le compositeur contre l'idiome, et c'est cette violence qu'on savoure en elles, cette façon de brutaliser la musique, d'attenter en quelque sorte à sa vie. Si la dissonance était autrefois l'expression de la souffrance subjective, son âpreté, changeant de valeur, devient maintenant la marque d'une contrainte sociale , dont l'agent est le compositeur lanceur de modes. Ses œuvres n'ont d'autre matériau que les emblèmes de cette contrainte, nécessité extérieure au sujet, sans commune mesure avec lui, et qui lui est simplement imposée du dehors. Il se pourrait que le large retentissement qu'ont connu les œuvres néoclassiques de Stravinski ait été dû en grande partie au fait que sans en avoir conscience, et sous couleur d'esthétisme, elles ont à leur manière formé les hommes à quelque chose qui leur a été bientôt infligé méthodiquement sur le plan politique".
Récapitulons: une dissonance est justifiée si elle est l'expression d'une "souffrance subjective", mais chez Stravinski (moralement coupable, comme on sait, de ne pas parler de ses souffrances) la même dissonance est signe de brutalité; celle-ci est mise en parallèle (par un brillant court-circuit de la pensée adornienne) avec la brutalité politique: ainsi les accords dissonants ajoutés à la musique d'un Pergolèse préfigurent (et donc préparent) la prochaine oppression politique (ce qui, dans le contexte historique concret, ne pouvait signifier qu'une seule chose: le fascisme).
J'ai eu ma propre expérience de la transcription libre d'une œuvre du passé quand, au commencement des années soixante-dix, alors que j'étais encore à Prague, je me suis mis à écrire une variation théâtrale sur Jacques le Fataliste. Diderot étant pour moi l'incarnation de l'esprit libre, rationnel, critique, j'ai vécu alors mon affection pour lui comme une nostalgie de l'Occident (l'occupation russe de mon pays représentait à mes yeux une désoccidentalisation imposée). Mais les choses changent perpétuellement leur sens: aujourd'hui je dirais que Diderot incarnait pour moi le premier temps de l'art du roman et que ma pièce était l'exaltation de quelques principes familiers aux anciens romanciers, et qui, en même temps, m'étaient chers: 1) la liberté euphorique de la composition; 2) le voisinage constant des histoires libertines et des réflexions philosophiques; 3) le caractère non-sérieux, ironique, parodique, choquant, de ces mêmes réflexions. La règle du jeu était claire: ce que j'ai fait n'était pas une adaptation de Diderot, c'était ma pièce à moi, ma variation sur Diderot, mon hommage à Diderot: j'ai recomposé entièrement son roman; même si les histoires d'amour sont reprises de lui, les réflexions dans les dialogues sont plutôt les miennes; chacun peut découvrir immédiatement qu'il y a là des phrases impensables sous la plume de Diderot; le XVIII esiècle était optimiste, le mien ne l'est plus, je le suis encore moins, et les personnages du Maître et de Jacques se laissent aller chez moi à des énormités noires difficilement imaginables à l'époque des Lumières.
Après cette petite expérience personnelle je ne peux que tenir pour bêtes les propos sur la brutalisation et la violence de Stravinski. Il a aimé son vieux maître comme j'ai aimé le mien. En ajoutant aux mélodies du XVIII esiècle les dissonances du XX e, peut-être imaginait-il qu'il intriguerait son maître dans l'au-delà, qu'il lui confierait quelque chose d'important sur notre époque, voire qu'il l'amuserait. Il avait besoin de s'adresser à lui, de lui parler. La transcription ludique d'une œuvre ancienne était pour lui comme une façon d'établir une communication entre les siècles.
TRANSCRIPTION LUDIQUE SELON KAFKA
Curieux roman, L'Amérique de Kafka: en effet, pourquoi ce jeune prosateur de vingt-neuf ans a-t-il situé son premier roman dans un continent où il n'a jamais mis les pieds? Ce choix montre une intention claire: ne pas faire du réalisme; encore mieux: ne pas faire du sérieux. Il ne s'est même pas efforcé de pallier son ignorance par des études; il s'est créé son idée de l'Amérique d'après une lecture de second ordre, d'après des images d'Épinal, et, en effet, l'image de l'Amérique dans son roman est faite (intentionnellement) de clichés; en ce qui concerne les personnages et l'affabulation, l'inspiration principale (comme il l'avoue dans son journal), c'est Dickens, spécialement son David Copperfield (Kafka qualifie le premier chapitre de L'Amérique de "pure imitation" de Dickens): il en reprend les motifs concrets (il les énumère: "L'histoire du parapluie, des travaux forcés, les maisons sales, la bien-aimée dans une maison de campagne"), il s'inspire des personnages (Karl est une tendre parodie de David Copperfield) et surtout de l'atmosphère où baignent tous les romans de Dickens: le sentimentalisme, la distinction naïve entre les bons et les mauvais. Si Adorno parle de la musique de Stravinski comme d'une "musique faite d'après la musique", L'Amérique de Kafka est une "littérature faite d'après la littérature" et elle est même, dans ce genre, une œuvre classique, sinon fondatrice.
La première page du roman: dans le port de New York, Karl est en train de sortir du bateau quand il se rend compte qu'il a oublié son parapluie dans la cabine. Pour pouvoir aller le chercher, avec une crédulité à peine croyable, il confie sa valise (lourde valise où il a tout son avoir) à un inconnu: bien sûr, il perdra ainsi et la valise et le parapluie. Dès les premières lignes, l'esprit de parodie ludique fait naître un monde imaginaire où rien n'est tout à fait probable et où tout est un peu comique.
Le château de Kafka qui n'existe sur aucune carte du monde n'est pas plus irréel que cette Amérique conçue à l'image-cliché de la nouvelle civilisation du gigantisme et de la machine. Dans la maison de son oncle sénateur, Karl trouve un bureau qui est une machine extraordinairement compliquée, avec une centaine de cases obéissant aux ordres d'une centaine de boutons, objet à la fois pratique et tout à fait inutile, à la fois miracle technique et non-sens. J'ai compté dans ce roman dix de ces mécanismes merveilleux, amusants et invraisemblables, depuis le bureau de l'oncle, la dédaléenne villa de campagne, l'hôtel Occidental (architecture monstrueusement complexe, organisation diaboliquement bureaucratique), jusqu'au théâtre d'Oklahoma, lui aussi immense administration insaisissable. Ainsi, c'est par la voie du jeu parodique (du jeu avec des clichés) que Kafka a abordé pour la première fois son plus grand thème, celui de l'organisation sociale labyrinthique où l'homme se perd et va à sa perte. (Du point de vue génétique: c'est dans le mécanisme comique du bureau de l'oncle que se trouve l'origine de l'administration terrifiante du château). Ce thème, si grave, Kafka a pu le saisir non pas par la voie d'un roman réaliste, fondé sur une étude à la Zola de la société, mais justement par cette voie apparemment frivole d'une "littérature faite d'après la littérature" qui a donné à son imagination toute la liberté nécessaire (liberté d'exagérations, d'énormités, d'improbabilités, liberté d'inventions ludiques).
Читать дальше