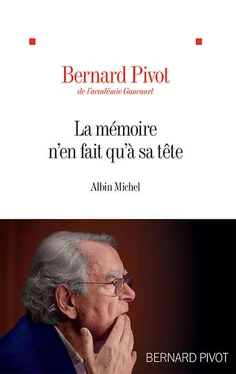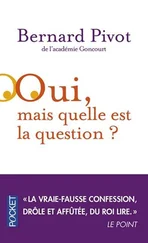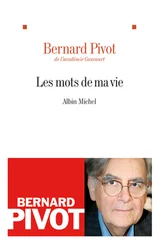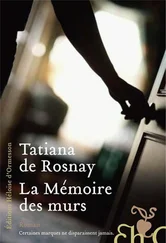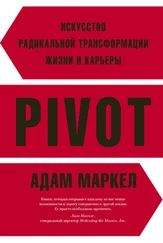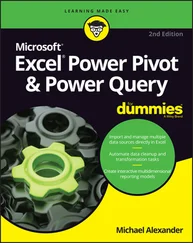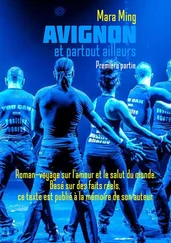Frederic Prokosch avait rencontré Ezra Pound à Rapallo, en 1937 ou 38. « Il me traita avec une jovialité rustaude, railleuse, écrit-il, et me demanda de jouer en double, le lendemain après-midi. » Cette partie de tennis qui opposa les deux écrivains américains à un Anglais et à « une maigre dame italienne appelée la Signorina Piaggio » mériterait de figurer dans toutes les anthologies de littérature sportive ou mondaine. En voici le récit :
« La redoutable Signorina écrasa un lob d’Ezra Pound.
— Merde ! s’écria Pound. Je n’ai pas lancé la foutue balle assez haut.
Et dans un chuchotement mauvais :
— … Quelle harpie, cette bonne femme !
Il commit une double faute au service, puis lança une balle au filet.
— Zéro quarante [1] En français dans le texte.
! roucoula la Signorina, et Ezra Pound réussit un service magistral.
– Ça fera les pieds à cette connasse efflanquée, ricana-t-il triomphalement.
La Signorina envoya droit à Ezra un puissant revers. Il poussa un glapissement en se protégeant l’abdomen avec sa raquette.
— Jeu et set ! cria la Signorina en lançant en l’air sa propre raquette.
Ezra roulait des yeux furibonds.
— Elle essaie de me castrer ! C’est une louve déguisée en cigogne !
Puis, en un murmure confidentiel :
— … Envie du pénis. Absolument révoltant. »
Je n’avais évidemment pas reconnu le solennel spectre à barbe blanche dans ce joueur de tennis grossier, hilarant, que sa misogynie n’avait pas aidé à gagner la partie. Entre-temps, il est vrai, étaient passés la guerre, la prison psychiatrique, le déshonneur, la solitude orgueilleuse…
Frederic Prokosch ne fait aucun commentaire sur la suite de l’existence d’Ezra Pound. Il se contente de rapporter ses propos déjà hostiles aux États-Unis, accusés de médiocrité, de corruption et d’hypocrisie. Il revient aussi sur sa manière de jouer au tennis qu’il compare à sa poésie des Cantos : « Un tourbillon de rage, percé par des instants de splendeur à moitié folle, et moucheté d’une certaine incohérence flamboyante. »
Romain Gary raconte que sa mère, qui n’était pas une grande comédienne, jouait dans une pièce une vieille femme soutenue par deux hommes. Elle fuyait son village en feu. Sans un mot, elle traversait la scène. Traînant les pieds, « elle s’accrochait, elle marchait trop lentement, il fallait la pousser hors de la scène parce que c’était son seul rôle et elle y tenait », Le Sens de ma vie .
En 2005, Olivier Minne a eu l’idée amusante de demander à ses camarades animateurs et journalistes de France 2 de se joindre à lui pour jouer Un fil à la patte , de Feydeau. Mise en scène par Francis Perrin, il n’y eut qu’une seule représentation au Théâtre des Nouveautés, mais filmée et diffusée avec succès sur la chaîne.
J’avais accepté d’en être à condition d’y avoir un rôle muet. Ma rétive mémoire aurait peut-être éprouvé des difficultés à retenir un texte et à le restituer au public sans hésitations. Au troisième acte, scène 4, il y a un rôle aussi bref et muet que celui de la mère de Romain Gary. Sur le palier du deuxième étage d’une maison bourgeoise, où claquent les portes et les répliques, « un monsieur, écrit Feydeau, apparaît, salue le général en passant et gagne l’étage supérieur. Le général rend le salut ». Avec son costume clinquant d’officier sud-américain, sa poitrine constellée de médailles, ce général Irrigua a de quoi étonner un habitant de l’immeuble. Rentrant chez lui, il ne s’attend pas à rencontrer sur le palier du deuxième étage un personnage inconnu dont la présence est d’autant plus insolite que sa mise est extravagante. Je devais en passant, sans mot dire, manifester ma surprise, puis saluer d’un mouvement de tête. Tout dans le regard, le jeu de physionomie. Rôle admirable. Un sommet.
Le soir de la représentation, tandis que je piaffais en coulisses — « ma scène » se situe presque au terme de la pièce —, je saisis soudain que mon silence allait beaucoup étonner le public. D’habitude, sitôt que ma tête s’encadrait dans les postes de télévision, je parlais. J’étais classé bavard. On allait me découvrir mutique, à contre-emploi. Quelle chance ! J’étais si content de paraître ce que je n’étais pas que, pour faire durer le plaisir, j’ai joué plus lentement que lors des répétitions. Je me suis arrêté plus longuement devant le général, j’ai monté paresseusement l’escalier et, avant de disparaître des yeux des spectateurs braqués sur moi, je me suis arrêté et retourné pour jeter un dernier regard étonné et ironique sur le général Irrigua.
Je n’avais pu ajouter ces quelques secondes à mon rôle que parce que je n’étais pas accompagné, comme la mère de Romain Gary, par un ou deux figurants pressés d’en finir. Ils m’auraient poussé dans l’escalier pour que je monte plus vite et m’auraient peut-être même pincé les fesses.
Nicole Lapierre : « Dans les sociétés traditionnelles, les morts ne sont pas loin des vivants. Je le dis à mes amis qui viennent de perdre un proche : une fois passé le chagrin, il y a une sorte de proximité douce avec les morts », dans Le Journal du dimanche lors de la sortie de Sauve qui peut la vie .
Cette « proximité douce » avec les morts, autrement dit sereine, confiante, je ne l’ai quasiment jamais ressentie. Elle me manque. Son absence m’inquiète. Je ne puis en rendre responsables mes pauvres morts. N’étant nulle part et partout, ils sont là où je veux bien leur donner une présence, marchant à côté de moi dans la rue, assis dans le métro ou dans le train, sur la terrasse de la maison de famille, leur tête sur mon oreiller ou — ce ne sont pas toujours eux qui se déplacent — dans le cimetière où leurs corps reposent. De leur vivant, ils n’étaient pas aussi disponibles. Il ne tient qu’à moi de les rendre plus proches.
Si je n’y parviens guère ou, plutôt, soyons franc, si je le fais rarement, c’est parce que ce ne sera pas dans une douce proximité. Il me semble que je leur fournis plus de motifs de me blâmer que de raisons de me complimenter. Je leur prête la faculté de me suivre jour et nuit, d’être les témoins de tous mes actes, de lire mes pensées, de peser mes sentiments. Il faudrait que je sois bien sûr de mes mérites pour ne pas imaginer que, quelles que soient la pérennité de leur affection, la force de leur amour, ils n’aient pas de reproches à me faire. Leur bienveillance à mon égard n’est ni sourde ni aveugle. Ils sont restés mon père et ma mère. Non qu’ils aient été plus sévères que d’autres, mais l’adulte que je suis depuis si longtemps est plus tortueux que l’enfant, plus toxique, moins pardonnable.
Fidèles à leurs principes jusqu’à leur dernier souffle, pourquoi depuis en auraient-ils changé ? Les miens ont évolué avec le temps. Il est peu probable, même avec l’indulgence du ciel, qu’ils n’en soient pas chagrins et dépités.
Avec mes morts, j’ai une proximité tendre, mais inquiète, crispée. Mes morts sont dans ma conscience.
Marcel Proust : « Sa haine des snobs découlait de son snobisme, mais faisait croire aux naïfs, c’est-à-dire à tout le monde, qu’il en était exempt », Le Côté de Guermantes .
Ce n’est pas parce qu’il portait un nœud papillon que Jean-Jacques Brochier — qui dirigea pendant trente-cinq ans Le Magazine littéraire — était considéré comme un snob par ses camarades lyonnais. Dans la classe de philo du lycée Ampère, ils étaient seulement deux élèves à avoir lu Proust et Sartre. Ils en avaient lu suffisamment, en particulier L’Être et le Néant , pour en parler savamment avec le professeur. Comme les autres, j’écoutais bouche bée. Admiratif. Surtout jaloux. Nous nous vengions bêtement en les traitant de snobs. À nos yeux, Jean-Jacques Brochier le paraissait un peu plus que l’autre à cause de son nœud papillon.
Читать дальше