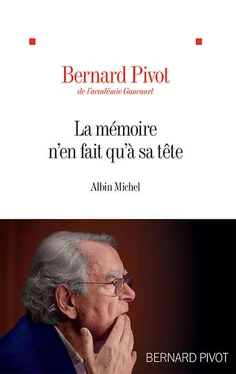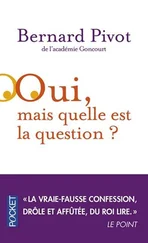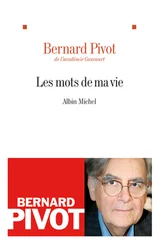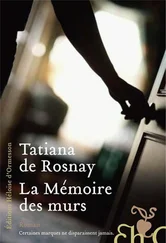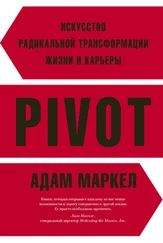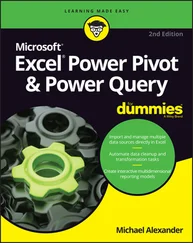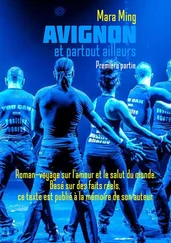Un soir que, par exception, je faisais une conférence, j’avais demandé à ma fiancée qui habitait Varsovie de m’envoyer par texto le score à la mi-temps d’un match de Coupe d’Europe de football. Score encourageant qui m’a dopé. Peut-être le public a-t-il perçu, à ce moment-là, dans ma voix et dans mes gestes, ce que les athlètes appellent « un second souffle ».
Les résultats sportifs ne sont pas les seuls à provoquer mon impatience. Il y a aussi les élections, et pas uniquement en France, les comptes publics du pays, les chiffres du chômage, les cotes de popularité, les sondages sur tout, l’essentiel et n’importe quoi, les chiffres de vente des livres, de la presse, le nombre d’entrées au cinéma, dans les grandes expositions, l’audience des radios et des télévisions, les records absurdes… Toutes les compétitions ou presque m’intéressent. J’échappe par bonheur à la fluctuation des cours de la Bourse ; et peu me chaut le prix de l’once d’or.
Si je calcule le nombre d’heures que j’ai consacrées, ma vie durant, chaque jour, à la lecture de la presse, à l’écoute des journaux, de la radio et de la télévision, si je les traduis, oh, non pas en semaines ni en mois, mais en années, comment ne pas être horrifié par ma dépendance à l’éphémère ?
Et combien de livres ai-je lus qui n’avaient d’autres mérites que d’être dans l’actualité de l’édition et de fournir de la matière à mes émissions ou à mes articles ? Sur des milliers de livres, combien, surmontant l’épreuve du temps, étaient-ils assez beaux ou novateurs pour échapper à l’oubli ? Combien de livres lus ont-ils accédé à l’argentier de la littérature, à l’empyrée de l’inactuel : la bibliothèque ?
Pierre Hebey avance qu’on ne doit pas craindre de briser une conversation à table sur les nouvelles du jour en y introduisant à brûle-pourpoint Toulet ou Mérimée. Ne risque-t-on pas alors de passer pour un cuistre ?
Le goût de l’inactuel demande de la distance, un peu d’égoïsme. Surtout du temps. Mes années de bavardage littéraire à la télévision étant derrière moi, je me promettais de lire ou de relire Platon, Virgile, Rousseau, Tocqueville, Huysmans, Jerome K. Jerome, Evelyn Waugh, Toulet, Aragon, etc. Mais j’ai embrayé avec une chronique sur les livres au Journal du dimanche , aussitôt suivie d’une élection à l’académie Goncourt. J’étais de nouveau dans l’obligation de coller à l’actualité de la librairie, sujétion aggravée par ma curiosité de concierge pour ce qui se cache sous les couvertures.
Il m’arrive cependant de prendre dans la Pléiade l’un des treize volumes de la Correspondance de Voltaire ; une pièce de Molière ; un pamphlet de Paul-Louis Courier ; les poèmes de Cendrars, et de lire au hasard, assis sur le bras d’un fauteuil, pendant cinq ou dix minutes. Ce qui m’enchante, c’est d’y trouver des pages ou quelques lignes qui, bien loin d’être datées, forcloses, semblent évoquer des personnages d’aujourd’hui, avec leurs ridicules ou leurs vertus, ou bien interrogent des idées toujours en circulation, ou encore relatent des faits dont nous connaissons les pareils. Dans l’inactuel je recherche inconsciemment l’actualité. Je suis incorrigible.
De Simone de Beauvoir à Jean-Paul Sartre : « Je vous aimais tant dans ce petit train hier ; vous savez, vous êtes si gentil, cher petit être, vous êtes bien plus qu’assez gentil, vous êtes le plus gentil des petits et je suis tout heureuse avec vous », Lettres à Sartre , 13 juillet 1939.
On n’a pas tort de dire que l’amour rend un peu bébête même les personnes les plus intelligentes du monde. Il est en même temps sympathique de constater que Simone de Beauvoir, amoureuse, pouvait se laisser aller à des nunucheries semblables aux nôtres. Ça rassure. Ce qui frappe et étonne à la lecture des 321 longues lettres qu’elle a écrites à Sartre de 1930 à 1963, c’est, entre autres, l’emploi immodéré de l’adjectif « petit » : « Tout cher petit être… À bientôt, mon doux petit mari… J’embrasse tout votre cher petit visage… Au revoir, petit être bien-aimé… Je vous embrasse, mon doux petit… Je vous embrasse tout passionnément, tout petit charme, petit tout charme petit charme tout… Ma chère petite âme… Je vous aime, mon petit… »
Sartre n’étant pas grand, « votre charmante Castor » — ainsi signait-elle ses lettres — ne se moquait pas de sa taille. Ses « petit », tous très affectueux, s’inscrivaient sur le même registre sentimental que les « petit cœur », « petit canard », « petit poussin », « petit bandit », etc., du populaire.
Ce « petit » amoureux et intime est-il utilisé pour des hommes et des femmes de haute futaie ? Yvonne de Gaulle a-t-elle appelé son grand Charles « mon petit lieutenant » ou « mon petit oiseau » ? Patrick Modiano a-t-il reçu dans sa jeunesse des « mon petit chat » ou des « mon petit corsaire » ? Je ne le crois pas. À partir de quelle taille le langage amoureux renonce-t-il au cher « petit » ?
Avec mes 170 centimètres — 1,69 mètre sur mon livret militaire, j’étais fou de rage —, j’ai eu droit à ma ration de « petit ». Mon préféré : « petit nuage ». Il est en effet sage de mêler la météorologie à l’amour.
La double faute d’Ezra Pound
Avenue Raymond-Poincaré, tout au fond de l’appartement du général Hallier, père de Jean-Edern Hallier, se dressait une grande ombre à barbe blanche devant laquelle des intellectuels et des journalistes venaient s’incliner. On échangeait quelques mots en anglais, parfois en français, puis on se retirait souvent en reculant, comme face à la reine d’Angleterre. Ce spectre impressionnant, cette icône fragile et vieillie, c’était le poète américain Ezra Pound.
Il puait le soufre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la radio italienne il avait fait l’éloge du fascisme tandis qu’il rendait les capitalistes juifs new-yorkais responsables du déclenchement des fureurs qui embrasaient le monde. Pour éviter de le juger, il fut décidé qu’il était fou. Les Américains l’enfermèrent pendant treize ans dans un hôpital psychiatrique avant de le rendre à l’Italie.
En 1965, Ezra Pound était à Paris pour la sortie d’un Cahier de l’Herne qui lui était consacré. Son auteur, Dominique de Roux, passant outre à l’indignité dont l’homme était frappé, admirait sincèrement la poésie épique et savante de ses Cantos ainsi que la phénoménale culture de l’écrivain. Il n’était pas mécontent non plus, aidé de Jean-Edern Hallier, d’organiser en son honneur une petite fête qui, vingt ans après la fin de la guerre, rallumait des feux mal éteints.
C’est grâce à un autre écrivain américain, Frederic Prokosch, que m’est revenu en mémoire ce coquetèle bizarre au cours duquel j’avais longuement parlé avec le général André Hallier, que son fils interrompait souvent pour lui dire son affection et sa fierté de porter son nom.
Invité à Apostrophes en 1984 pour ses mémoires Voix dans la nuit , Frederic Prokosch était de ces écrivains américains qui parlaient toutes les langues, en particulier le français, et qui avaient fait du cosmopolitisme leur oxygène. En 1935, Les Asiatiques , son premier roman, lui apporta une gloire immédiate et universelle. Lit-on encore cette œuvre célébrée par André Gide, Thomas Mann, Albert Camus ? Frederic Prokosch vivait dans le sud de la France d’où je le fis venir pour une conversation qui se révéla aussi pétillante et savoureuse que ses mémoires. Quel écrivain de l’entre-deux-guerres n’avait-il pas connu ? James Joyce, Thomas Mann, Virginia Woolf, Colette, Vladimir Nabokov (ils avaient une passion commune pour les papillons), Alberto Moravia, Somerset Maugham, etc. Et Ezra Pound.
Читать дальше