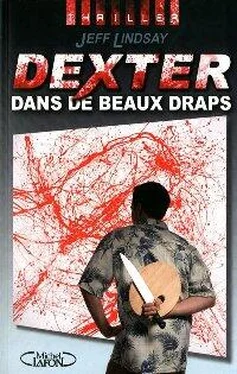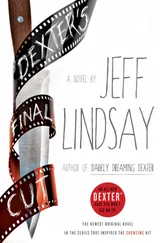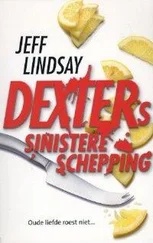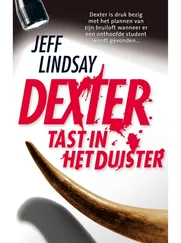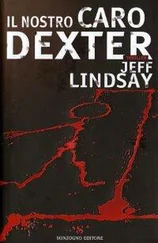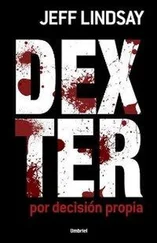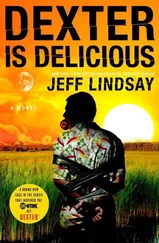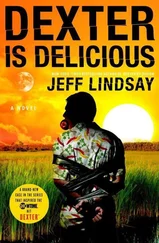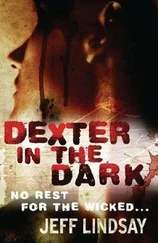Nous débarquons sur un escalier roulant et traversons le tarmac pour gagner le bâtiment, dont l’intérieur est tout aussi accueillant. Des moustachus en uniforme à l’air sévères montent la garde, la main posée sur une mitraillette, et scrutent tout le monde. Curieux contraste, plusieurs écrans de télévision suspendus au plafond diffusent une sorte de sitcom cubaine dont les rires préenregistrés font de l’équivalent américain une veillée funèbre. Toutes les deux minutes, un acteur beugle une phrase incompréhensible accueillie par une fanfare et un déluge de rires.
Nous attendons dans une file qui avance lentement vers une guérite. Je ne vois pas l’autre côté, et rien ne nous dit qu’on n’est pas en train de nous trier avant de nous embarquer dans des fourgons à bestiaux pour un goulag ; mais, puisque Chutsky n’a pas l’air de trop s’inquiéter, il serait malvenu que je me plaigne.
La file avance tel un escargot et un peu plus tard, sans me dire quoi que ce soit, Chutsky arrive devant le guichet et passe son passeport par une ouverture. Je ne vois ni n’entends ce qui se dit, mais il n’y a pas de hurlements ni de coups de feu, et peu après il récupère ses papiers, disparaît de l’autre côté : c’est mon tour.
Derrière l’épaisse vitre est assis un type qui pourrait être le jumeau du soldat voisin. Il prend mon passeport sans un mot, l’ouvre, l’examine, lève les yeux vers moi, puis me le rend sans un mot. Je m’attendais à quelques questions – peut-être à ce qu’il se lève et m’accuse d’être un chien féroce du capitalisme ou même un tigre de papier –, je suis si surpris que je reste interdit. Le type me fait signe de continuer d’un coup de menton, j’obéis et retrouve Chutsky à la livraison des bagages.
— Alors, mon pote, fait Chutsky depuis son poste devant le tapis roulant immobile qui, j’espère, va nous rendre nos valises, t’as pas eu peur, hein ?
— C’est vrai que je pensais que ce serait un peu plus difficile, admets-je. Enfin, ils ne sont pas censés nous haïr ou quelque chose de ce genre ?
— Je crois que tu vas te rendre compte que tu es très apprécié, dit-il en riant. C’est juste ton gouvernement, qu’ils supportent pas.
— Ils arrivent à faire la distinction ?
— Bien sûr. C’est de la simple logique cubaine.
Et si absurde que cela paraisse, ayant grandi à Miami, je sais pertinemment de quoi il s’agit : la logique cubaine est une blague récurrente de la communauté cubaine qui devance, dans le spectre affectif, le fait d’être cubanaso . La meilleure explication m’en a été fournie par un professeur d’université. J’avais choisi un cours de poésie dans le vain espoir d’en apprendre un peu plus sur l’âme humaine, étant donné que je n’en ai pas. Et le professeur nous avait lu un poème de Walt Whitman dont je me rappelle le début, tellement il était humain : « Est-ce que je me contredis ? Très bien alors, je me contredis, (Je suis vaste, je contiens des multitudes). » Et le professeur avait levé les yeux de son livre pour déclarer : « Parfaite logique cubaine », et avait attendu que les rires s’éteignent avant de reprendre sa lecture.
Donc, si les Cubains détestent l’Amérique mais aiment bien les Américains, cela ne mérite pas une de mes acrobaties mentales quotidiennes. Quoi qu’il en soit, un fracas métallique retentit, une sirène se déclenche, et les bagages commencent à arriver sur le tapis roulant. Nous n’avons pas grand-chose, juste un petit sac chacun – des chaussettes de rechange et une dizaine de bibles – que nous récupérons avant de passer devant une employée des douanes, visiblement plus intéressée à baratiner son collègue qu’à nous prendre en flagrant délit de contrebande d’armes ou de portefeuilles d’actions. Elle jette à peine un regard à nos sacs et nous fait signe de passer, sans interrompre une seconde son monologue étourdissant. Et nous voici libres, sur un trottoir inondé de soleil. Chutsky siffle un taxi, une Mercedes grise, et un homme en livrée grise et casquette assortie en descend pour prendre nos bagages et les mettre dans le coffre.
— Hotel Nacional, annonce Chutsky.
L’autoroute qui mène à La Havane est criblée de nids-de-poule, quasiment déserte. Jusqu’au bout, nous ne voyons que quelques taxis, deux, trois motos et des camions de l’armée qui roulent à faible allure, rien d’autre. Mais, en ville, les rues explosent littéralement de vie, débordant de vieilles voitures, de vélos, de flots de passants sur les trottoirs, ainsi que d’étranges bus tirés par des camions Diesel. Ils sont deux fois plus longs que les nôtres, en forme de M, avec les deux extrémités qui remontent, tandis que le milieu redescend en pente vers une portion plate et plus basse. Ils sont tellement bondés qu’il paraît impossible d’embarquer d’autres passagers, mais j’en vois un qui s’arrête et un groupe de gens y monter.
— Des chameaux, dit Chutsky.
— Pardon ? demandé-je, interloqué.
— On les appelle des chameaux, dit-il en désignant le bus. On te dira que c’est à cause de la forme, mais pour moi c’est plutôt à cause de l’odeur à l’heure de pointe. Tu as quatre cents personnes là-dedans qui rentrent du boulot, sans clim’, avec des fenêtres qui s’ouvrent pas. Incroyable.
C’est une information fascinante, du moins aux yeux de Chutsky, car il n’a pas grand-chose de plus à m’apprendre alors que nous traversons une ville qui m’est inconnue. Mais ses velléités de guide l’ont abandonné, et nous arrivons sur un large boulevard qui longe la mer. Sur les hauteurs, de l’autre côté du port, j’aperçois un vieux phare et quelques fortifications et, au-delà, un panache de fumée noire qui monte dans le ciel. La chaussée et la mer sont séparées par un large trottoir et un muret. Les vagues qui s’y fracassent font jaillir des gerbes d’embruns, mais personne n’a l’air de s’inquiéter de se faire un peu mouiller. Il y a plein de gens assis, debout, allongés, qui se promènent, qui pèchent ou qui s’embrassent sur ce muret. Nous passons devant une sculpture à la forme un peu tourmentée, enjambons un trottoir et remontons à gauche une petite éminence. Nous arrivons devant le Nacional, avec sa façade qui doit bientôt s’orner du visage narquois de Dexter – sauf si nous trouvons Weiss avant.
Le taxi s’arrête devant un grandiose escalier de marbre. Un portier vêtu comme un amiral italien s’avance, frappe dans ses mains, et un groom en livrée se précipite pour prendre nos sacs.
— On y est, dit un peu inutilement Chutsky.
L’amiral ouvre la portière, et Chutsky descend. J’ai le droit d’ouvrir la mienne, car je suis de l’autre côté, et je descends dans une marée de sourires obligeants. Chutsky paie la course, et nous suivons le groom.
Le hall a l’air sculpté dans le même bloc de marbre que l’escalier. Il est un peu étroit mais s’étend tout en longueur dans un lointain brumeux. Le groom nous conduit à la réception, derrière un ensemble de confortables fauteuils délimités par un cordon rouge, et le réceptionniste a l’air ravi de nous voir.
— Señor Freeney, dit-il en s’inclinant avec empressement. C’est un plaisir de vous revoir. Vous n’êtes tout de même pas venu pour le festival d’art ?
Il a moins d’accent que la plupart des gens à Miami et Chutsky, qui a l’air tout aussi ravi de le voir, lui serre la main par-dessus le comptoir.
— Comment ça va, Rogelio ? Content de vous voir. Je suis venu pour former un nouveau. (Il pose une main sur mon épaule et me pousse, comme un gamin boudeur qu’on oblige à faire un bisou à la grand-mère.) Je vous présente David Marcey, l’un de nos futurs meilleurs éléments. Il fait de sacrés sermons.
Читать дальше