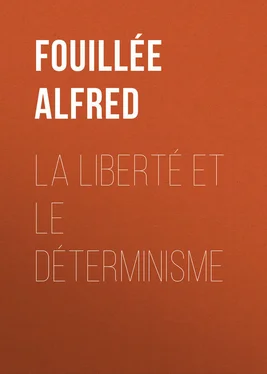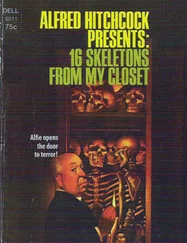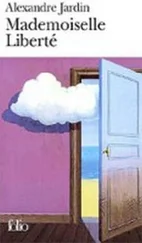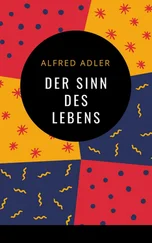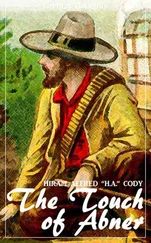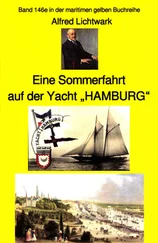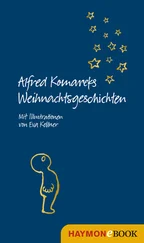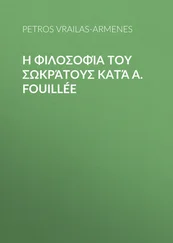Logique , II, 559.
A cette transformation du droit par l'introduction de l'idée de liberté nous avons consacré un ouvrage entier: l' Idée moderne du droit , 2e édition.
Voir notre Idée moderne du droit , 2e édit., livre III.
Voir, sur ce point, notre Critique des systèmes de morale contemporains .
Emotions and Will , p. 297.
«Ceux qui ont étudié, dit-il, les écrits des psychologues associationnistes ont vu, avec défaveur, que dans leurs expositions analytiques il y avait une absence presque totale d'éléments actifs ou de spontanéité appartenant à l'esprit lui-même… Cette apparence de passivité absolue a contribué à aliéner de la théorie de l'association de bons esprits qui l'avaient réellement étudiée (tels que Coleridge)… En France, on a souvent cité le progrès qui se fit de Condillac à Laromiguière: le premier faisant d'un phénomène passif, la sensation, la base de son système; le second y substituant un phénomène actif, l'attention. La théorie de M. Bain est dans le même rapport avec la théorie de Hartley que celle de Laromiguière avec celle de Condillac.» ( Dissertations et discussions , t. III, 197-152, article Bain).
Premiers principes , p. 162.
Philosophie de Hamilton , p. 551.
Première partie , chap. premier. PREMIÈRE PARTIE RECHERCHE D'UNE CONCILIATION PRATIQUE ET DE SES LIMITES
Emotions and Will , p. 509.
Philosophie de Hamilton , tr. Cazelles, p. 250, 252.
Premiers principes , p. 68.
p. 544.
Raison pure , t. II, p. 13.
Voir M. Taine, l' Intelligence , II, p. 191.
Voir Taine, l' Intelligence , II, p. 199.
Voir, sur ce point et sur le caractère de la conscience, notre chapitre relatif à la conscience sociale dans la Science sociale contemporaine .
Raison pure , II, p. 11.
«Les spiritualistes, avons-nous dit ailleurs ( Critique des systèmes de morale , p. 287), distinguent entre la création complète de soi-même, qui est l'existence absolue, et la création de ses actes, qu'on nomme liberté; ils supposent donc que nous avons reçu l'être nécessairement, mais que nous donnons l'être librement à nos volitions. Selon nous, si on examinait la chose avec plus d'attention, on reconnaîtrait qu'elle est contradictoire. S'il y a en moi une nature toute faite que j'ai reçue, une existence dont je ne suis pas la cause, il y a par cela même en moi un fond déterminé, nécessité, impénétrable à ma conscience parce qu'il n'est pas le résultat de mon action consciente. Dès lors, je pourrai toujours me demander si l'action qui paraît venir de ma conscience ne vient pas de ce fond inconscient, si je ne suis pas en réalité, comme dit Plotin, «esclave de mon essence,» c'est-à-dire de la nature propre et de l'existence que j'ai reçues de mon créateur. Par conséquent, pour être certain d'être libre, il faudrait que je fusse entièrement l'auteur de moi-même, de mon être comme de mes manières d'être et que j'en eusse l'entière conscience a priori . En d'autres termes, il faudrait que j'eusse l'existence absolue comme la conscience absolue, il faudrait que je fusse Dieu. Si les spiritualistes veulent bien approfondir la notion de la vraie liberté, ils verront qu'elle aboutit à cette conséquence, qui, pour n'en avoir point encore été ouvertement déduite, n'en est pas moins nécessaire…» «Qu'il y ait en nous une existence reçue d'ailleurs et par cela même inconsciente, la volonté, qui ne sera plus qu'une détermination superficielle de cette existence, ne pourra plus être consciente et sûre de sa liberté, c'est-à-dire de son indépendance par rapport à tous les autres êtres de l'univers.»