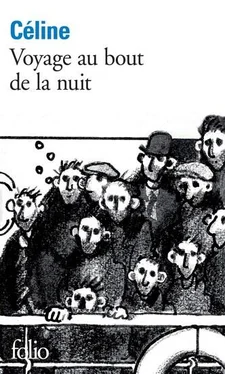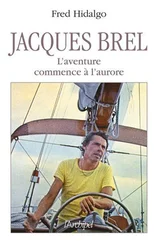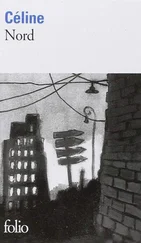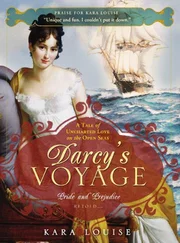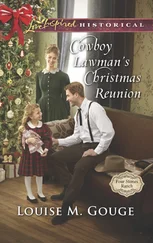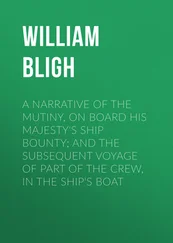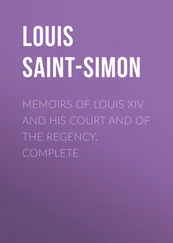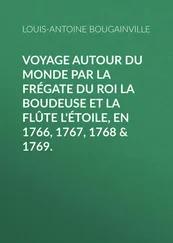Elle a même pas voulu que je me retourne pour aller le regarder une fois encore le cadavre. Je suis parti donc, sans me retourner. « Fermez la porte » qu'était écrit. Parapine avait soif encore. De parler sans doute. De trop parler pour lui. En passant devant la buvette du canal, nous cognâmes au volet pendant un bon moment. Ça me faisait souvenir de la route de Noirceur pendant la guerre. La même petite lueur au-dessus de la porte prête à s'éteindre. Enfin, le patron est venu, en personne, pour nous ouvrir. Il n'était pas au courant. C'est nous qui lui avons tout appris et la nouvelle du drame avec. « Un drame d'amour » qu'il appelait ça Gustave.
Le zinc du canal ouvrait juste avant le petit jour à cause des bateliers. L'écluse commence à pivoter lentement sur la fin de la nuit. Et puis c'est tout le paysage qui se ranime et se met à travailler. Les berges se séparent du fleuve tout doucement, elles se lèvent, se relèvent des deux côtés de l'eau. Le boulot émerge de l'ombre. On recommence à tout voir, tout simple, tout dur. Les treuils ici, les palissades aux chantiers là-bas et loin dessus la route voici que reviennent de plus loin encore les hommes. Ils s'infiltrent dans le jour sale par petits paquets transis. Ils se mettent du jour plein la figure pour commencer en passant devant l'aurore. Ils vont plus loin. On ne voit bien d'eux que leurs figures pâles et simples ; le reste est encore à la nuit. Il faudra bien qu'ils crèvent tous un jour aussi. Comment qu'ils feront ?
Ils montent vers le pont. Après, ils disparaissent peu à peu dans la plaine et il en vient toujours des autres, des hommes, des plus pâles encore, à mesure que le jour monte de partout. À quoi qu'ils pensent ?
Le bistrot voulait tout connaître du drame, des circonstances, qu'on lui raconte tout.
Vaudescal, qu'il s'appelait le patron, un gars du Nord bien propre.
Gustave lui en a raconté alors tant et plus.
Il nous rabâchait les circonstances Gustave, c'était pas ça pourtant qui était important ; on se reperdait déjà dans les mots. Et puis, comme il était soûl, il recommençait. Seulement là vraiment il n'avait plus rien à dire, rien. Je l'aurais bien écouté quand même encore un peu, tout doucement, comme un sommeil, mais alors, voilà les autres qui le contestent et ça le met fort en colère.
De fureur, il s'en va cogner un grand coup dans le petit poêle. Tout s'écroule, tout se renverse : le tuyau, la grille et les charbons en flammes. Il était costaud, Mandamour, comme quatre.
Il s'est mis, en plus, à vouloir nous montrer la véritable danse du Feu ! Enlever ses chaussures et bondir en plein dans les tisons.
Avec le patron, ils avaient eu ensemble une histoire de « machine à sous » pas poinçonnée… C'était un sournois, Vaudescal ; il fallait s'en méfier, avec des chemises toujours bien trop propres pour qu'il soye tout à fait honnête. Un rancunier et un mouchard. Y en a plein les quais.
Parapine s'est douté qu'il le cherchait Mandamour, pour le faire révoquer, profitant qu'il avait bu.
Il l'a empêché, lui, de la faire, sa danse du Feu et il lui a fait honte. On l'a repoussé Mandamour tout au bout de la table. Il s'est écroulé là, finalement, bien sage, parmi les soupirs énormes et les odeurs. Il a dormi.
De loin, le remorqueur a sifflé ; son appel a passé le pont, encore une arche, une autre, l'écluse, un autre pont, loin, plus loin… Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve toutes, et la ville entière, et le ciel et la campagne, et nous, tout qu'il emmenait, la Seine aussi, tout, qu'on n'en parle plus.
FIN
Elizabeth Craig (1902–1989), danseuse américaine que Céline avait connue à Genève en 1926, et avec laquelle il vécut, à Paris, jusqu’en 1933.
Chanson des Gardes Suisses, 1793 : couvre d’officiers d’un régiment suisse allemand de l’armée napoléonienne. Sur le point de mourir, ils la chantèrent devant la Berezina. C’était pendant la retraite de Russie, en 1812. Il ne s’agit donc pas des Gardes suisses de la maison du roi de France sous l’Ancien Régime, qui furent massacrés lors de la bataille des Tuileries, en 1792.
Le Temps. Ce journal, l’équivalent de l’actuel Monde, n’avait pas les positions racistes et réactionnaires que lui prête Arthur Ganate.
Bélisaire : général byzantin, victime, après avoir sauvé Constantinople d’une sédition, de l’ingratitude de l’empereur.
L’Alhambra : grande salle de music-hall.
Fragson : un des grands du music-hall du début du siècle.
Le pont Rouge : Pont-Rouge, lieu-dit des environs d’Armentières, par où était passé le 12 0régiment de cuirassiers auquel appartenait Céline.
Le Mayflower : bateau qui transporta les Anglais qui s’établirent pour la première fois en Amérique du Nord en 1620. Ils ne débarquèrent pas à Boston, mais à Plymouth…
Le Petit Journal : journal raciste et réactionnaire de grande diffusion avant la guerre.
Duval : il existait de nombreux « Bouillons Duval » où l’on mangeait correctement pour un prix peu élevé.
« … commence une époque nouvelle… » : citation, transformée, extraite de Campagne de France.
La cavalière Eisa : roman de Pierre Mac Oran (1921), qui fut aussi librement adapté au théâtre.
Dupré : ce pourrait être le psychiatre Ernest Dupré.
Un plan du Nord-Sud : plan de la ligne de métro mise en service de Montmartre à Montparnasse.
Papagaïes : pour papegais ou papegeais, ancien nom des perroquets.
Le Chabanais : célèbre maison close située au 12 de la me du même nom.
Véra : Vera Stern, directrice d’un théâtre à New York, est un personnage de la pièce de Céline L’Église (où son théâtre se nomme le Quick Theatre).
Le coin de la Révolte : ce n’est pas tout à fait « le boulevard de la Révolte » (p. 291), mais « la route de la Révolte » sur la partie de son parcours qui traversait Clichy, elle correspondait aux boulevards de Douaumont et Victor-Hugo.
L’hospice : de Saint-Vincent-de-Paul.
L’Institut Bioduret : travestissement de l’Institut Pasteur. Le siège de l’Institut Pasteur se trouve dans le XVe arrondissement.
Eberthiens : le bacille d’Eberth, germe de la typhoïde, fut découvert en 188 ! par Karl Eherth.
Le château : c’est-à-dire le Louvre.
Disait le Montaigne : on trouvera le texte original de cette lettre dans l’édition de la Pléiade.
L’octroi : l’octroi de la porte de Clichy disparut en 1918.
Le cimetière, un autre encore, à côté : le cimetière Montmartre, et le cimetière parisien des Batignolles.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу