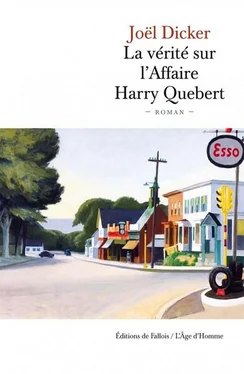Le jour de la course, tout Felton ainsi que la moitié de mon quartier étaient là pour m’acclamer. Le départ fut donné et, comme je le craignais, je me fis immédiatement distancer par tous les autres coureurs. Le moment était crucial : ma réputation était en jeu. C’était une course de six miles, soit vingt-cinq tours de stade. Vingt-cinq humiliations. J’allais finir dernier, battu et déshonoré. Peut-être même doublé par le premier. Je devais sauver le Formidable à tout prix. Je réunis alors toutes mes forces, toute mon énergie, et dans un élan désespéré, je me lançai dans un sprint fou : sous les vivats de la foule acquise à ma cause, je pris la tête de la course. C’est à ce moment que je recourus au plan machiavélique que j’avais échafaudé : étant provisoirement premier de la compétition et sentant que j’avais atteint mes limites, je fis mine de me prendre les pieds dans le sol et je me jetai par terre, avec roulés-boulés spectaculaires, hurlements, cris de la foule et au final, pour moi, une jambe cassée, ce qui n’était certes pas prévu mais qui, au prix d’une opération et de deux semaines d’hôpital, sauva la grandeur de mon nom. Et la semaine suivant cet incident, le journal du lycée écrivit à mon sujet :
Durant cette course d’anthologie, Marcus Goldman dit « le Formidable », alors qu’il dominait largement ses adversaires et qu’il était promis à une écrasante victoire, a été victime de la mauvaise qualité de la piste : il a lourdement chuté et s’est cassé une jambe.
Ce fut la fin de ma carrière de coureur et de ma carrière de sportif : pour cause de blessure grave, je fus dispensé de sport jusqu’à la fin du lycée. Pour mon engagement et mon sacrifice, j’eus droit à une plaque à mon nom dans la vitrine des honneurs, où trônait déjà mon maillot de crosse. Quant au principal, maudissant la mauvaise qualité des installations de Felton, il fit refaire à grands frais tout le revêtement de la piste du stade, finançant les travaux en puisant dans le budget des sorties du lycée, privant ainsi les élèves de toutes les classes de la moindre activité durant l’année qui suivit.
Au terme de mes années de lycée, bardé de bonnes notes, de diplômes de mérite et de lettres de recommandation, il me fallut faire le choix fatidique de l’université. Et lorsque, une après-midi, je me retrouvai dans ma chambre, allongé sur mon lit, avec devant moi trois lettres d’acceptation, l’une de Harvard, l’autre de Yale et la troisième de Burrows, petite université inconnue du Massachusetts, je n’hésitai pas : je voulais Burrows. Aller dans une grande université, c’était risquer de perdre mon étiquette de « Formidable ». Harvard ou Yale, c’était mettre la barre trop haut : je n’avais aucune envie d’affronter les élites insatiables venues des quatre coins du pays et qui parasiteraient les tableaux d’honneur. Les tableaux d’honneur de Burrows me semblaient beaucoup plus accessibles. Le Formidable ne voulait pas se brûler les ailes. Le Formidable voulait rester le Formidable. Burrows, c’était parfait : un campus modeste où j’aurais la certitude de briller. Je n’eus pas de peine à convaincre mes parents que le département de lettres de Burrows était en tous points supérieur à celui de Harvard et de Yale, et voici comment, à l’automne 1998, je débarquai de Newark dans cette petite ville industrielle du Massachusetts où j’allais faire la rencontre de Harry Quebert.
En début de soirée, alors que j’étais toujours sur la terrasse à regarder les albums et à ressasser les souvenirs, je reçus un appel de Douglas, catastrophé.
— Marcus, nom de Dieu ! Je peux pas croire que tu sois allé dans le New Hampshire sans m’en avertir ! J’ai reçu des appels de journalistes me demandant ce que tu faisais là-bas, et je n’étais même pas au courant. J’ai dû allumer ma télévision pour l’apprendre. Rentre à New York. Rentre pendant qu’il en est temps. Cette histoire va te dépasser complètement ! Tire-toi de ce bled à la première heure demain et rentre à New York. Quebert a un excellent avocat. Laisse-le faire son travail et concentre-toi sur ton livre. Tu dois rendre ton manuscrit à Barnaski dans quinze jours.
— Harry a besoin d’un ami à ses côtés, dis-je.
Il y eut un silence et Douglas murmura, comme s’il ne réalisait que maintenant ce qui lui échappait depuis des mois :
— Tu n’as pas de livre, hein ? On est à deux semaines du délai de Barnaski et tu n’as pas été foutu d’écrire ce putain de livre ! C’est ça, Marc ? Est-ce que tu vas aider un ami ou est-ce que tu fuis New York ?
— La ferme, Doug.
Il y eut un autre long silence.
— Marc, dis-moi que tu as une idée en tête. Dis-moi que tu as un plan et qu’il y a une bonne raison pour que tu ailles dans le New Hampshire.
— Une bonne raison ? L’amitié, n’est-ce pas suffisant ?
— Mais bon sang, qu’est-ce que tu lui dois, à Harry, pour aller là-bas ?
— Tout, absolument tout.
— Comment ça, tout ?
— C’est compliqué, Douglas.
— Marcus, qu’est-ce que tu essaies de me dire, bon sang ?
— Doug, il y a un épisode de ma vie que je ne t’ai jamais raconté… Au sortir de mes années de lycée, j’aurais certainement pu mal tourner. Et puis j’ai rencontré Harry… Il m’a en quelque sorte sauvé la vie. J’ai une dette envers lui… Sans lui, je ne serais jamais devenu l’écrivain que je suis devenu. Ça s’est passé à Burrows, Massachusetts, en 1998. Je lui dois tout.
29.
Peut-on tomber amoureux d’une fille de quinze ans ?
“J’aimerais vous apprendre l’écriture, Marcus, non pas pour que vous sachiez écrire, mais pour que vous deveniez écrivain. Parce qu’écrire des livres, ce n’est pas rien : tout le monde sait écrire, mais tout le monde n’est pas écrivain.
— Et comment sait-on que l’on est écrivain, Harry ?
— Personne ne sait qu’il est écrivain. Ce sont les autres qui le lui disent.”
Tous ceux qui se souviennent de Nola diront qu’elle était une jeune fille merveilleuse. De celles qui marquent les esprits : douce et attentionnée, douée pour tout et rayonnante. Il paraît qu’elle avait cette joie de vivre sans pareille qui pouvait illuminer les pires jours de pluie. Les samedis, elle servait au Clark’s ; elle virevoltait entre les tables, légère, faisant danser dans les airs ses cheveux blonds et ondulés. Elle avait toujours un mot gentil pour chaque client. On ne voyait qu’elle. Nola, c’était un monde en soi.
Elle était la fille unique de David et Louisa Kellergan, des évangélistes du Sud originaires de Jackson, Alabama, où elle-même était née le 12 avril 1960. Les Kellergan s’étaient installés à Aurora, à l’automne 1969, après que le père avait été engagé comme pasteur par la paroisse St James, la principale communauté d’Aurora, qui connaissait une remarquable affluence à l’époque. Le temple de St James, situé à l’entrée sud de la ville, était un imposant édifice en planches dont il ne subsiste plus rien aujourd’hui, depuis que les communautés d’Aurora et de Montburry ont dû fusionner pour des raisons d’économies budgétaires et de manque de fidèles. À la place, on y trouve désormais un restaurant McDonald’s. Dès leur arrivée, les Kellergan avaient emménagé dans une jolie maison, propriété de la paroisse, située au 245 Terrace Avenue, bâtie sur un seul niveau : c’est vraisemblablement par la fenêtre de sa chambre que, six ans plus tard, Nola allait s’évaporer dans la nature, le samedi 30 août 1975.
Ces descriptions furent parmi les premières que me firent les habitués du Clark’s, où je me rendis le lendemain matin de mon arrivée à Aurora. Je m’étais réveillé spontanément à l’aube, tourmenté par cette sensation désagréable de ne pas être vraiment certain de ce que je faisais ici. Après être allé faire mon jogging sur la plage, j’avais nourri les mouettes, et je m’étais alors posé la question de savoir si j’étais vraiment venu jusque dans le New Hampshire uniquement pour donner du pain à des oiseaux de mer. Je n’avais rendez-vous à Concord qu’à onze heures avec Benjamin Roth pour aller rendre visite à Harry ; dans l’intervalle, comme je ne voulais pas rester seul, j’étais allé manger des pancakes au Clark’s. Lorsque j’étais étudiant et que je séjournais chez lui, Harry avait pour coutume de m’y traîner aux premières heures du jour : il me réveillait avant l’aube, me secouant sans ménagement et en m’expliquant qu’il était temps d’enfiler mes vêtements de sport. Puis nous descendions au bord de l’océan, pour courir et boxer. S’il faiblissait un peu, il jouait les entraîneurs : il interrompait son effort soi-disant pour venir corriger mes gestes et mes positions, mais je sais qu’il avait surtout besoin de reprendre son souffle. Au fil des exercices et des foulées, nous parcourions les quelques miles de plage qui reliaient Goose Cove à Aurora. Nous remontions ensuite par les roches de Grand Beach et nous traversions la ville qui dormait encore. Dans la rue principale, plongée dans l’obscurité, on apercevait de loin la lumière crue qui jaillissait par la baie vitrée du diner, qui était le seul établissement à ouvrir de si bonne heure. À l’intérieur, régnait un calme absolu ; les rares clients étaient des routiers ou des commis qui avalaient leur petit déjeuner en silence. En arrière-fond sonore, on entendait la radio, toujours branchée sur une chaîne d’information et dont le volume, trop bas, empêchait de comprendre tous les mots du speaker. Les matins de grandes chaleurs, le ventilateur suspendu battait l’air dans un grincement métallique, faisant danser la poussière autour des lampes. Nous nous installions à la table 17, et Jenny arrivait aussitôt pour nous servir du café. Elle avait toujours pour moi un sourire d’une douceur presque maternelle. Elle me disait : « Mon pauvre Marcus, il te force à te lever à l’aube, hein ? Depuis que je le connais, il fait ça. » Et nous riions.
Читать дальше