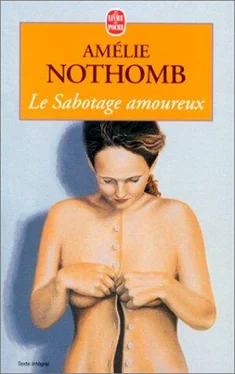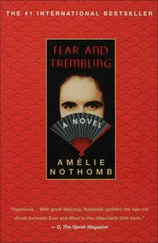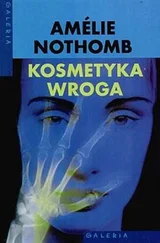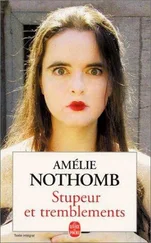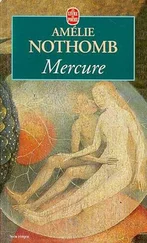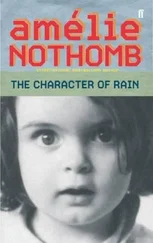A part cela, il y avait les marchés où, à cheval, j'allais acheter des caramels, des poissons rouges bigleux, de l'encre de Chine ou autres merveilles, mais où la communication se limitait à des échanges d'argent.
J'atteste que ce fut tout. En ces conditions, je ne puis que conclure ceci: cette histoire s'est passée en Chine autant qu'on le lui a permis – c'est-à-dire très peu.
C'est une histoire de ghetto. C'est donc le récit d'un double exil: exil par rapport à nos pays d'origine (pour moi le Japon, car j'étais persuadée d'être japonaise), et exil par rapport à la Chine qui nous entourait mais dont nous étions coupés, en vertu de notre qualité d'hôtes profondément indésirables.
Qu'on ne s'y trompe pas, en fin de compte: la Chine tient dans ces pages la même place que la peste noire dans Le Décaméron de Boccace; s'il n'en est presque pas fait mention, c'est parce qu'elle y sevit partout.
Elena ne m'avait jamais été accessible. Et depuis Fabrice, elle m'échappait de plus en plus.
Je ne savais plus quoi faire pour attirer son attention. Je fus tentée de lui parler des ventilateurs mais j'eus l'intuition qu'elle réagirait comme lors de l'affaire du cheval: elle hausserait les épaules et m'ignorerait.
Je bénissais le sort qui avait voulu que Fabrice vécût à Wai Jiao Ta Lu. Et je bénissais la mère de ma bien-aimée qui interdisait à ses enfants de mettre un pied hors de San Li Tun.
En effet, se rendre d'un ghetto à l'autre ne posait aucun problème. A vélo, cela prenait un quart d'heure. Je faisais souvent la navette parce qu'il y avait à Wai Jiao Ta Lu un magasin d'ignobles caramels chinois, cent pour cent bactéries, qui me semblaient les friandises les plus célestes du monde sublunaire.
Je remarquai qu'en trois mois de flirt, Fabrice n'était jamais venu à San Li Tun.
Ce constat m'inspira une idée que j'espérais cruelle. De retour de l'école, je demandai à la petite Italienne d'un ton détaché:
– Est-ce que Fabrice est amoureux de toi?
– Oui, répondit-elle avec indifférence, comme si cela allait de soi.
– Et toi, tu l'aimes?
– Je suis sa fiancée.
– Sa fiancée! Mais alors, tu dois le voir très souvent.
– Tous les jours, à l'école.
– Ah non, pas tous les jours. Pas le samedi et le dimanche.
Silence distant.
– Et le soir non plus, tu ne le vois pas. Pourtant, c'est surtout le soir que les fiancés doivent se voir. Pour aller au cinéma.
– Il n'y a pas de cinéma à San Li Tun.
– Il y a un cinéma à l'Alliance française, près de Wai Jiao Ta Lu.
– Mais maman ne me permet pas de sortir d'ici.
– Et pourquoi Fabrice ne vient pas te voir à San Li Tun?
Silence.
– A vélo, ça prend un quart d'heure. J'y vais tous les jours, moi.
– Maman dit que c'est dangereux de sortir.
– Et alors? Fabrice a peur? Je sors tous les jours, moi.
– Ses parents ne lui permettent pas.
– Et il obéit?
Silence.
– Je lui demanderai de venir me voir demain à San Li Tun. Tu verras, il le fera. Il fait tout ce que je lui demande.
– Ah non! S'il t'aime, il doit y penser tout seul. Sinon, ça n'a aucune valeur.
– Il m'aime.
– Alors, pourquoi il ne vient pas?
Silence.
– Peut-être que Fabrice a une autre fiancée à Wai Jiao Ta Lu, lançai-je à titre d'hypothèse.
Elena rit avec dédain.
– Les autres filles sont bien moins jolies que moi.
– Tu n'en sais rien. Elles ne vont pas toutes à l'Ecole française. Les Anglaises, par exemple.
– Les Anglaises! rit la petite Italienne, comme si ce simple énoncé écartait les soupçons.
– Eh bien quoi, les Anglaises? Il y a lady Godiva.
Elena me regarda avec des points d'interrogation dans les yeux. Et je lui expliquai que les Anglaises avaient pour habitude de se promener toutes nues, à cheval, vêtues de très longs cheveux.
– Mais il n'y a pas de chevaux dans les ghettos, dit-elle froidement.
– Si tu crois que c'est ça qui dérange les Anglaises.
Ma bien-aimée s'en fut d'un pas rapide. C'était la première fois que je la voyais marcher vite.
Son visage n'avait affiché aucune blessure, mais j'étais certaine d'avoir atteint au moins son orgueil, sinon un cœur dont l'existence ne me fut jamais attestée.
Je ressentis un triomphe éclatant.
Je ne sus rien de l'éventuelle bigamie de mon rival. Tout ce que je sus, c'est qu'Elena rompit ses fiançailles le lendemain. Elle le fit avec une indifférence exemplaire. Je fus très fière de son absence de sentiment.
Le prestige du séducteur à longs cheveux en prit un sacré coup.
Je jubilais.
Ce fut la seconde fois que je rendis grâce au communisme chinois.
A l'approche de l'hiver, la guerre s'intensifiait. En effet, quand les glaces auraient pris le ghetto, nous savions que nous serions tous réquisitionnés, volens nolens, pour faire sauter à coups de pioche les océans de verglas qui immobiliseraient les véhicules. Il fallait donc expectorer à l'avance notre quota d'agressivité.
Nous ne nous refusions rien. Nous étions particulièrement fiers de notre nouveau détachement que nous appelions «la cohorte des vomisseurs».
Nous avions découvert que certains d'entre nous possédaient une grâce d'élection: les fées qui s'étaient penchées sur leur berceau les avaient rendus capables de vomir presque à volonté.
Il suffisait que leur estomac fût lesté pour qu'il fût à même de se délester. Ces gens forçaient l'admiration. La plupart d'entre eux recouraient à la méthode classique du doigt enfoncé dans le gosier. Mais certains étaient beaucoup plus impressionnants: ils s'exécutaient par le seul pouvoir de leur volonté. Par une extraordinaire pénétration spirituelle, ils avaient accès aux centres émétiques du cerveau: ils se concentraient un peu et le tour était joué.
L'entretien de la cohorte des vomisseurs évoquait celui de certains avions: il fallait pouvoir les ravitailler en vol. Nous avions bien compris que vomir à vide n'était pas rationnel.
Les plus inutiles d'entre nous furent donc préposés au carburant émétique: ils devaient dérober aux cuisiniers chinois de la nourriture facile à manger. Les adultes eurent à constater d'importantes disparitions de petits-beurre, de raisins secs, de Vache qui rit, de lait concentré sucré, de chocolat et surtout d'huile et de café soluble – car nous avions découvert îa pierre philosophale du vomi: un mélange d'huile de salade et de café soluble. C'était ce qui ressortait le plus vite.
(Détail émouvant: aucune des denrées précitées n'était disponible à Pékin. Tous les trois mois, nos parents devaient aller à Hong Kong pour le ravitaillement. Ces voyages leur coûtaient cher. Nous vomissions donc pour beaucoup d'argent.)
Le critère était le poids: les produits devaient être légers à transporter, ce qui éliminait d'emblée tous les aliments en bocaux de verre. Ceux qui véhiculaient tant de nourriture étaient appelés les «réservoirs». Un vomisseur devait toujours être escorté d'au moins un réservoir. De belles amitiés pouvaient naître de ces relations complémentaires.
Pour les Allemands, il n'y avait pas de torture plus terrible. Les immersions dans l'arme secrète les faisaient souvent pleurer, mais avec dignité. Le dégueulis avait raison de leur honneur: ils hurlaient d'horreur dès que la substance les touchait, comme s'il s'était agi d'acide sulfurique. Un jour, l'un d'entre eux fut tellement dégoûté de cette aspersion qu'il vomit lui-même, pour notre plus grande joie.
Certes, la santé des vomisseurs se détraquait très vite. Mais ce sacerdoce leur valait tant de louanges de notre part qu'ils acceptaient le préjudice physique avec sérénité.
Читать дальше