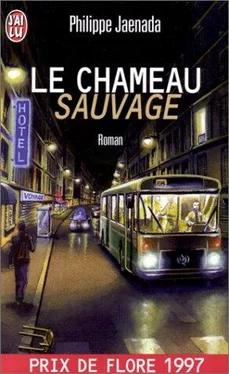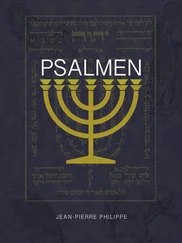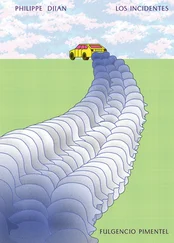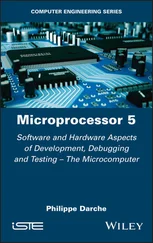«Ne t'inquiète pas.»
J'ai fixé son visage immobile et si placide, imperturbable, pendant de longues secondes, en me répétant que ça devait arriver un jour ou l'autre, puis je suis sorti m'asseoir sur un rocher. Après tout, malade mental, ça ne changeait pas grand-chose.
Avant de revenir au bateau, je suis allé marcher dans le souk. Entre toutes ces petites boutiques, ces lumières, ces couleurs, ces odeurs, ces épices, ces étoffes et ces parfums, j'ai repensé à Diortown, où j'avais bu du vin avec Pollux lors de notre première journée ensemble. Je me promenais à présent dans le décor initial, dans l'original. Même si tous ces étals étaient destinés aux touristes comme moi, je le savais bien, je me sentais en territoire ami. À chaque pas, des marchands m'attrapaient par le coude, me débitaient deux ou trois phrases en français apprises par cœur et tentaient de m'entraîner à l'intérieur de leurs boutiques. Ils se montraient aussi envahissants et pénibles que tous les marchands du monde, mais dès qu'ils s'apercevaient que je n'étais pas intéressé, dès qu'ils avaient la certitude qu'ils ne me soutireraient pas une livre, ils se métamorphosaient: leur visage devenait plus naturellement souriant, ils se mettaient à plaisanter, me posaient des questions, m'offraient même parfois du thé. Ils se trouvaient en face d'un salopard de touriste français qui vient trimbaler ses fesses chez eux et les observer comme des animaux à Thoiry mais refuse de lâcher ses précieux billets (qu'est-ce que j'aurais fait d'un châle en soie ou d'un sac de safran, moi? – c'était du faux safran, d'ailleurs, m'a dit un épicier), ils venaient de rater une affaire, mais ils prenaient tout de même le temps de parler et de rire, comme si les problèmes de l'existence, c'était «autre chose». (Ils savaient probablement qu'ils réussiraient à plumer le prochain pigeon qui passerait devant chez eux, sa colombe au bras (l'un d'eux m'a expliqué qu'il vendait la plupart de ses articles à un prix quatre ou cinq fois supérieur à celui que paierait un client avisé), mais rien ne les aurait empêchés de m'ignorer ou même de me chasser pour mettre la main plus rapidement sur un autre passant. Quel intérêt ou quel plaisir pouvaient-ils bien trouver à discuter avec moi?) Ils me fascinaient. Ils m'intriguaient.
À la tombée de la nuit, je buvais un whisky dans le bar Art déco du Winter Palace, un hôtel somptueux situé près du port où se trouvait notre bateau. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'essaie de ne pas m'inquiéter depuis deux ans, depuis que la notion de souci m'est apparue, mais rien n'y fait. Je m'inquiète toujours. C'est plus fort que moi, je n'arrive pas à rester calme en pensant que je vais peut-être me faire attaquer par quelqu'un, être victime d'une erreur judiciaire, tomber dans un gouffre ou perdre ceux que j'aime. Ne t'inquiète pas. C'est facile à dire.
Dans la nuit, notre bateau a enfin quitté Louqsor et entamé sa remontée du Nil vers le sud. À partir de maintenant, je ne pouvais plus m'enfuir. J'étais pris en charge, emporté, guidé, je devais aller jusqu'au bout.
Le lendemain matin au réveil, j'ai regardé par la fenêtre de ma cabine. La berge défilait lentement, à cent ou deux cents mètres du bateau, luxuriante, gonflée de verdure et d'humidité, d'eucalyptus, de palmiers. De temps à autre, on apercevait un petit village de maisons en terre, carrées et basses, des ânes, des oiseaux, des silhouettes humaines, lentes et gracieuses, enveloppées de tissu clair. Au-delà de cet étroit couloir de vie, le désert s'étendait à perte de vue. J'ai ouvert la fenêtre, encore endormi, je me suis accoudé sur le rebord, et j'ai dû rester plus d'une demi-heure à contempler ce paysage étrange, l'eau, puis la végétation, puis le sable, ces gens qui travaillaient sans se presser entre le fleuve et le désert, depuis cinq ou six mille ans, certainement résignés à ne vivre que sur une bande de terre cultivable, mais malgré tout, certainement reconnaissants envers le Nil, qui semblait déborder sur le désert pour répandre ses bienfaits vers eux, leur faire profiter de sa puissance et de sa richesse. Pâle et ébouriffé, les yeux gonflés, les tempes encore douloureuses, je me laissais progressivement pénétrer par un sentiment de bien-être profond et surprenant, que je ne comprenais pas. Je me suis traîné jusqu'à la douche.
Je passais mes journées sur le pont supérieur du bateau, à boire du café ou du thé, des jus de fruits ou de la bière quand le soleil m'écrasait, et à admirer, de chaque côté, ces lisières verdoyantes qui m'avaient si fortement troublé le premier matin de la croisière. Les autres passagers du bateau n'existaient plus pour moi, je ne les voyais plus, ne les entendais plus, et le bateau lui-même disparaissait peu à peu sous moi, autour de moi. Je flottais seul entre les rives du Nil. Je m'imaginais en observateur invisible et privilégié qui traverserait l'existence des hommes sur une sorte de voie parallèle, inaccessible, un chemin secret réservé à cet usage, le Nil. Je passais entre la vie, je voyais tout mais personne ne me voyait, je pouvais réfléchir et chercher tranquillement à percer le mystère que recelaient ces berges, sans craindre que personne vienne m'attaquer. Il aurait fallu nager jusqu'à moi. Je me sentais protégé.
Chaque jour, nous nous arrêtions quelque part (Esna, Edfou, Kom Ombo), j'essayais de m'éloigner du groupe, je prenais des calèches bringuebalantes et délicieusement kitsch, rapiécées de partout, pleines de loupiotes et d'images religieuses, tirées par de vieux chevaux philosophes et conduites par des chauffards goguenards qui aimaient secouer le touriste. Nous passions à toute allure dans les rues claires et animées des petites villes, devant des cafés où tous les hommes fumaient le narghilé, des maisons aux fenêtres sans carreaux, dans lesquelles on devinait parfois une femme, puis j'allais me promener dans le calme des temples et le tumulte des souks (en inversant mes horaires de visites, lorsque c'était possible, je pouvais me promener dans le calme des souks et le tumulte des temples). Le soir même, le bateau repartait vers l'étape suivante.
Avant et après dîner, je m'installais pour boire quelques whiskies dans un fauteuil au bar du bateau, près des baies vitrées, entouré de Français ou d'Allemands bruyants, sous l'œil d'un barman amusé que je trouvais très sympathique. Dans un groupe de touristes bretons, j'ai repéré un couple de vieillards qui ne se lâchaient quasiment jamais la main, coulaient sans cesse des regards doux et attendris l'un vers l'autre, se touchaient mutuellement les genoux ou les épaules, comme pour s'assurer que l'autre était toujours là, échangeaient même de temps en temps de petits baisers flétris mais humides. Ça me dégoûtait. Au milieu des autres «seniors» du club des Hirondelles de Plougasnou, ils ressemblaient à deux mourants qui refuseraient obstinément d'avouer qu'ils ne sont plus adolescents, butés et tenaces, grotesques. Le troisième soir, en tendant l'oreille, j'ai appris qu'ils étaient veufs tous les deux et ne s'étaient rencontrés que quelques mois plus tôt, lors d'un tournoi inter-clubs de rami (les Myosotis d'Odette avaient donné une véritable leçon de jeu aux Hirondelles de Louis). J'ai d'abord eu une réaction de tristesse et de révolte – presque de colère – en pensant à leurs conjoints morts. Louis avait passé toute sa vie avec Simone, disons, peut-être quarante ou cinquante ans, ils avaient grandi, mûri, vieilli ensemble, ils avaient traversé des moments de grande difficulté où seule la présence de l'autre leur permettait de tenir le coup, ils avaient vécu des instants de bonheur secret à vingt ans, trente ans, soixante ans, ils avaient terminé leur vie ensemble. Simone s'était éteinte au bout du chemin dans les bras de Louis, baignée de ses larmes, elle était morte en se disant que l'homme de sa vie l'avait accompagnée jusqu'au bout et qu'elle avait fait de même, une belle réussite, c'était la fin du parcours, on l'avait mise sereine en terre – et Louis faisait à présent des papouilles à Odette. Simone pensait sans doute avec émotion qu'il ne restait plus à son époux que quelques mois à tenir avant de la rejoindre, des mois arides et vains sans elle, et soudain ce diable d'homme avait un sursaut de vigueur, repartait comme en 14 et tripotait maintenant la cuisse d'une championne de rami dans un bateau sur le Nil. Pauvre Simone, si brave, si naïve. Après la vie, après la vie de couple, après une vie entière dont on devrait sortir épuisé et comblé, on en voulait encore et on pouvait en avoir, on pouvait donner un dernier coup de reins et aller faire la java en croisière.
Читать дальше