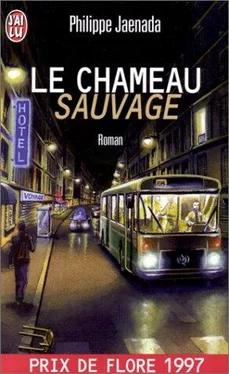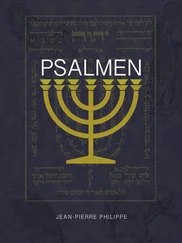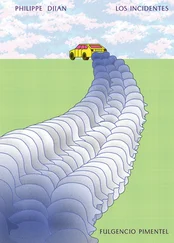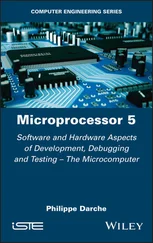– Voilà, si vous voulez bien signer, monsieur Sanz, m'a dit Merlin en me tendant humblement sa copie. Qu'est-ce que vous attendez pour lui retirer les bracelets, la Peluche?
J'ai remis ma ceinture et mes lacets, pris mon sac à l'épaule. Dans le sachet qu'avait déposé la Peluche sur le bureau, j'ai récupéré mes cigarettes, mon briquet, mon billet de cinquante francs et mon prospectus de Baba Komalamine.
Mais bien entendu, je ne pouvais profiter pleinement de ce moment rare (l'inverse de ce que doit éprouver un officier dégradé en public), car je savais que nous jouions une comédie dont la chute me serait dévoilée dans quelques instants. Casal guettait dans l'ombre, prêt à entrer en scène pour le bouquet final du rire policier.
– Eh bien, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, monsieur Sanz, a fait Merlin en se levant, énorme, comme une île qui sort en quelques secondes de l'océan. Je n'ai qu'un désir, c'est que vous nous pardonniez un jour.
Il m'a pris par l'épaule et m'a fait pivoter vers l'ascenseur, deux battants d'acier à quatre ou cinq mètres de nous. J'ai jeté un coup d'œil au petit Casal. Il me souriait.
– Il va de soi que si, par le plus grand des hasards, vous recroisez le dénommé Hannibal – par miracle, je dis bien -, nous comptons sur vous pour nous tenir au courant. Nous ne pouvons combattre la racaille que si les bonnes gens y mettent du leur. Et vous êtes avec nous dans ce combat, n'est-ce pas, monsieur Sanz?
Nous marchions vers l'ascenseur, côte à côte. Il me tenait toujours par l'épaule. Je me demandais par où ça allait tomber. (Dans les westerns, lorsqu'une crapule de la pire espèce tient un pied-tendre au bout de son colt, il lui offre souvent, en ricanant hideusement, une chance de s'enfuir. L'autre sait bien ce qui va se passer, mais fait demi-tour tout de même et se met à courir comme un dératé.)
La porte de l'ascenseur s'est ouverte.
– On se serre la main? Sans rancune?
Il va me faire une prise d'art martial? J'ai serré la main de Merlin. Je suis entré dans l'ascenseur. Je me suis installé au fond. Tout au fond. Je faisais face à Merlin. Je n'avais jamais remarqué que les ascenseurs mettaient tant de temps à se refermer. Celui-ci semblait prévu pour le passage de tout un escadron. Merlin me regardait fixement comme un père qui voit s'éloigner son fils. Un cliquetis m'a électrisé tout le corps: la porte. Encore quelques dixièmes de seconde et j'allais descendre. Les battants se sont refermés. Ah non. Merlin a posé doucement son gros pied au milieu, les battants se sont ouverts. Le Principe du Raffinage m'est apparu à nouveau.
– Monsieur Sanz…
Je m'y attendais, hein. Je n'ai pas à me plaindre, je m'y attendais.
– J'oubliais, monsieur Sanz: j'ai un petit conseil d'ami à vous donner. La prochaine fois que vous croiserez deux types en train de se taper dessus, passez votre chemin, ça vous évitera des ennuis.
La porte s'est refermée, l'ascenseur a commencé sa descente. Drôle de mentalité, le commissaire.
Je suis seul dans l'ascenseur. En un quart de seconde, le temps qu'une porte se ferme, je venais de passer de l'état de prisonnier, assuré de vivre les trois prochains mois, au moins, dans une cellule de quatre mètres carrés, à celui d'homme libre, dont l'avenir est grand ouvert. Je ne réalisais pas, j'étais comme mort, ou trop vivant, ivre, j'étais seul dans l'ascenseur.
La traversée de la salle du rez-de-chaussée fut un supplice. J'avançais tendu vers le paradis, au milieu des démons. La Peluche était là. Et une bonne quinzaine d'amis à lui. Ils me suivaient des yeux. À chaque pas, j'imaginais que je ne ferais pas le suivant. À chaque pas, je craignais que quelqu'un ne m'empoigne. Chaque mouvement autour de moi dans la salle me crispait. Mais à chaque pas, étrangement, je m'approchais de la sortie. Ils somnolaient mais n'allaient pas tarder à se rendre compte que j'étais un fuyard, que j'étais sur le point de m'évader – j'attendais qu'une alarme stridente retentisse. Le chasseur qui m'avait attrapé la veille se tenait non loin de la porte et me regardait venir. Je suis passé près de lui comme on passe sous une tuile qui vacille.
J'étais dehors. Il faisait nuit, il faisait froid.
J'ai marché quelques mètres sur le trottoir irréel. Je me suis arrêté, j'ai regardé les immeubles. C'était le plus beau moment de ma vie, voilà. J'ai allumé une cigarette, la braise crépite dans le froid. La fumée a un goût de noisette salée. Derrière une fenêtre éclairée, au troisième étage, une femme debout téléphone. Le monde autour de moi s'étend vaste et animé, sous la lumière des réverbères, partout. Et le temps à venir est vierge, l'avenir est libre et le monde est immense. Tout est à moi.
C'était une nuit de novembre, il faisait un froid épouvantable, je marchais n'importe où depuis vingt minutes éberlué, transi mais soûl de liberté, sorti de cage, comme un sauvage.
J'ai fait le point brièvement. Je laissais un mauvais moment clos derrière et revenais dans la vie ample et gaie, en prenant pleinement conscience de son ampleur et de sa gaieté. Il fallait faire attention, à présent. Non pas se replier et rester sur ses gardes, non, au contraire; mais sachant que tout peut disparaître à cause d'un vieux singe chauve et de ce mécanisme aveugle appelé «forces de l'ordre», éviter d'aller les ennuyer. J'avais deux ennemis (dont un minuscule), il me suffisait de le savoir; et si j'ôtais du monde le coiffeur et la police, j'avais encore largement de quoi m'amuser. Le coiffeur, je l'éviterais sans problème (bon, je ne pourrais certainement pas résister au plaisir de passer une fois devant sa boutique et de lui lancer un regard effrayant – car après tout il ne pouvait pas deviner que j'étais un agneau pacifique). Quant à la police, ennemie plus coriace et plus diffuse, monstre tentaculaire imprévisible, pour m'en tenir à distance – ou plutôt (car on ne s'éloigne pas de ce qui est partout) pour vivre dans les espaces libres – il suffirait que je respecte la loi, que je veille à ne pas dévaliser une banque ni séduire une mineure, et que je laisse les inconnus se faire casser la gueule sans intervenir. A priori, ça ne semblait pas sorcier.
Maintenant, le froid épouvantable me faisait plaisir, les trottoirs glissants d'eau glacée, les arbres ignobles, malingres, le béton mouillé, tout ce cauchemar d'hiver m’hébétait de plaisir. Je tournais en rond dans le quartier des Halles et grisé je me délivrais à chaque pas joyeusement de la cage. J'ai bu une bière dans un grand café, parc à beaux jeunes gens propres et fades, juste un demi vite pour me tremper un instant dans cette atmosphère de légèreté factice, un bain de filles minces et souples, de sourires, de poitrines élastiques et d'inepties lancées à voix claire. J'ai acheté Libé au kiosque de nuit pour parcourir en diagonale quelques articles au hasard, je l'ai jeté ensuite. Je me suis promené dans les allées d'un sex-shop hanté par de vieux vicieux perdus, entre des milliers de cassettes et de revues aux couvertures magnifiques, pour m'étourdir de nudité sans goût, de peau moite et de mélanges obscènes. La tête pleine de culs, je suis parti manger des frites molles au Burger King, sous les néons. Puis l'estomac plein de bouillie, j'ai traversé d'un pas lourd les jardins du Forum, avec plus que jamais l'impression d'être l'un de ces petits personnages de plomb que l'on voit posés dans les maquettes de cités idéales pour le bonheur de l'Homme, dans les bureaux d'urbanisme. Cette impression me plaisait.
Avec un sourire béat sûrement, je pensais en marchant à ce que disait, chaque année aux premiers jours de l'hiver, Catherine: «C'est l'époque des crachats gelés.»
Читать дальше