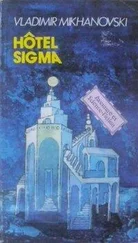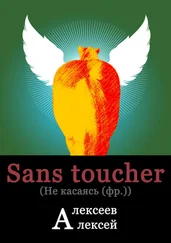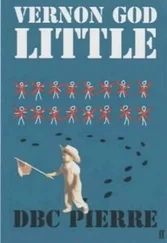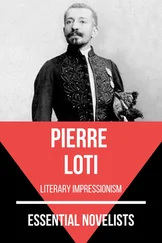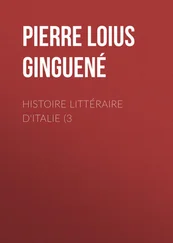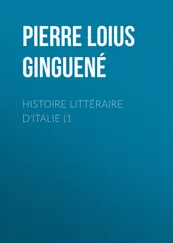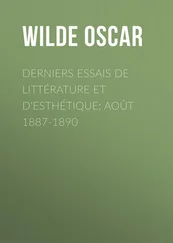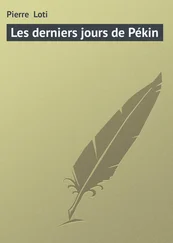*
Pour créer la surprise et alimenter la copie journalistique, le texte doit en outre présenter une apparence d'audace, dans le fond comme dans la forme, qui fournira le bonus symbolique, la garantie littéraire. Sur le fond, l'audace consiste à faire toujours la même chose. Du témoignage, et aussi de la violence ou du sexe. Si possible les trois. À chaque fois, on promet du scandale, de la révélation, du hard, quelque chose d'inouï. Le succès d'Angot, de Despentes, de Houellebecq, de Darrieussecq, de Catherine Millet, etc., a été fabriqué de cette manière. Au fond, on ne fait plus guère lire qu'avec cela (ou bien avec des ragots, ou encore avec de l'antisémitisme). Le scénario est tellement immuable qu'on est à chaque fois étonné du cynisme des uns et de la candeur des autres. Invariablement, d'un côté, on fait miroiter quelque nouvel exemple de liberté sexuelle osant briser les derniers tabous, une audace d'écrivain illustrant la puissance dérangeante de la littérature, invariablement de l'autre côté on s'insurge contre une littérature de latrines, on vilipende d'imaginaires écoles du dégoûtant. On ne quitte pas le plan moral. Le débat, en réalité, est purement formel, il y a belle lurette que littérature et morale vivent sous le régime de la séparation. Certains continuent à se demander si l'on peut tout dire. Le «tout» s'avère n'être qu'un argument publicitaire, pour deux raisons: d'abord parce que toutes les limites ont été franchies depuis longtemps, la liste des exemples serait innombrable, Sade, Rebell, Apollinaire, Céline, etc. Ensuite et surtout parce que le «tout» en question, dont on fait si grand cas, s'avère à la lecture n'être qu'une anodine histoire de fesses dont il est aussi ridicule de s'extasier que de se gendarmer. Certains auteurs prétendus «sulfureux», ainsi que les critiques et les éditeurs qui entretiennent cette réputation, ont l'air de vivre il y a cinquante ans, ils se gargarisent d'audaces cacochymes, s'étonnent du courage qui consiste à briser des interdits pulvérisés depuis des lustres. Qu'on lise Le Boucher d'Alina Reyes, spécialiste de l'érotisme qualité française garantie. On tombera sur un morne alignement de figures obligées qui ne ferait plus rougir que des chaisières de Saint-Flour, mais qui pourrait à la rigueur susciter les prémices d'un raidissement chez un notaire tourangeau gavé au Viagra. Baise-moi, de Virginie Despentes, ne mérite ni l'excès d'honneur qu'il a recueilli, ni totale indignité. C'est juste un petit polar violent comme il s'en fabrique tous les jours. Quels «tabous» ont été brisés, quelles limites franchies?
Il ne s'agit nullement de protester contre le sexe ou la violence en littérature, ni contre la confidence ou l'autobiographie. Rien n'est bon ni mauvais en soi. Mais, dans la plupart des cas, on exploite un genre pour laisser croire à un contenu. Comme si le genre en lui-même était susceptible de livrer automatiquement du sens, parce qu'il est question de choses supposées vraies (la confidence), corporelles (le sexe). Le simple fait d'étaler une intimité serait, en quelque sorte, une garantie de consistance: enfin la littérature nous donne du réel. Même la pure fiction, comme Truismes, part de ce principe: si c'est saignant, c'est qu'on touche du réel. Une bonne part de la littérature contemporaine fonctionne donc de cette manière paradoxale: les éditeurs donnent une existence artificielle et fugitive à des ouvrages écrits selon des procédés conventionnels, mais dont la valeur repose sur la notion d'authenticité.
Pour les écrivains qui pratiquent l'autobiographie de manière plus réfléchie, l'authenticité se conquiert dans le travail du texte même. Parler de soi, chez Claude Louis-Combet, c'est retrouver non pas un quelconque «moi» comme valeur absolue et garantie de réalité, mais les profondes couches mythiques en lesquelles se fonde la personne. Il est évidemment plus difficile d'en faire de la marchandise pure.
Le côté pervers de l'intimité et de la sexualité comme marchandise, ce n'est pas seulement que l'on fait passer pour de la littérature des textes sans intérêt, mais, inversement, que des critiques un peu scrupuleux rejettent comme simple marchandise des livres intéressants qui ont fait l'objet d'une campagne publicitaire basée sur le sexe ou la confidence. On a ainsi l'impression qu'en bien ou en mal, on parle toujours d'autre chose que du livre. Le sort réservé à La Vie sexuelle de Catherine M. est un bon exemple de cette perversité. L'ouvrage de Catherine Millet a du succès parce qu'elle y raconte ses partouzes. Il est vilipendé par Jérôme Garcin uniquement parce qu'il est une marchandise. Peut-être faudrait-il simplement le lire. Il a certes pour handicap d'être écrit par la directrice de la rédaction d'Art Press, une revue qui a réussi, par son byzantinisme et son esprit de clan, à écœurer de la critique d'art les amateurs les mieux disposés. On pouvait craindre les pires afféteries. Or, La Vie sexuelle de Catherine M. est un des très rares livres contemporains qui parlent réellement de sexualité, de ce qu'est la pratique sexuelle, les choix sexuels dans une vie, en évitant à la fois l'écueil du maniérisme pornographique et celui de l'idéalisation. Jamais de poncifs (si un genre appelle le poncif, c'est bien la confidence sexuelle), jamais de complaisance, mais une exactitude distanciée, pleine d'humour.
*
Un événement littéraire ou un prix prestigieux (Roze, Rolin, Darrieussecq, Angot…) se fabrique ainsi avec de vieux poncifs, de vieux fonds de sauce réaliste dont on fait passer le goût insipide avec quelques épices stylistiques d'allure un peu moderne. Depuis quelques années, de tels faux événements se multiplient. Bien souvent, le grand auteur découvert à l'occasion de ce genre de «coup» ne tarde pas à replonger dans l'anonymat, victime d'un manque de talent dramatiquement associé à une surcharge de succès. Marie Darrieussecq, qui a tenté d'user, avec Naissance des fantômes, de moins grosses ficelles que dans Truismes, glisse doucement vers une demi-obscurité. Pascale Roze, à qui François Nourissier promettait un brillant avenir, s'est, Dieu merci, évanouie. Il en va à présent de la littérature prétendue de qualité, honorée par le Goncourt, le Femina et Le Monde des livres, comme des starlettes de variétés qui disparaissent après une unique chansonnette à succès, ou passent leur vie à s'autoplagier dans des come back pathétiques, à essayer de durer en faisant vendre des yaourts ou des savons. On voit ainsi Beigbeder, Angot, Darrieussecq tenir des rubriques, parler de tout et de rien dans des magazines féminins, donner leur avis sur la marche du monde, la littérature, n'importe quoi. On voit Michel Houellebecq faire dans la chansonnette ou publier des albums de ses mauvaises photos de vacances. Sans prôner le splendide isolement de Gracq ou de Michaux, on ne peut s'empêcher de ressentir quelque chose de dégradant dans cette pratique devenue courante. On a un peu honte, non seulement pour ceux qui s'y livrent, mais pour la littérature en général, peu à peu ravalée par ces auteurs au rang de bavardage journalistique.
Le coup éditorial fait ainsi de la vie littéraire un théâtre d'illusion: un éditeur orchestre la sortie d'un livre en faisant passer une cuisine de vieux restes pour une recette nouvelle. Des journalistes intéressés ou soucieux de ne pas rater un événement donnent l'ampleur désirée à la chose. Quelques écrivains ou critiques plus attentifs protestent, ce qui ne fait, fatalement, qu'accentuer le succès, selon la vieille loi publicitaire: qu'importé ce qu'on en dit, pourvu qu'on en parle. Le bavardage autour du texte a plus d'importance que le texte. Puis les histrions disparaissent, jusqu'à la prochaine représentation. Et tout le monde est content. De plus en plus de maisons d'édition vont ainsi de coup en coup, incapables de se consacrer à la gestion d'un fonds à long terme.
Читать дальше