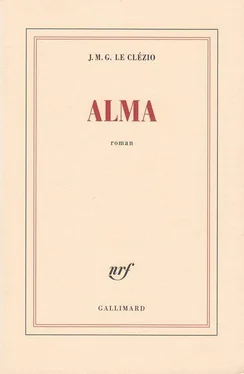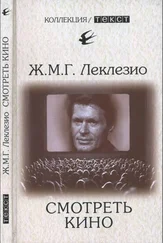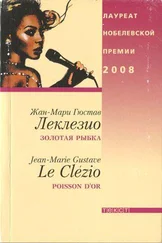À la Maison Blanche, au début ils m’enferment dans la chambre aux fenêtres grillées. Une nuit un grand bonhomme marche entre les lits, il a dans ses mains une sangle en cuir, il la tend et ça fait un bruit de claquement, il dit qu’il va nous étrangler avec sa sangle, il marche lentement en traînant les pieds et en faisant claquer la sangle. Tito a peur, il se met en boule sur son lit et il pleure, alors je sors de mon lit parce que je ne dors jamais, je vois le bonhomme debout devant Tito, je ne dis rien, je ne crie pas, à quoi ça sert chez les fous ? Les gardes n’écoutent pas les cris dans la nuit, ils viennent le matin et ils disent qu’on est tous mélangés. Je marche vers le bonhomme, je mets mes bras autour de lui et je le serre si fort qu’il ne peut plus respirer, il lâche sa sangle et il se laisse tomber assis par terre, je vois ses épaules qui se secouent parce qu’il pleure lui aussi. Je le lève et je le fais marcher jusqu’à son lit et je l’allonge pour dormir. Le lendemain, les infirmiers me parlent, ils disent que je suis un héros, alors je peux aller partout dans la Maison Blanche, je suis devenu leur chien de garde. Dans le jardin, je m’assois sur une chaise en plastique et je regarde les plantes et les oiseaux, ils me parlent et moi je leur parle, aux oiseaux je donne à manger les grains de raisin sec qu’on sert à la cantine. Et les gens me parlent doucement, au début seulement les vieux, et puis les infirmières, et aussi mon étudiante aux yeux noirs, elle s’assoit dehors à côté de moi, et elle prend des notes dans un cahier, il est pareil à celui que M me Vicky me donne avant de partir, sur mon cahier j’écris pour elle les noms des lieux et les mots que j’aime, mais à l’asile les gardiens confisquent les mots. Aïcha ne ressemble pas à mon Ayeesha Zine de la Louise qui a des yeux verts et des dents très blanches, elle n’a pas peur de moi, elle ne dit pas que je suis un monstre. Un jour nous sommes assis comme d’habitude sur un banc dans le jardin, elle n’a pas son cahier de notes dans les mains, elle se penche un peu en avant, elle cherche quelque chose par terre dans le gravier, elle dit : « Quel âge as-tu ? » C’est la première fois qu’elle me demande ça, pas pour ses études de médecin des fous, juste pour savoir qui je suis. Je dis : « Je ne sais pas, je ne connais pas le jour où je suis né. » Comme à Père Labat de l’église Saint-Jean je dis : « C’est parce que je ne dors pas, les jours se suivent, et c’est tous les jours la même journée. » Père Labat ne comprend rien, mais Aïcha comprend, elle réfléchit et elle dit : « Alors tu es éternel ? » J’ai envie de rire, je réponds : « Tu as raison, Aïcha, ma vie est longue avec un seul jour et une seule nuit, peut-être je ne peux pas mourir. »
À la Maison Blanche je suis bien, je peux imaginer Alma, le temps d’Alma, mon papa va à son bureau près de la cathédrale, et le soir il vient sous la varangue, Artémisia est assise sur sa pierre dans la cour, ses yeux ne voient pas mais elle sent quand mon papa arrive, elle se lève pour aller chercher son thé, et moi je vais vers lui, je sens l’odeur de sa cigarette, j’écoute sa voix grave, il me dit : « What’s up, boy ? » Je peux trouver la vieille Yaya, elle habite encore au bout du chemin près du bois, la petite case en bois noir, je me couche contre son ventre et je dis : « Conte, Yaya, conte zistoire zanimaux, zistoire margoze, conte, Yaya ! Conte sirandanes, Yaya ! » Et Artémisia est toujours là, même si je suis malade, et le grand Σ mange mon nez et ma bouche, mange mes yeux, Artémisia n’a pas peur d’attraper la maladie, elle me serre dans ses bras et je suis toujours petit, elle me donne son lait et je touche ses tétons, un et puis l’autre, celui-ci est à moi, et celui-là aussi est à moi, et ça ne peut pas finir.
Dans le jardin de la Maison Blanche le soleil d’hiver passe sur mon visage, bientôt le soleil va s’éteindre, chaque soir le ciel devient jaune d’or. Je suis dans mon île, ce n’est pas l’île des méchants, les Armando, Robinet de Bosses, Escalier, ce n’est pas l’île de Missié Kestrel ou Missié Zan, Missié Hanson, Monique ou Véronique, c’est Alma, mon Alma, Alma des champs et des ruisseaux, des mares et des bois noirs, Alma dans mon cœur, Alma dans mon ventre. Tout le monde peut mourir, pikni, mais pas toi, Artémisia, pas toi. Je reste immobile dans le soleil d’or, les yeux levés vers l’intérieur de ma tête puisque je ne peux pas dormir, un jour mon âme va partir par un trou dans ma tête, pour aller au ciel où sont les étoiles.
Les jours et les nuits s’attachent, sans se casser, c’est un lent sac et ressac, un grand ballet qui emporte les gens, ceux d’Alma et ceux de l’asile, mon papa et Maman Laros, Yaya, Artémisia, et aussi Vicky, là-bas à l’autre bout de la mer, et même Zobeide la rouge qui m’a fait celui que je suis. La bananée approche, on accroche des lampions aux arbres dans le jardin, et dans le hall d’entrée de l’asile on plante un sapin dans un pot, toujours le même année après année, il est chauve sur le dessus et ses aiguilles sont jaunes comme les dents de mon papa qui fume trop. Péna problème, je connais toujours le même morceau, mon vieux Auld Lang Syne , j’ai la permission de le jouer au salon, ce n’est pas sur mon piano Hirschen, c’est juste un Gaveau, mais je peux chanter dans ma tête les paroles dans la langue de ma grand-mère Beth, ce sont les mots les plis zolis, les plis doux de toutes les langues des hommes et des animaux. Alors je les fais répéter autour de moi chaque après-midi, pendant que les infirmiers et le docteur se reposent, et tantôt, quand c’est la nuit, quand c’est l’heure, tous les fous vaillants se réunissent dans le salon, je vais au piano, je soulève le couvercle, et je commence à jouer, ils chantent avec moi les paroles dans la langue écossaise de ma grand-mère Beth et mon papa et même Maman Laros les entendent là où ils sont, ça doit leur faire bien chaud à l’âme,
Ar oíche auld lang syne seo muid,
ar oíche auld lang syne
Ag casadh amach anocht le bród
ar oíche auld lang syne
L’Étranger, en guise d’épilogue
Il y a un chaînon manquant à cette histoire, je le vois bien. C’est pour cela que ma mère m’a demandé ce pèlerinage, elle n’a pu se satisfaire de l’histoire officielle, ni du silence obstiné de son mari. Je suis venu à Maurice pour une autre quête que celle de l’oiseau disparu. Pour tenter d’assembler les morceaux, non pas pour comprendre, mais parce que sans cela il n’y a pas de paix ni de clarté, ça doit être une question d’équilibre — Clara me reproche toujours ma raideur.
Alexandre (c’est ainsi que je préfère l’appeler depuis que je ne suis plus un enfant, parce que c’est un nom dur qui lui va bien) quitte l’île en 1917 pour tenter de rejoindre l’armée britannique, mais l’Angleterre ne veut pas d’un enfant de quinze ans. À Paris il retrouve son oncle Alexis, médecin dilettante, qui le loge dans son petit studio du boulevard Saint-Michel, le temps qu’il termine ses études. Cependant a vécu à la même époque un autre Felsen, celui dont on ne parle pas, la mauvaise branche, qui a été dépossédé de tous ses biens, y compris de sa part du domaine Alma, et condamné par la postérité pour cause d’inconduite notoire — il portait le nom étrange d’Achab, j’en ai entendu parler dans mon enfance, au cours de ces rares réunions de famille auxquelles mon père consentait, on racontait qu’Achab avait disparu avant la Première Guerre à l’île Juan de Nova, dans le canal du Mozambique, où il vivait de l’exploitation du coprah, en compagnie d’une femme indigène, que la légende malintentionnée décrivait comme une sorte d’otarie, alanguie et paresseuse, avant de revenir à Maurice avec son fils métis. On n’aimait pas prononcer le nom du transfuge, je me souviens seulement de cette épithète lâchée par mon père, sur un ton définitif : « un fruit sec ». Le fils d’Achab, Antoine, a continué la légende du fruit sec, puisqu’il s’est séparé de la bonne société mauricienne en vivant dans le péché avec une femme venue d’ailleurs, une créole réunionnaise qu’il avait connue à Paris, si j’en crois Emmeline, sous le nom de Rani « la Reine » Laroche.
Читать дальше