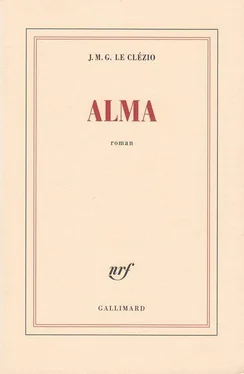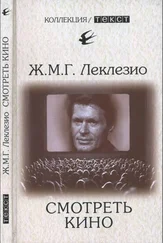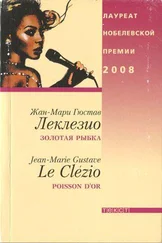Peut-être est-ce pour ceci que je suis venu à Maurice, sans vraiment le vouloir : pour comprendre l’origine, le point brûlant par où tout a commencé. Voilà quatre-vingts ans mon père a quitté son île pour venir étudier en France, pendant la Première Guerre. Alors il fuyait le désastre, Alma en ruines, son père chassé de sa maison natale, sans avoir commis d’autre faute que s’être montré confiant, et il n’y avait pas d’archange au sabre enflammé pour lui montrer le chemin de l’est, vers Mahébourg, vers Belle Mare, ou vers Poudre d’Or, mais un huissier de justice vêtu de noir, chaussé de petites lunettes, qui dressait l’inventaire.
L’histoire est un tissu en lambeaux. Je voulais rapporter quelque chose à ma mère, pour répondre à ses questions, mais je ne m’attendais pas à des miracles. Aux archives notariales, aux archives d’État, je n’ai rien trouvé. L’histoire des familles, la vraie (l’autre étant plutôt imaginaire…), ne laisse pas beaucoup de traces. Elle a lieu dans le silence feutré des cabinets d’avocats, dans le secret des réunions de salon, parfois à l’ombre honteuse des alcôves. L’employée aux archives, une dame un peu lente, lorsque j’ai sollicité les plans et les statuts d’Alma, a secoué la tête en signe de découragement. « Attendez, je vais voir ce que je peux trouver… » Tout ce qu’elle trouve, c’est la liste des passagers du navire marchand la Daphné , sur laquelle figure le nom de mon ancêtre Axel Thomas Felsen, négociant, âgé de vingt-six ans, émigré à l’île de France en l’an VII de la République, en compagnie de son épouse Alma Soliman, âgée de dix-huit ans, et de leur fille Anne, âgée de six mois. Pour m’être agréable, la dame des archives a fait une photocopie du rôle, sur un papier épais comme du carton. Également, elle me donne une enveloppe, arrivée là on ne sait pourquoi, contenant une lettre de mon grand-oncle Alexis, docteur en médecine, écrite à Paris en 1920, adressée à Jules Armando, dans laquelle il explique pourquoi il se considère, en dépit du règlement, comme l’un des actionnaires de la sucrerie à hauteur de cinquante pour cent. La lettre est à l’encre violette qui a rongé en partie le papier bible, elle semble bien n’avoir jamais été lue par son destinataire. Elle n’a d’autre intérêt que de montrer l’incroyable naïveté — ou, au choix, la rouerie — de son auteur. Un instant, j’ai été tenté d’en faire une copie, ou même de la subtiliser, puis j’y ai renoncé parce que son contenu m’a paru complètement insensé.
Lorsque, à la suite du décès d’Élias, l’arrière-grand-père Felsen, au cours de l’épidémie de grippe espagnole qui a décimé le monde en 1919, Alma est rachetée par la famille Armando, les Felsen ne sont déjà plus les gérants du domaine, ils ont tout laissé pour se réfugier à Beau Bassin, comme mon grand-père Arnould, ou pour aller en France, comme l’oncle Alexis et comme mon père — ou encore Antoine, l’héritier de l’autre branche qui dilapide la fortune familiale à Londres avant d’être radié du barreau. C’est tout cela qui fait l’histoire d’Alma, jusqu’à la ruine, jusqu’à l’éviction des derniers habitants et la vente du terrain à un consortium banquier en vue de la construction du plus grand centre commercial de l’île, sous le nom redondant de Mayaland, la terre des illusions.
Hier Emmeline est morte. Elle s’est éteinte dans son sommeil, sans autre raison que l’âge, comme une bougie qu’on souffle. Je l’ai appris par M me Pâtisson, elle a ajouté : « Pour l’hommage, il faut se dépêcher, à Maurice en été les morts ne traînent pas. » Alors, au lieu de retourner à Alma — de toute façon qu’est-ce qu’il en reste ? — je prends le bus pour Moka. Dans la vieille église en pierre noire, au carrefour, il y a peu de monde, des voisins, de la famille, mais ses petits-enfants ne sont pas venus de Suisse ou du Sud-Afrique. L’assistance est debout, je vois la silhouette bourrue d’Olga au premier rang, elle semble un peu tassée par le chagrin, par la solitude aussi, le « Vomissement » ne pourra pas survivre, il sera rasé et remplacé par des appartements pour recevoir les étudiants de l’université. Il fait chaud et lourd, on parle d’un cyclone qui menace au large de Madagascar, alors les portes et les fenêtres de l’église sont grandes ouvertes, on entend les ronflements des autobus et des camions, les klaxons des autos, la crécelle des deux-roues chevauchés par les livreurs coiffés de casques allemands de la Seconde Guerre mondiale. On entend les éclats de Radio One avec ses ségas roulés et les réclames pour le poulet Chantecler. Derrière tout cela, la voix du curé bourdonne ses prières, mais il n’y a pas le magnifique Dies irae, dies illa qu’Emmeline aimait chantonner comme si c’était une rengaine d’amour. Personne ne pleure, juste quelques raclements de gorge pour simuler l’émotion, quand vous êtes vieux vous êtes déjà mort longtemps avant qu’on vous enterre. Et tout d’un coup, maintenant, un genre de miracle, entre par la grande porte en ogive le petit Licien d’Emmeline (ou d’Olga, je ne sais plus) qui trottine gaiement dans l’allée centrale jusqu’à l’autel, il s’arrête un instant devant le curé médusé, personne ne songe à lui dire « Out ouah ! » pour le chasser, sa queue bat la mesure, et puis il fait demi-tour et il retourne dans la rue.
Je pars demain pour la France, je reviendrai sans doute, ou pas, je n’en sais rien. Ma mère attend mon compte-rendu au couvent Saint-Charles, à Cimiez, sa première question sera : « Alors, est-ce qu’il reste des Felsen là-bas ? — Plus un, maman, depuis que je suis parti. » Je ne suis pas sûr de lui parler d’Emmeline, c’était la dernière personne de la génération d’Alma, avant les Armando, les Escalier, les Robinet de Bosses. Avant la Maya dévoreuse d’enfants. Peut-être lui parlerai-je plutôt d’Olga, et de Licien. Je garderai encore un peu la pierre ronde du dodo dans ma poche, mais sa place est dans un musée, à La Rochelle par exemple, ou au Muséum d’histoire naturelle de Paris, à côté du squelette rafistolé du gros oiseau. Clara m’attendra à l’aéroport, je la serrerai contre moi pour sentir son odeur vivante, dans le creux de son cou. Elle dira : « Alors, c’était bien ? » Je répondrai : « Oui, pas mal, pour un voyage de noces ! » Elle tendra sa main avec le geste qu’elle fait toujours pour une promesse, et j’imprimerai un sceau avec mon pouce.
Je suis Dodo, Dodo Fe’sen, Coup de ros, Lézard, né pour faire rire, pour voyager, pour être l’admirable hobo, et aussi l’enfant de Rani Laros, la chanteuse, je ne me souviens pas de sa voix mais je me souviens bien du jour où on l’a conduite au cimetière Saint-Jean, ils ne veulent pas qu’on l’enterre à côté des Fe’sen alors mon papa fait ouvrir un tombeau au fond du cimetière, près du grand cyprès au bout de l’allée O, et c’est là qu’elle est, contre le mur, sous la dalle de pierre grise, et c’est là que mon papa est aussi, je suis debout devant le trou et il pleut sur le cercueil qui descend dans la terre.
Ici, à la Maison Blanche, pe’sonne ne me connaît, je suis vraiment pe’sonne. Je ne veux plus aller nulle part ailleurs. Le jour où la police m’emmène, je m’arrête de parler, ils n’ont pas mon nom, ils n’ont pas mon âge, ils croient que je suis fou. Alors ils me conduisent ici, à la Maison Blanche, dans le grand jardin près de l’entrée de l’autoroute. Il paraît que c’est la maison des indigents et des aliénés, et je suis l’un et l’autre. Les fenêtres sont bouchées par des grilles noires, ils ont peur que quelqu’un fout’ le camp, mais moi je ne veux pas fout’ le camp, ici c’est ma maison, l’endroit où pé mouri, on me donne un lit dans la chambre commune, on me donne à manger matin midi et soir, avec du café et des tartines, même de temps en temps les vieux fruits des supermarchés qui tombent par terre. À travers la grille, devant la Maison Blanche je vois les arbres de l’hiver, chaque jour je guette une petite feuille nouvelle, un petit oiseau qui chante. De l’autre côté du jardin, les immeubles ont beaucoup de fenêtres, quelquefois le matin le soleil envoie un rayon jaune d’or, jaune comme le soleil sur les champs de cannes, je bois la couleur de l’île avec mes yeux. Le docteur vient le matin, ou bien le soir, avec des étudiants et des étudiantes en blouse blanche. Les filles sont sérieuses, elles ont des lunettes et leurs cheveux en chignon noir, elles ont des masques hygiéniques attachés derrière leurs oreilles. Une étudiante vient chaque jour, je l’aime bien, elle a des cheveux châtains bouclés, des yeux noirs moqueurs. Je lui demande son nom, elle dit : « Ah bon, tu parles maintenant ? » Elle dit : « Mon nom c’est Aïcha. Et ton nom, c’est comment ? » Je ne sais pas pourquoi, je n’ai pas peur d’elle, je dis : « Mon nom, c’est Dodo. » Les autres rigolent, ils disent : « C’est un simulateur ! » Qu’est-ce que c’est un simulateur, je veux bien savoir, mais le docteur est là alors je ferme ma gueule et je ne réponds plus. Le médecin est un grand dimoune, même s’il est tout petit et qu’il est arabe, il est chauve sur le dessus de la tête alors il tire ses cheveux de l’arrière vers l’avant pour faire joli. Tous les jours il veut que je parle, il dit son nom, c’est un nom arabe, comme Rahman, Salman. Il le dit et je l’oublie. Je ne veux pas lui parler, il n’est pas mon ami. Ensuite il va voir les autres malades, un jeune et un vieux, les vieux c’est toujours en dernier parce qu’ils se plaignent de tout, ils geignent : « Ah mon Dieu docteur si vous saviez… » Mais ils ne terminent pas leur phrase alors le docteur ne peut pas savoir. Le jeune dans la chambre c’est Tito, c’est un Gitan, comme aux portes de Paris ceux qui allument les feux de planches sur le trottoir et les enfants qui dorment sous des bâches en plastique vert. Tito veut toujours mourir, c’est pourquoi on l’enferme ici à la Maison Blanche, dans la chambre avec la fenêtre bouchée par le grillage, parce qu’il peut avoir envie de sauter par la fenêtre, ou bien sous un train, ou bien même sous les roues des auto-scooters à la foire, c’est ce qu’il a fait mais il n’est pas mort, juste quelques coupures sur les jambes. Docteur Salman s’assoit sur une chaise à côté de son lit, et Tito reste couché parce qu’il a des pansements aux mains et aux jambes. Le docteur pose les questions, mais Tito ne répond pas, il reste tourné vers le mur et finalement un infirmier lui fait une piqûre dans les fesses et le docteur s’en va. Moi je reste avec Tito, pour le faire rire je tire ma langue de toutes mes forces, elle remonte sur ma joue comme un couroupa jusqu’à mon œil, Tito aime bien, ça le fait rire. Mais je fais le lézard seulement après que le docteur et les étudiants sont partis, parce qu’ils disent que je suis un simulateur. S’il connaît mon nom, le docteur Salman va me renvoyer, la police va rôder pour me mettre dans l’avion de Missié Hanson jusqu’à l’île, et là-bas je n’ai personne, même Vicky ne peut pas me recevoir. Dans l’île je n’ai pas d’endroit où pé mouri, Alma est détruite, personne ne me connaît. Ici, à cause des aliénés, il n’y a pas les miroirs où se cachent les démons, je n’ai plus peur de ce qui peut sortir des miroirs, je ne les guette plus, ils ne me guettent plus. Je suis seulement avec les clodos, les vieux, les gens qui n’ont pas de nom, et Tito je l’aime bien parce qu’il veut sauter par les fenêtres pour s’envoler .
Читать дальше