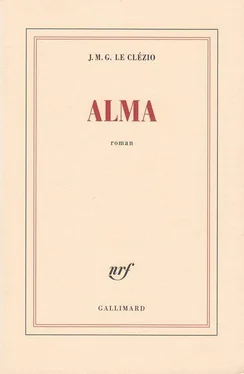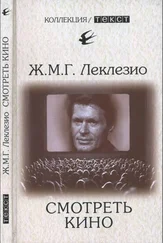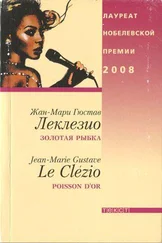À dix heures environ, l’acteur fait son apparition. Sa lourde cage est portée sur le pont par deux matelots, la porte s’ouvre, et l’oiseau sort avec prudence. Le soleil l’éblouit, il cligne de l’œil, fait quelques pas et s’ébroue, salué par le rire des spectateurs. À la lumière son plumage gris prend des reflets verts, les plumes noires et blanches de sa croupe ondulent dans le vent. Le cercle des marins s’élargit un peu, l’oiseau marche en rond de sa démarche lente de sénateur. Il se penche vers le sol, cherche quoi picorer. Alors commence la démonstration : John Perce puise dans un sac, jette des graines, des biscuits, des feuilles séchées, il sème ses offrandes en reculant et le dodo marche vers lui, pique, recrache, pique encore. Il regarde le cercle des hommes sans aucune crainte. L’air de la mer l’enveloppe, pénètre ses narines, fait friser les poils de sa barbe, il plisse les yeux de bonheur, il roucoule même son doux bruit de plaisir, son do-do-doo qui lui a donné son nom. « Mange-t-il vraiment le fer ? » crient les marins. John choisit dans son sac des morceaux de métal rouillé, des têtes de clous, des limailles de soudure, et le dodo les avale aussitôt. Les hommes applaudissent, ils rient très fort, l’oiseau s’arrête et se redresse, l’air de dire : « Vous avez vu ? » Un homme jette une balle de mousquet qui roule en vibrant sur le pont, zigzague à cause du roulis. En deux bonds le dodo la rejoint et la gobe en renversant sa tête sur son épaule. « Hourra ! » crient les marins. À l’ombre de la dunette, le grand Thomas Herbert lui-même daigne sourire. Il pense à ce qu’il va écrire. Cela se passe ici, en décembre 1629, sur le pont du Hart , quelque part dans l’océan, sur une mer lourde couleur de vin. C’est le dernier voyage du dodo, et personne ne le sait, sauf lui peut-être, qui regarde la ligne de l’horizon entre les jambes des marins, et comprend qu’il ne reviendra jamais dans sa vallée.
À la lumière du quinquet, dans la salle des cartes, Thomas Herbert écrit ses notes : « Le premier des oiseaux, le dodo que l’on trouve icy, comme aussi dans l’île de Diego Ruys. Les Portugais ont donné ce nom à cet oiseau à cause de sa simplicité, & eussent pu lui donner le nom de Phénix, s’il était en Arabie, tant sa taille & sa figure sont rares. Il a le corps rond & extrêmement gras, en sorte qu’il n’y en a pas qui pèsent moins de cinquante livres. Il contracte cette graisse & cette corpulence par son pas lourd, sa démarche tardive. Il est plus agréable à la veue que bon à l’estomach, quoique peut-être il s’en trouve d’assez chauds pour en digérer la chair, qui est dure & mauvaise. »
Sir Thomas se flatte d’être un chroniqueur de talent, il improvise sur l’oiseau qui voyage dans son navire : « L’on voit dans ses yeux la mélancolie même, causée sans doute de ce que la nature lui a fait le tort de donner de si petites ailes à un si puissant corps, qu’elles sont incapables de soulever de terre, & ne lui servent que pour faire connaître qu’il est oiseau . » Mais il se reprend et revient à la description objective que la Société royale attend d’un observateur compétent : « Sa tête est d’une figure bien extraordinaire, étant d’un côté couverte d’un duvet de plumes noires, & de l’autre elle est toute chauve & blanche comme si cette partie était couverte d’une toile claire & transparente. Il a le cul tout rond, & au-dessus des plumes d’un verd gay, mêlées avec d’autres d’un jaune pâle. Ses yeux sont ronds & petits, brillants comme des diamants mais n’ont rien de vif. Tout son plumage n’est qu’un fin duvet comme celui des oisons, sinon à la queue qui consiste en 3 ou 4 plumes placées comme les poils de la barbe d’un Chinois. Il a les jambes grosses, noires & fortes, & les talons de griffes pointues, & l’estomach si chaud qu’il n’y a point de pierres ni de fer qu’il ne digère ; en quoy, comme aussi en d’autres choses il ressemble à l’autruche. »
Ici, il fait sombre, il fait froid. L’air est immobile. L’air est chargé de vapeur de charbon, les murs sans fenêtres sont couverts de mousse, le sol en dalles est traître, glissant, il faut marcher à petits pas, en boitant, les ongles crissent sur la pierre sans s’enfoncer, il n’y a pas de terre, pas de douceur.
Ici, personne ne vient. Un homme apporte à manger, une fois par jour, le matin, ou bien le soir, il est grand et maigre, son visage est blanc, à la lumière de la porte qui s’ouvre sa moustache brille couleur de feu, mais il ne regarde pas, il ne regarde jamais en face. Il jette des poignées de graines, il passe son balai de racines pour repousser les crottes, il s’en va. La pluie coule de la gouttière par le soupirail, un petit torrent qui s’arrête et reprend. C’est de l’eau douce, mais acide, qu’il faut attraper au vol, happer, laper, sucer sur les pierres. L’homme vient une fois par jour. Il ne dit rien. Il ne parle pas, ni ne chante. Il s’arrête sur le seuil, il barre le passage avec son balai. Il jette des petites pierres qui courent sur le sol et vont se cacher dans les coins, pour rien. Un jour pourtant, la porte s’ouvre, la lumière entre dans la cave, jusqu’au fond des murs, l’oiseau hébété titube vers la lumière, et là il voit des hommes, des femmes, des enfants, ils sont rassemblés, ce n’est pas le pont du bateau, c’est la vilaine cour froide, maculée de neige sale, le ciel est blanc et rose. Cela pourrait être jadis, au temps des pluies dans la vallée, mais il ne pleut pas, le ciel est triste et immobile. Seulement cette odeur de charbon, cette poussière qui entre dans le corps, qui fait tousser. Puis, dans la cour, les pierres tombent, ce sont les hommes et les femmes, et les enfants aussi, ils jettent les pierres, les petits bouts de fer, les clous, les sous de bronze, ça tombe avec un bruit aigu, qui fait peur, ça tombe et ça roule, et ça reste immobile dans la cour, et l’homme pâle crie, il donne des ordres, « mange ! mange ! », et les autres hommes, et les femmes et les enfants crient aussi, ils agitent leurs bras. Mais les pierres sont mortes, elles frappent le sol de la cour et ne bougent plus. Quelqu’un a commencé, par jeu, ou par colère, son bras a jeté la pierre, une pierre méchante qui mord et fait jaillir le sang, une pierre qui veut tuer, comme autrefois, quand les marins chassaient dans la baie et que les oiseaux tombaient sans comprendre. D’autres suivent, ils jettent les cailloux, les morceaux de fer, une pluie meurtrière. Alors naît la peur, mais il n’y a pas d’issue, pas de cachette. Et puis d’un seul coup vient un grand vide, un trou au fond du corps, le cœur ne bat plus, n’a plus la force de faire courir les pattes, de faire sonner les ailes sur les flancs, le bec est lourd, il tombe vers le sol. La langue est sèche et amère, les yeux se ferment. Un instant tout redevient limpide et tranquille, les arbres se penchent, le ruisseau fait sa musique, le soleil est doux, la brise caresse, le chant des oiseaux berce, les bruits très glissants des gorges, coo-coo , le roulement des voix, les tambours des ailes, dodo est revenu dans son île, pour toujours…
Ensuite tout est noir. Le sol de la cave est immense et froid. Les petits insectes courent, et aussi les animaux d’autrefois, ceux qui venaient dans la clairière, il fallait se battre contre eux, pour défendre le nid, pour défendre le petit. Il le fallait. Ici, il n’y a pas de nid, il n’y a pas d’enfant. Ici, la dalle est sans fin, elle ne laisse pas passer la terre, ni les herbes, ni les arbres. L’air n’entre plus, il ne passe plus par la gorge, il ne baigne plus les narines, il ne fait plus bouger les poils follets et les plumes superbes, il n’éclaire plus les yeux. Dodo reste sur place, allongé sur la pierre, il attend ce qui doit arriver.
Читать дальше