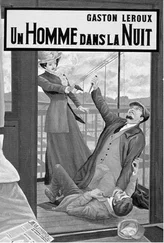Il cala le tout dans la valise.
Concentration des troupes, regagner un trou d’homme et ne passer à l’attaque qu’ensuite. Il ne se laisserait pas coller au mur par une patrouille de Jeunesses hitlériennes, ni par ses propres camarades, ni par des Feldgendarmes. L’organisation était son point fort. Les préparatifs étaient terminés, le temps de la décision était venu, il entrait dans la phase d’exécution de son plan. L’offensive pouvait être lancée.
Il n’avait pas cessé de tout repasser dans sa tête. Tout ne se déroulerait certes pas comme prévu, mais la probabilité était grande. Il pouvait se fier à sa connaissance des hommes. Et pour le cas où ça ne marcherait pas, il avait réfléchi à des alternatives. Il y avait beaucoup de possibilités pour se tirer de la merde. Après le plan A, le plan B. Soyez flexibles dans vos plans, c’est le meilleur moyen pour devenir un bon flic.
Il était très tendu. Comme toujours avant que ça commence. Réfléchir, faire des plans, tout cela avait une fin. Il pouvait s’en aller à présent, tout quitter. Des temps nouveaux commençaient, il pouvait les affronter avec assurance, avec plus ou moins d’inquiétude. De toute façon, on ne peut pas changer le monde. Il est comme il est. Et les hommes ne changent pas non plus du jour au lendemain. L’essentiel est de savoir s’adapter et de survivre. Malgré tout ce que Merit et les autres pouvaient raconter.
« Les portes de l’avenir sont ouvertes à celui qui sait répondre oui. » Même les simples vers de Baldur Schirach, le führer de la jeunesse du Reich, lui apparurent tout à coup sous un tout autre éclairage.
Il brûla les papiers dont il n’avait plus besoin dans le poêle qu’il n’utilisait plus depuis des semaines et jeta en dernier son ordre de mission dans les flammes. La feuille prit feu instantanément, se recroquevilla sur elle-même, se transforma en quelque chose de noir, léger comme un souffle, qui retomba en quelques secondes en petits fragments.
Il boucla sa valise, se retourna une dernière fois. Il prendrait le métro, en civil. Il y avait peu de risques d’être arrêté. Et Langenstras avait oublié de lui redemander son sauf-conduit. Il ne pouvait rien lui arriver.
Pour ouvrir la porte d’entrée il s’était procuré un passe-partout chez un serrurier à qui il avait exhibé une carte d’identité qu’il avait remplie lui-même. Celle de l’appartement ne lui poserait aucun problème, son expérience acquise jadis à la police de sûreté lui suffirait amplement. Il attendrait la nuit dans un de ces cafés de banlieue, puis il mettrait son plan à exécution.
Il vérifia une fois encore le parabellum, l’enfouit dans sa poche de manteau et empoigna la valise. Puis il ferma la porte à clé derrière lui.
Aux nombreux chants des sirènes, préalerte, alerte, fin d’alerte, s’était mêlée une nouvelle mélodie : alerte à l’ennemi. Les Russes étaient aux portes de la ville. Berlin était à portée de canons des Soviets.
Haas avait endossé le rucksack et était de nouveau en route. Le léger vent de nord-ouest lui apportait le grondement lointain de tirs d’artillerie. Ça sentait la suie et le soufre, des flocons de cendres se posaient sur les bourgeons en train d’éclore.
Cela faisait déjà six ou sept fois qu’il empruntait ce chemin. Il s’était rendu à plusieurs reprises devant la villa de la Höhmannstrasse. Il sonnait, puis flânait dans les parages, faisant au mieux pour ne pas se faire remarquer dans ce quartier huppé. Il se livrait à ce manège plusieurs fois par jour, mais toujours en vain. Personne ne lui ouvrait. Mais il n’était pas question de renoncer. Le temps pressait, la guerre pouvait être terminée dans peu de jours, il fallait qu’il mette la main sur Bideaux avant que la loi et l’ordre ne reviennent en Allemagne.
L’activité des rues était habituelle. Des gens érigeaient des barricades à presque tous les carrefours importants. Des femmes et des enfants, des soldats qui n’avaient été que légèrement blessés et des travailleurs forcés en tenue de condamné défonçaient les chaussées avec des pics, poussaient des brouettes pleines de gravats, faisaient la chaîne avec des pavés dont ils remplissaient des wagons de tramways placés en travers des rues.
Des automobiles se frayaient leur chemin dans la foule en klaxonnant, des véhicules militaires blindés passaient en remorquant des canons. Le flot disparate des soldats de toutes armes, des compagnies de Waffen-SS aux appelés du Volkssturm, s’écoulait sans cesse vers les banlieues est, passant entre les coquilles vides des immeubles.
Il pressait le pas. Quelle folie ! La guerre était perdue depuis longtemps et on continuait à faire semblant. Et voilà qu’il fallait aussi défendre Berlin jusqu’au dernier homme et à la dernière cartouche ! Et le Führer, lui, était assis loin sous terre, dans son bunker, comme un cloporte sous sa pierre, et envoyait encore des milliers d’hommes à la mort tout en fêtant son anniversaire. Il n’y avait plus qu’à espérer qu’il entende la sérénade que les Russes lui jouaient avec leurs orgues de Staline.
Il croisait des groupes d’êtres courbés aux visages hâves et émaciés, qui élevaient de ridicules obstacles et des barrages antichars. Il ne craignait plus les contrôles. Ils étaient tous bien trop occupés à construire ces défenses avant que les Russes ne bouclent entièrement Berlin, ou bien ils tentaient de quitter la ville, à pied et en longues colonnes, en charrettes ou en voitures privées.
Dans une rue relativement calme, il perçut des pas rapides sur des terrains recouverts de décombres, entendit des voix et pendant quelques secondes il vit plusieurs personnes courbées en deux courir parmi les ruines. Il se retourna, mais ne vit qu’une femme qui tramait deux enfants à sa suite. Il poursuivit sa route sur le sentier piétiné. Soudain, sur sa droite, cinq hommes en uniforme déboulèrent des ruines, casque en tête, plaques pectorales en demi-lune au bout de leurs chaînes, pistolet-mitrailleur au poing. Des Feldgendarmes !
Quatre d’entre eux le dépassèrent en courant sans même lui jeter un regard et se dispersèrent sur les décombres où les fugitifs venaient de disparaître. Mais le Truppführer s’arrêta à sa hauteur et lui saisit le bras.
— Papiers ! hurla le militaire en l’entraînant sur le champ de ruines.
Ses genoux se dérobèrent sous lui. Pendant qu’il fouillait dans la poche de son manteau, il vit que les autres Feldgendarmes pénétraient dans un immeuble dont il ne restait que les murs. Il lui tendit son permis de travail et le certificat qui précisait qu’il était indispensable sur l’arrière-front, quand, soudain, quelques obus explosèrent comme des coups de tonnerre dans un ciel serein. Ils se baissèrent en rentrant machinalement la tête dans les épaules. D’épais nuages de fumée s’élevèrent quelques rues plus loin.
Le Truppführer le regarda :
— Mais c’est impossible ! Des tirs d’artillerie dans ce quartier ? Les popovs seraient déjà au sud de la ville ? Nom de Dieu !
Des cris et des voix confuses montèrent des ruines. Puis un Feldgendarme apparut dans l’encadrement roussi d’une porte, poussant devant lui un vieil homme chauve. PM en main, les trois autres surgirent d’un trou de cave et alignèrent contre la façade calcinée quatre adolescents aux uniformes recouverts de poussière et bien trop grands pour eux.
Le soldat se présenta au Truppführer avec le vieillard :
— Mission accomplie. Nous les avons, ces lâches !
Il était tombé sur un commando chargé de fusiller les déserteurs qu’on traquait dans les rues et débusquait des ruines. Ceux qu’ils avaient collés contre la façade étaient des gamins avec des brassards du Volkssturm. Il observa le visage gris et affaissé du vieil homme. Ses yeux étaient rougis et ses lèvres tremblaient convulsivement. Leurs regards se croisèrent un instant et il sentit qu’il n’avait plus en lui que du désespoir. Mais il ne pouvait pas l’aider, tous les muscles de son corps étaient contractés par la frousse. Il recala son sac à dos d’un coup d’épaule et fixa l’endroit où les obus avaient explosé.
Читать дальше