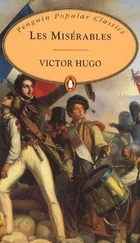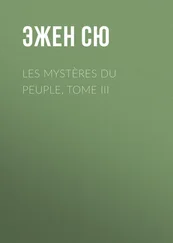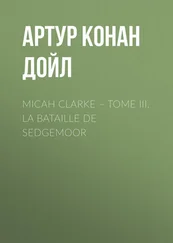Jacques le voyait de profil ; et ce profil de rongeur était à peine un profil humain : la ligne oblique et fuyante du front et du nez constituait, à peu de chose près, tout le visage ; cette ligne se perdait, en haut, dans la brosse hirsute des cheveux poivre et sel, en bas, dans la barbe, plantée comme un essuie-plume, où se dissimulaient une bouche en retrait et un menton avorté. Jacques regardait toujours Gallot avec surprise et curiosité, comme on examine un hérisson quand on a la chance exceptionnelle de le surprendre avant qu’il se mette en boule.
La porte s’ouvrit en coup de vent, et Stefany parut, sans veston, les manches de chemise roulées jusqu’au coude sur ses bras noueux, les lunettes solidement campées sur son nez d’oiseau. Il apportait l’ordre du jour voté, la veille, à Bruxelles, par le Congrès syndical.
Gallot se leva, non sans avoir pris la liste de Pagès, et l’avoir soigneusement glissée dans un classeur. Les trois hommes discutèrent un instant le texte belge, sans s’occuper de Jacques. Puis ils échangèrent leurs impressions sur les nouvelles du jour.
Indiscutablement, l’atmosphère, ce matin, était moins tendue. Les nouvelles d’Europe centrale autorisaient quelques espérances. Les troupes autrichiennes n’avaient toujours pas franchi le Danube. Ce temps d’arrêt, après la précipitation des agissements de l’Autriche pour rompre avec la Serbie, était, selon Jaurès, significatif. Devant la bonne volonté manifeste de la réponse serbe et l’indignation générale des puissances, Vienne, évidemment, hésitait encore à commencer les hostilités. D’autre part, la menace de mobilisation faite, la veille, par l’Allemagne à la Russie, et qui avait si fort inquiété les chancelleries, semblait, tout compte fait, devoir être interprétée moins défavorablement : d’après certains, c’était un acte volontairement énergique, inspiré par un sincère désir de sauvegarder la paix. Et, en effet, le résultat immédiat s’annonçait assez bon : la Russie avait obtenu des Serbes l’engagement de reculer sans combattre, en cas d’avance autrichienne : ce qui allait permettre de gagner du temps, et de trouver sans doute des formules de conciliation.
Jacques avait reçu divers renseignements assez encourageants sur la résistance internationale. En Italie, les députés socialistes devaient se réunir, à Milan, pour examiner la situation et préciser l’attitude pacifiste du Parti italien. En Allemagne, les mesures énergiques du gouvernement ne parvenaient pas à museler les forces d’opposition : une grande manifestation contre la guerre se préparait, pour le lendemain, à Berlin. Dans toute la France, les sections socialistes et syndicalistes, alertées, étudiaient des plans régionaux de grève.
On vint prévenir Stefany que Jules Guesde l’attendait. Jacques, pressé par son rendez-vous, sortit de la pièce avec lui, et l’accompagna jusqu’à son bureau.
— « Plans régionaux ? » demanda-t-il. « Pour pouvoir, en cas de guerre, participer à une grève générale ? »
— « Générale, évidemment », répondit Stefany.
Mais, au gré de Jacques, le ton manquait un peu de confiance.
Le Café du Rialto était situé rue de Bondy. Le voisinage de la Confédération générale du Travail avait fait de cet établissement, le siège d’un groupe de syndiqués, particulièrement actif. Jacques devait y rencontrer deux militants de la C. G. T., avec lesquels Richardley l’avait prié de se mettre en contact. L’un avait été instituteur ; l’autre était un ancien contremaître métallurgiste.
L’entretien durait déjà depuis près d’une heure ; Jacques — très intéressé par les renseignements qu’il recueillait sur les méthodes actuellement à l’étude pour obtenir une collaboration plus étroite entre l’activité des C. G. T. et celle des partis socialistes, dans leur commune opposition contre la guerre, — ne songeait pas à y mettre fin, lorsque la patronne du café parut à la porte de l’arrière-salle réservée aux réunions, et cria, à la cantonade :
— « On demande Thibault au téléphone. »
Jacques hésitait à se lever. Nul ne pouvait avoir l’idée de le relancer ici. Sans doute y avait-il quelque autre Thibault dans la salle ?… Comme personne ne se dérangeait, il se décida à aller voir.
C’était Pagès. Jacques se souvint, en effet, que, en quittant le bureau de Gallot, il avait fait allusion à son rendez-vous rue de Bondy.
— « Une chance que je te joigne ! » dit Pagès. « Je viens de recevoir un Suisse, qui veut te parler… qui te cherche, partout, depuis hier. »
— « Quel Suisse ? »
— « Un drôle de petit homme, un nain à cheveux blancs, un albinos. »
— « Ah ! je sais… Ce n’est pas un Suisse, c’est un Belge. Il est donc à Paris ?… »
— « Je n’ai pas voulu lui dire où tu étais. Je lui ai conseillé, à tout hasard, de se trouver au Croissant, à une heure. »
« Et ma visite à Jenny ! » se dit Jacques.
— « Non », fit-il aussitôt. « J’ai un rendez-vous à une heure, que je ne peux absolument pas… »
— « Comme tu voudras », trancha Pagès. « Mais ça paraît urgent. Il a une communication à te faire, de la part de Meynestrel… Enfin, moi, je t’ai prévenu. Au revoir. »
— « Merci. »
Meynestrel ? Une communication urgente ?
Jacques quitta le Rialto, perplexe. Il ne pouvait se résoudre à remettre sa visite avenue de l’Observatoire. Pourtant, la raison l’emporta. Et, avant d’aller chez son notaire, il entra, rageur, dans un bureau de poste et griffonna un pneumatique à l’adresse de Jenny, pour la prévenir qu’il ne pourrait être chez elle avant trois heures.
L’étude Beynaud occupait le premier étage d’un bel immeuble de la rue Tronchet.
En toute autre circonstance, la gravité compacte de maître Beynaud, l’aspect du lieu, du mobilier, des clercs, l’atmosphère morne et poussiéreuse de cette nécropole de paperasses, lui eussent paru comiques. On le reçut avec certains égards. Il était le fils, l’héritier, du regretté M. Thibault ; sans doute aussi, un futur client. Du saute-ruisseau au patron, régnait un respect dévotieux pour la fortune acquise. On lui fit signer des papiers. Et, comme il semblait impatient d’avoir la disposition de ce gros capital, on chercha discrètement à savoir ce qu’il en comptait faire.
— « Évidemment », proféra maître Beynaud, les mains agrippées aux têtes de lions qui terminaient les bras de son fauteuil, « la Bourse, en ces temps de crise, offre des occasions imprévues… pour qui connaît bien les marchés… Mais, d’autre part, les risques… »
Jacques coupa court et prit congé.
À la charge de l’agent de change, une fièvre insolite agitait les employés derrière les grilles de leur ménagerie. Les téléphones tintaient. On criait des ordres. L’heure de l’ouverture de la Bourse était proche, et la gravité de la situation générale faisait craindre une séance mouvementée. On souleva des difficultés, lorsque Jacques demanda à être reçu par M. Jonquoy lui-même. Il dut se contenter d’un fondé de pouvoir. Et, dès qu’il eut émis la prétention de faire vendre immédiatement la totalité de ses titres, on lui représenta que le moment était mal choisi, et qu’il aurait à subir, sur l’ensemble des opérations, une perte fort appréciable.
— « Peu importe », dit-il.
Il avait l’air si résolu qu’il en imposa à l’homme de Bourse. Pour commettre une pareille folie et rester aussi calme, il fallait certainement que cet étrange client eût des tuyaux secrets, et combinât un coup de maître. Néanmoins, il fallait compter environ deux jours pour réaliser tous ces ordres de vente. Jacques se leva, en annonçant qu’il reviendrait mercredi, et qu’il désirait ce jour-là, trouver toute sa fortune, en espèces, à la caisse de la charge.
Читать дальше
![Roger du Gard Les Thibault — Tome III [L'Eté 1914 (suite et fin) — Épilogue] обложка книги](/books/95477/roger-du-gard-les-thibault-tome-iii-l-ete-1914-cover.webp)



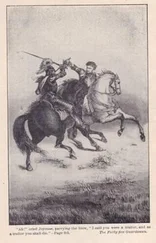
![Roger du Gard - Les Thibault — Tome II [La Mort du père — L'Eté 1914]](/books/95478/roger-du-gard-les-thibault-tome-ii-la-mort-du-p-thumb.webp)
![Roger du Gard - Les Thibault — Tome I [Le Cahier Gris — Le Pénitencier — La Belle Saison — La Consultation — La Sorellina]](/books/95479/roger-du-gard-les-thibault-tome-i-le-cahier-gri-thumb.webp)