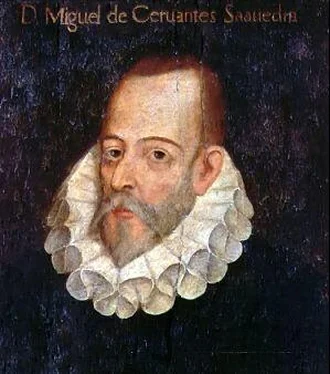«N’aurais-tu point pensé, ami Lothaire, que je dusse répondre par une gratitude sans bornes aux grâces que Dieu m’a faites en me faisant naître de parents tels que les miens, en me prodiguant d’une main libérale les biens de la nature et ceux de la fortune, surtout à la grâce plus grande encore qu’il a ajoutée en me donnant toi pour ami, et Camille pour femme, deux bonheurs que j’estime, sinon autant qu’ils le méritent, du moins autant que je le puis? Eh bien! avec tous ces avantages dont se forme l’ensemble de satisfactions qui peuvent et doivent rendre les hommes heureux, je passe la vie de l’homme le plus triste, le plus abattu, le plus désespéré qu’il y ait dans l’univers. Depuis je ne sais combien de jours, un désir me presse et me tourmente, si étrange, si bizarre, si hors de l’usage commun, que je m’étonne de moi-même, que je m’accuse et me gronde, que je voudrais le taire et le cacher à mes propres pensées. Mais, ne pouvant plus contenir ce secret, je veux du moins le confier en dépôt à ta discrétion, dans l’espoir que, par les soins que tu mettras à me guérir, en ami véritable, je me verrai bientôt délivré des angoisses qu’il me cause, et que ma joie reviendra par ta sollicitude au point où ma tristesse est arrivée par ma folie.»
Lothaire écoutait avec étonnement les paroles d’Anselme, ne sachant à quoi tendait un si long préambule; et, bien qu’il cherchât et roulât dans son imagination quel désir pouvait être celui qui tourmentait à ce point son ami, les coups portaient toujours loin du blanc de la vérité. Enfin, pour sortir promptement de l’agonie où le tenait cette incertitude, il lui dit que c’était faire outrage à sa vive amitié que de chercher tant de détours pour lui exposer ses plus secrètes pensées, puisqu’il pouvait se promettre de trouver en lui, ou des conseils pour les diriger, ou des ressources pour les accomplir.
«Tu as raison, répondit Anselme, et, dans cette confiance, je veux t’apprendre, ami Lothaire, que le désir qui me poursuit, c’est de savoir si Camille, mon épouse, est aussi vertueuse, aussi parfaite que je me l’imagine. Or, je ne peux m’assurer de la vérité sur ce point qu’en l’éprouvant de manière que l’épreuve démontre la pureté de sa vertu, comme le feu prouve celle de l’or. Je pense en effet, ô mon ami, qu’une femme n’est vertueuse que selon qu’elle est ou n’est pas sollicitée, et que celle-là seulement peut s’appeler forte, qui ne plie ni aux promesses, ni aux dons, ni aux larmes, ni aux continuelles importunités d’un amant empressé. Quel mérite y a-t-il à ce qu’une femme reste sage, si personne ne l’engage à cesser de l’être? est-il étrange qu’elle soit réservée et craintive, celle à qui l’on ne laisse aucune occasion de s’échapper, celle qui connaît assez son mari pour savoir qu’elle payera de sa vie la première faute où il la surprendra? Aussi la femme vertueuse par crainte ou faute d’occasion, je ne veux pas la tenir en même estime que celle qui est sollicitée, poursuivie, et qui sort des tentations avec la couronne de la victoire. Enfin, par toutes ces raisons, et beaucoup d’autres que je pourrais ajouter à l’appui de mon opinion, je désire que mon épouse Camille passe par ces difficultés, et qu’elle soit mise au creuset des poursuites et des adorations d’un homme digne de prétendre à ses faveurs. Si, comme je l’espère, elle sort de cette bataille avec la palme du triomphe, alors je tiendrai mon bonheur pour sans égal, je pourrai dire que le vide de mes désirs est comblé, et que j’ai reçu en partage la femme forte, celle dont le sage a dit: Qui la trouvera [187] ? Mais, quand même l’événement serait au rebours de ce que j’imagine, le plaisir de voir que je ne m’étais pas trompé dans mon opinion me fera supporter la peine que pourra me causer à bon droit une si coûteuse expérience. Il y a plus: comme rien de ce que tu pourras me dire à l’encontre de cette fantaisie ne saurait me détourner de la mettre en œuvre, je veux, ô mon ami Lothaire, que tu te disposes à être l’instrument qui élèvera l’édifice de ma satisfaction. Je te donnerai les occasions d’agir, et rien ne te manquera de ce qui me semblera nécessaire pour ébranler une femme honnête, modeste, chaste et désintéressée. Ce qui me décide, entre autres choses, à te confier plutôt qu’à tout autre une entreprise si épineuse, c’est de savoir que, si Camille est vaincue par toi, la victoire n’ira pas jusqu’à ses dernières exigences, mais seulement à tenir pour fait ce qu’il était possible de faire. De cette manière, je ne serai offensé que par l’intention, et mon outrage restera enseveli dans le secret de ton silence, qui, je le sais, sera, pour ce qui me regarde, éternel comme celui de la mort. Ainsi donc, si tu veux que je goûte une vie qui se puisse appeler de ce nom, il faut que tu ouvres sans délai cette campagne amoureuse, non point avec lenteur et timidité, mais avec autant d’empressement et de zèle qu’en exige mon désir et qu’en attend ma confiance en ton amitié.»
Tels furent les propos que tint Anselme à Lothaire, et celui-ci les écoutait avec tant d’attention et de surprise, qu’il n’ouvrit pas les lèvres avant que son ami eût cessé de parler. S’apercevant qu’il gardait le silence, il se mit d’abord à le regarder fixement, comme il aurait regardé quelque autre chose inconnue pour lui jusqu’alors, et dont la vue exciterait son étonnement et son effroi. Enfin, au bout d’une longue pause, il lui dit:
«Je ne peux me persuader, ami Anselme, que tout ce que tu viens de dire ne soit pas une plaisanterie; certes, si j’avais pensé que tu parlais sérieusement, je ne t’aurais pas laissé finir; en cessant de t’écouter, j’aurais coupé court à ta longue harangue. J’imagine, ou que tu ne me connais point, ou que je ne te connais point. Mais non: je sais bien que tu es Anselme, et tu sais bien que je suis Lothaire. Par malheur, je pense que tu n’es plus le même Anselme, et que tu dois avoir aussi pensé que je ne suis pas non plus le même Lothaire; car, ni les choses que tu m’as dites ne sont de cet Anselme, mon ami, ni celles que tu me demandes ne s’adressent à ce Lothaire que tu connais. Les bons amis, en effet, doivent mettre leurs amis à l’épreuve usque ad aras, comme a dit un poëte, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas exiger de leur amitié des choses qui soient contre les préceptes de Dieu. Mais si un gentil [188]a pensé cela de l’amitié, à combien plus forte raison doit le penser un chrétien, qui sait que, pour nulle affection humaine, on ne doit perdre l’affection divine! et si l’ami pousse les choses au point d’oublier ses devoirs envers le ciel pour ses devoirs envers l’amitié, ce ne doit pas être sur de frivoles motifs, mais uniquement quand il y va de l’honneur ou de la vie de son ami. Or, dis-moi, Anselme, laquelle de ces deux choses est en danger chez toi, pour que je me hasarde à te complaire et à faire une action détestable comme celle que tu me demandes? Aucune, assurément. Tu me demandes, au contraire, à ce que j’aperçois, que j’essaye, que je m’efforce de t’ôter l’honneur et la vie, et de me les ôter en même temps; car enfin, si je t’ôte l’honneur, il est clair que je t’ôte la vie, puisqu’un homme déshonoré est pire qu’un homme mort; et si je suis, comme tu le veux, l’instrument de ton malheur, je deviens également déshonoré, et partant sans vie. Écoute, ami Anselme, prends patience, et ne m’interromps point, jusqu’à ce que j’aie fini de te dire tout ce qui me viendra dans la pensée à l’égard de ta fantaisie. Le temps ne nous manquera point ensuite, à toi pour me répondre, à moi pour t’écouter.
Читать дальше