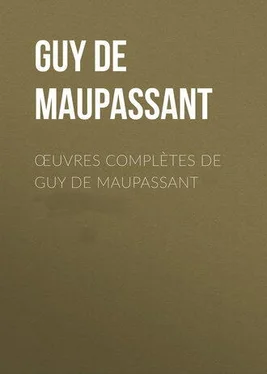Guy de Maupassant - Miss Harriet (1884)
Здесь есть возможность читать онлайн «Guy de Maupassant - Miss Harriet (1884)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Классическая проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Miss Harriet (1884)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Miss Harriet (1884): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Miss Harriet (1884)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La plupart des contes ont fait l'objet d'une publication antérieure dans des journaux comme Le Gaulois ou Gil Blas, parfois sous le pseudonyme de Maufrigneuse. Le recueil est publié le 22 avril 1884 chez l'éditeur Victor Havard.
Miss Harriet (1884) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Miss Harriet (1884)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— Qu’allons-nous faire ?…
Elle répondit vivement.
— Il faut éloigner les enfants. Puisque Joseph sait tout, il va aller les chercher. Il faut prendre garde surtout que notre gendre ne se doute de rien.
Mon père paraissait atterré. Il murmura :
— Quelle catastrophe !
Ma mère ajouta, devenue tout à coup furieuse :
— Je me suis toujours doutée que ce voleur ne ferait rien, et qu’il nous retomberait sur le dos ! Comme si on pouvait attendre quelque chose d’un Davranche !.. Et mon père se passa la main sur le front, comme il faisait sous les reproches de sa femme.
Elle ajouta :
— Donne de l’argent à Joseph pour qu’il aille payer ces huîtres, à présent. Il ne manquerait plus que d’être reconnu par ce mendiant. Cela ferait un joli effet sur le navire. Allons-nous-en à l’autre bout, et fais en sorte que cet homme n’approche pas de nous !
Elle se leva, et ils s’éloignèrent après m’avoir remis une pièce de cent sous.
Mes sœurs, surprises, attendaient leur père. J’affirmai que maman s’était trouvée un peu gênée par la mer, et je demandai à l’ouvreur d’huîtres :
— Combien est-ce que nous vous devons, Monsieur ?
J’avais envie de dire : mon oncle.
Il répondit :
— Deux francs cinquante.
Je tendis mes cent sous et il me rendit la monnaie.
Je regardais sa main, une pauvre main de matelot toute plissée, et je regardais son visage, un vieux misérable visage, triste, accablé, en me disant :
« C’est mon oncle, le frère de papa, mon oncle ! »
Je lui laissai dix sous de pourboire. Il me remercia :
— Dieu vous bénisse, mon jeune monsieur !
Avec l’accent d’un pauvre qui reçoit l’aumône. Je pensai qu’il avait dû mendier, là-bas !
Mes sœurs me contemplaient, stupéfaites de ma générosité.
Quand je remis les deux francs à mon père, ma mère, surprise, demanda :
— Il y en avait pour trois francs ?… Ce n’est pas possible.
— J’ai donné dix sous de pourboire.
Ma mère eut un sursaut et me regarda dans les yeux :
— Tu es fou ! Donner dix sous à cet homme, à ce gueux !..
Elle s’arrêta sous un regard de mon père, qui désignait son gendre.
Puis on se tut.
Devant nous, à l’horizon, une ombre violette semblait sortir de la mer. C’était Jersey.
Lorsqu’on approcha des jetées, un désir violent me vint au cœur de voir encore une fois mon oncle Jules, de m’approcher, de lui dire quelque chose de consolant, de tendre.
Mais, comme personne ne mangeait plus d’huîtres, il avait disparu, descendu sans doute au fond de la cale infecte où logeait ce misérable.
Et nous sommes revenus par le bateau de Saint-Malo, pour ne pas le rencontrer. Ma mère était dévorée d’inquiétude.
Je n’ai jamais revu le frère de mon père !
Voilà pourquoi tu me verras quelquefois donner cent sous aux vagabonds.
7 août 1883
En voyage
À Gustave Toudouze.
I
Le wagon était au complet depuis Cannes ; on causait, tout le monde se connaissant. Lorsqu’on passa Tarascon, quelqu’un dit : « C’est ici qu’on assassine. » Et on se mit à parler du mystérieux et insaisissable meurtrier qui, depuis deux ans, s’offre, de temps en temps, la vie d’un voyageur. Chacun faisait des suppositions, chacun donnait son avis ; les femmes regardaient en frissonnant la nuit sombre derrière les vitres, avec la peur de voir apparaître soudain une tête d’homme à la portière. Et on se mit à raconter des histoires effrayantes de mauvaises rencontres, des tête-à-tête avec des fous dans un rapide, des heures passées en face d’un personnage suspect.
Chaque homme avait une anecdote à son honneur, chacun avait intimidé, terrassé et garrotté quelque malfaiteur en des circonstances surprenantes, avec une présence d’esprit et une audace admirables. Un médecin, qui passait chaque hiver dans le Midi, voulut à son tour conter une aventure :
Moi, dit-il, je n’ai jamais eu la chance d’expérimenter mon courage dans une affaire de cette sorte ; mais j’ai connu une femme, une de mes clientes, morte aujourd’hui, à qui arriva la plus singulière chose du monde, et aussi la plus mystérieuse et la plus attendrissante.
C’était une Russe, la comtesse Marie Baranow, une très grande dame, d’une exquise beauté. Vous savez comme les Russes sont belles, du moins comme elles nous semblent belles, avec leur nez fin, leur bouche délicate, leurs yeux rapprochés, d’une indéfinissable couleur, d’un bleu gris, et leur grâce froide, un peu dure ! Elles ont quelque chose de méchant et de séduisant, d’altier et de doux, de tendre et de sévère, tout à fait charmant pour un Français. Au fond, c’est peut-être seulement la différence de race et de type qui me fait voir tant de choses en elles.
Son médecin, depuis plusieurs années, la voyait menacée d’une maladie de poitrine et tâchait de la décider à venir dans le midi de la France ; mais elle refusait obstinément de quitter Pétersbourg. Enfin l’automne dernier, la jugeant perdue, le docteur prévint le mari qui ordonna aussitôt à sa femme de partir pour Menton.
Elle prit le train, seule dans son wagon, ses gens de service occupant un autre compartiment. Elle restait contre la portière, un peu triste, regardant passer les campagnes et les villages, se sentant bien isolée, bien abandonnée dans la vie, sans enfants, presque sans parents, avec un mari dont l’amour était mort et qui la jetait ainsi au bout du monde sans venir avec elle, comme on envoie à l’hôpital un valet malade.
À chaque station, son serviteur Ivan venait s’informer si rien ne manquait à sa maîtresse. C’était un vieux domestique aveuglément dévoué, prêt à accomplir tous les ordres qu’elle lui donnerait.
La nuit tomba, le convoi roulait à toute vitesse. Elle ne pouvait dormir, énervée à l’excès. Soudain la pensée lui vint de compter l’argent que son mari lui avait remis à la dernière minute, en or de France. Elle ouvrit son petit sac, et vida sur ses genoux le flot luisant de métal.
Mais tout à coup un souffle d’air froid lui frappa le visage. Surprise, elle leva la tête. La portière venait de s’ouvrir. La comtesse Marie, éperdue, jeta brusquement un châle sur son argent répandu dans sa robe, et attendit. Quelques secondes s’écoulèrent, puis un homme parut, nu-tête, blessé à la main, haletant, en costume de soirée. Il referma la porte, s’assit, regarda sa voisine avec des yeux luisants, puis enveloppa d’un mouchoir son poignet dont le sang coulait.
La jeune femme se sentait défaillir de peur. Cet homme, certes, l’avait vue compter son or, et il était venu pour la voler et la tuer.
Il la fixait toujours, essoufflé, le visage convulsé, prêt à bondir sur elle sans doute.
Il dit brusquement :
— Madame, n’ayez pas peur !
Elle ne répondit rien, incapable d’ouvrir la bouche, entendant son cœur battre et ses oreilles bourdonner.
Il reprit :
— Je ne suis pas un malfaiteur, Madame.
Elle ne disait toujours rien, mais, dans un brusque mouvement qu’elle fit, ses genoux s’étant rapprochés, son or se mit à couler sur le tapis comme l’eau coule d’une gouttière.
L’homme, surpris, regardait ce ruisseau de métal, et il se baissa tout à coup pour le ramasser.
Elle, effarée, se leva, jetant à terre toute sa fortune, et elle courut à la portière pour se précipiter sur la voie. Mais il comprit ce qu’elle allait faire, s’élança, la saisit dans ses bras, la fit asseoir de force, et la maintenant par les poignets : « Écoutez-moi, Madame, je ne suis pas un malfaiteur, et, la preuve, c’est que je vais ramasser cet argent et vous le rendre. Mais je suis un homme perdu, un homme mort, si vous ne m’aidez pas à passer la frontière. Je ne puis vous en dire davantage. Dans une heure, nous serons à la dernière station russe ; dans une heure vingt, nous franchirons la limite de l’empire. Si vous ne me secourez point, je suis perdu. Et cependant, Madame, je n’ai ni tué, ni volé, ni rien fait de contraire à l’honneur. Cela je vous le jure. Je ne puis vous en dire davantage. »
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Miss Harriet (1884)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Miss Harriet (1884)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Miss Harriet (1884)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.